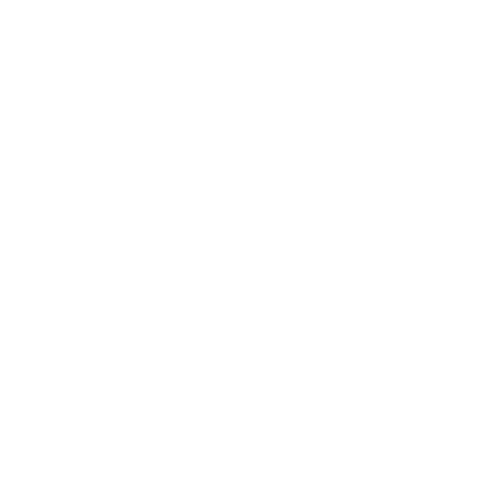A quel point le mouvement ouvrier a reculé, on ne peut en juger seulement à partir de l’état des organisations de masse, mais aussi en étudiant les regroupements idéologiques en cours et les recherches théoriques dans lesquelles sont engagés tant de groupes. A Paris paraît le périodique Que faire ? qui, pour une raison ou pour une autre, se considère comme marxiste mais se situe en réalité entièrement dans le cadre de l’empirisme des intellectuels bourgeois de gauche et de ces travailleurs isolés qui ont pris tous les vices des intellectuels.
Comme tous les groupes qui ne possèdent ni bases théoriques ni programme ni traditions, ce petit périodique a tenté de s’accrocher aux basques du POUM – qui semblait offrir aux masses un raccourci pour la victoire. Pourtant, le résultat de la révolution espagnole est à première vue inattendu : ce périodique n’a pas progressé, mais au contraire reculé. En vérité, c’est dans la nature des choses. Les contradictions se sont tendues à l’extrême entre la petite bourgeoisie et le conservatisme, d’une part, et les nécessités de la révolution prolétarienne, de l’autre. Rien de plus naturel que les défenseurs et interprètes de la politique du POUM aient été rejetés très loin en arrière, tant sur le plan politique que sur le plan théorique.
Que faire ? n’a en lui même et par lui-même aucune espèce d’importance. Mais il présente de l’intérêt à titre de symptôme. C’est pourquoi il nous semble utile de nous attarder sur l’appréciation qu’il porte sur les causes de la défaite de la révolution espagnole, dans la mesure où elle met en lumière les caractéristiques actuelles de l’aile gauche du pseudo-marxisme.
Que faire ? explique
Nous commencerons par reproduire littéralement cette citation extraite d’un compte rendu de la brochure L’Espagne livrée, de notre camarade Casanova :
« « Pourquoi la révolution a-t-elle été écrasée ? Parce que », répond l’auteur, « le PC a mené une politique fausse, malheureusement suivie par les masses révolutionnaires ». Mais pourquoi diable les masses révolutionnaires qui ont lâché leurs anciens dirigeants se sont-elles rangées sous les drapeaux du PC ? « Parce qu’il n’existait pas de véritable parti révolutionnaire ». Nous sommes en présence d’une pure tautologie. Politique fausse suivie par les masses, parti non mûr, ou bien c’est la manifestation d’une certaine disposition des forces sociales (non-maturité de la classe ouvrière, carence de la paysannerie) qu’il faut expliquer en partant des faits rapportés, entre autres par Casanova lui-même, ou bien c’est l’effet de l’action de certains individus ou groupes d’individus malsains, non contrecarrée par les efforts équivalents des « individus sincères » seuls capables de sauver la révolution. Après avoir effleuré la première voie, la voie marxiste, Casanova s’engage dans la seconde. Nous sommes en pleine démonologie. Le responsable de la défaite est le diable en chef, Staline, secondé par les diablotins, anarchistes et autres : le malheur a voulu que le dieu des révolutionnaires n’ait pas envoyé en Espagne un Lénine ou un Trotsky comme il l’avait fait en Russie en 1917. »
La conclusion en découle : « Voici où l’on aboutit quand on veut à tout prix imposer aux faits l’orthodoxie desséchée d’une chapelle. »
Cette morgue théorique est d’autant plus splendide qu’il est difficile de concevoir comment autant de remarques banales, triviales ou fausses, caractéristiques du genre philistin conservateur, ont pu être concentrées en si peu de lignes.
L’auteur du passage ci-dessus se garde bien de donner la moindre explication de la défaite de la révolution espagnole : il se contente d’indiquer qu’il faut recourir à des explications plus profondes, comme l’ « état des forces sociales ». Ce n’est pas par hasard qu’on évite ainsi toute explication. Ces critiques du bolchevisme sont tous des théoriciens peureux pour la simple raison qu’ils n’ont rien de solide sous les pieds. Afin d’éviter d’avoir à révéler leur propre faillite, ils doivent jongler avec les faits et rôder autour des opinions des autres. Ils se bornent à des allusions et des demi-pensées, comme s’ils n’avaient pas le temps de donner des définitions tirées de leur propre sagesse. En vérité, ils n’ont pas de sagesse du tout. Leur morgue est inséparable de leur charlatanisme intellectuel.
Analysons une à une les allusions et les demi-pensées de notre auteur. Une politique fausse des masses ne peut s’expliquer selon lui que comme la « manifestation d’un certain état des forces sociales », c’est-à-dire « la non-maturité de la classe ouvrière » et « la carence de la paysannerie ». Si l’on est friand de tautologies, il serait difficile d’en trouver de plus plates. Une « politique fausse des masses » s’explique par leur « non-maturité » ? Mais qu’est ce que la « non-maturité » des masses ? De toute évidence, c’est leur prédisposition à suivre une politique fausse. En quoi consistait cette politique fausse ? Qui étaient les initiateurs ? Les masses ou les dirigeants ? Notre auteur ne souffle mot là-dessus. Et par cette tautologie, il transfère la responsabilité sur les masses. Ce truc classique, utilisé par tous les traîtres, les déserteurs et leurs avocats, est particulièrement révoltant quand il s’agit du prolétariat espagnol.
Les sophismes des traîtres
En juillet 1936 – pour ne pas remonter plus loin – les ouvriers espagnols ont repoussé l’attaque des officiers qui avaient mis au point leur conspiration sous l’aile protectrice du Front populaire. Les masses ont improvisé des milices et bâti des comités ouvriers, citadelles de leur future dictature. Pour leur part, les organisations dirigeantes du prolétariat ont aidé la bourgeoisie à dissoudre ces comités, à mettre fin aux assauts des ouvriers contre la propriété privée, et à subordonner les milices ouvrières au commandement de la bourgeoisie, avec, par-dessus le marché, le POUM qui participait au gouvernement, prenant ainsi directement sa responsabilité dans le travail de la contre-révolution. Que signifie dans un tel cas la « non-maturité » du prolétariat ? De toute évidence, cela signifie simplement que, bien que les masses aient adopté une ligne juste, elles n’ont pas été capables de briser la coalition des socialistes, des staliniens, des anarchistes et du POUM avec la bourgeoisie. Ce modèle de sophisme procède du concept d’une sorte de maturité absolue, c’est-à-dire d’une condition de perfection des masses dans laquelle elles n’ont nullement besoin d’une direction, et, mieux encore, sont capables de vaincre contre leur propre direction. Or une telle maturité n’existe pas et ne peut pas exister.
« Mais pourquoi des ouvriers, qui montrent un instinct révolutionnaire si sûr, et des aptitudes à ce point supérieures au combat, iraient-ils se soumettre à une direction traître ? », objectent nos sages. Nous répondrons qu’il n’y a pas eu la moindre trace d’une telle soumission. La ligne de combat suivie par les ouvriers coupait à tout moment, sous un certain angle, celle de la direction, et, dans les moments les plus critiques, cet angle était de 180 degrés. La direction, alors, directement ou indirectement, aidait à soumettre les ouvriers par la force des armes.
En mai 1937, les ouvriers de Catalogne se soulevèrent, non seulement malgré leur propre direction, mais contre elle. Les dirigeants anarchistes – bourgeois pathétiques et méprisables, se déguisant à peu de frais en révolutionnaires – ont répété depuis dans leur presse des centaines de fois que si la CNT avait voulu prendre le pouvoir en mai, elle l’aurait fait sans difficulté. Et cette fois, c’est la pure vérité que disent les anarchistes. La direction du POUM se pendit littéralement aux basques de la CNT et se contenta de couvrir sa politique d’une phraséologie différente. C’est seulement pour cela que la bourgeoisie réussit à écraser le soulèvement de mai de ce prolétariat qui « manquait de maturité ». Il faut n’avoir rien compris de tout ce qui touche aux rapports entre la classe et le parti, entre les masses et leurs dirigeants, pour répéter la phrase creuse selon laquelle les masses espagnoles n’ont fait que suivre leur direction. Tout ce que l’on peut dire là-dessus, c’est que les masses, qui ont sans cesse tenté de se frayer un chemin vers la voie juste, ont découvert que la construction, dans le feu même du combat, d’une nouvelle direction, répondant aux nécessités de la révolution, était une entreprise qui dépassait leurs forces. Nous sommes en présence d’un processus dynamique dans lequel les différentes étapes de la révolution se succèdent rapidement, au cours duquel la direction, voire différents secteurs de la direction, désertent et passent d’un seul coup du côté de l’ennemi de classe. Et nos sages engagent une discussion purement statique : « pourquoi la classe ouvrière dans son ensemble a-t-elle suivi une mauvaise direction ? »
La façon dialectique de poser le problème
Il existe un vieil adage qui reflète la conception évolutionniste et libérale de l’histoire : « un peuple a le gouvernement qu’il mérite ». L’histoire nous montre cependant qu’un seul et même peuple peut avoir au cours d’une période relativement brève des gouvernements forts différents (Russie, Italie, Allemagne, Espagne, etc.), et par-dessus le marché que ses gouvernements ne se succèdent pas toujours dans le même sens, du despotisme vers la liberté, comme le croient les libéraux évolutionnistes. Le secret de cet état de fait réside en ce qu’un peuple est composé de classes hostiles, et que ces classes elles-mêmes sont formées de couches différentes, partiellement opposées les unes aux autres, ayant des directions différentes. Qui plus est, tout peuple subit l’influence d’autres peuples, composés eux-mêmes de classes. Les gouvernements ne sont pas l’expression de la « maturité » toujours grandissante d’un « peuple », mais le produit de la lutte entre les différentes classes et les différentes couches à l’intérieur d’une seule et même classe, et, enfin, de l’action de forces extérieures – alliances, conflits, guerres, etc. Il faut ajouter qu’un gouvernement, dès lors qu’il est établi, peut durer beaucoup plus longtemps que le rapport de forces dont il est issu. C’est précisément à partir de ces contradictions historiques que se produisent les révolutions, les coups d’Etat, les contre-révolutions.
C’est la même méthode dialectique qu’il faut employer pour aborder la question de la direction d’une classe. Comme les libéraux, nos sages admettent tacitement l’axiome selon lequel chaque classe a la direction qu’elle mérite. En réalité, la direction n’est pas du tout le « simple reflet » d’une classe ou le produit de sa propre puissance créatrice. Une direction se constitue au travers des heurts entre les différentes classes ou des frictions entre les différentes couches au sein d’une classe donnée. Mais, aussitôt apparue, la direction s’élève inévitablement au dessus de sa classe et risque de ce fait de subir la pression et l’influence d’autres classes. Le prolétariat peut « tolérer » pendant longtemps une direction qui a déjà subi une totale dégénérescence intérieure, mais qui n’a pas eu l’occasion de la manifester au cours de grands événements. Il faut un grand choc historique pour révéler de façon aiguë la contradiction qui existe entre la direction et la classe. Les chocs historiques les plus puissants sont les guerres et les révolutions. C’est précisément pour cette raison que la classe ouvrière se trouve souvent prise au dépourvu par la guerre et la révolution. Mais, même quand l’ancienne direction a révélé sa propre corruption interne, la classe ne peut pas improviser immédiatement une direction nouvelle, surtout si elle n’a pas hérité de la période précédente des cadres révolutionnaires solides capables de mettre à profit l’écroulement du vieux parti dirigeant. L’interprétation marxiste, c’est-à-dire l’interprétation dialectique et non scolastique des relations entre une classe et sa direction, ne laisse pas pierre sur pierre des sophismes légalistes de notre auteur.
Comment les ouvriers russes ont mûri
Celui-ci conçoit la maturité du prolétariat comme un phénomène purement statique. Pourtant, au cours d’une révolution, la conscience de classe est le processus le plus dynamique qui soit, celui qui détermine directement le cours de la révolution. Etait-il possible, en janvier 1917, ou même mars, après le renversement du tsarisme, de répondre à la question de savoir si le prolétariat russe avait suffisamment « mûri » pour conquérir le pouvoir en huit ou neuf mois ?
La classe ouvrière était à ce moment extrêmement hétérogène, socialement et politiquement. Durant les années de guerre, elle avait été renouvelée à 30 ou 40 % à partir des rangs de la petite bourgeoisie, souvent réactionnaire, des paysans arriérés, des femmes et des jeunes. Le parti bolchevique n’était suivi en mars 1917 que d’une insignifiante minorité de la classe ouvrière, et, de plus, la discorde régnait en son sein. Une écrasante majorité des ouvriers soutenait les mencheviks et les « socialistes-révolutionnaires », c’est-à-dire des social-patriotes conservateurs. La situation était encore moins favorable dans l’armée et la paysannerie. Il faut ajouter à cela le niveau culturel généralement bas du pays, le manque d’expérience politique dans les couches les plus larges du prolétariat, surtout en province, pour ne pas parler des paysans et des soldats.
Quels étaient les atouts du bolchevisme ? Lénine était le seul, au début de la révolution, à posséder une conception révolutionnaire claire, élaborée en profondeur. Les cadres russes du parti étaient éparpillés et passablement désorientés. Mais le parti avait de l’autorité sur les ouvriers avancés. Lénine avait une grande autorité sur les cadres du parti. Sa conception politique correspondait au développement réel de la révolution, et il l’ajustait à chaque événement nouveau. Ces atouts réalisèrent des merveilles dans une situation révolutionnaire, c’est-à-dire dans les conditions d’une lutte de classe acharnée. Le parti aligna rapidement sa politique jusqu’à la faire répondre à la conception de Lénine, c’est-à-dire au cours véritable de la révolution. Grâce à cela, il trouva un ferme soutien chez des dizaines de milliers de travailleurs avancés. En quelques mois, en se fondant sur le développement de la révolution, le parti fut capable de convaincre la majorité des travailleurs de la justesse de ses mots d’ordre. Cette majorité, organisée dans les soviets, fut à son tour capable d’attirer les ouvriers et les paysans.
Comment ce processus dynamique, dialectique, peut-il se réduire à une formule sur la maturité ou l’immaturité du prolétariat ? Un facteur colossal de la maturité du prolétariat russe, en février ou mars 1917, était Lénine. Il ne tombait pas du ciel. Il incarnait la tradition révolutionnaire de la classe ouvrière. Car, pour que les mots d’ordre de Lénine puissent trouver le chemin des masses, il fallait qu’existent des cadres, même en petit nombre, au début. Il fallait que ces cadres aient confiance dans leur direction, une confiance fondée sur l’expérience du passé. Rejeter ces éléments de ses calculs, c’est tout simplement ignorer la révolution vivante, lui substituer une abstraction, « le rapport de forces », car le développement de la révolution consiste précisément dans le changement incessant et rapide du rapport des forces sous l’impact des changements dans la conscience du prolétariat, l’attraction exercée sur les couches arriérées par les couches avancées, la confiance grandissante de la classe en ses propres forces. L’élément principal, vital, de ce processus, c’est le parti ; exactement comme le ressort vital dans le mécanisme du parti, c’est sa direction. Le rôle et la responsabilité de la direction dans une époque révolutionnaire sont colossaux.
La relativité de la « maturité »
La victoire d’Octobre constitue un sérieux témoignage de la « maturité » du prolétariat. Mais elle est relative. Quelques années plus tard, c’est ce même prolétariat qui a permis que la révolution fût étranglée par une bureaucratie issue de ses propres rangs. La victoire n’est pas du tout le fruit mûr de la « maturité » du prolétariat. La victoire est une tâche stratégique. Il est nécessaire d’utiliser les conditions favorables d’une crise révolutionnaire afin de mobiliser les masses. En partant du niveau donné de leur « maturité », il faut les lancer en avant, leur apprendre à se rendre compte que l’ennemi n’est nullement omnipotent, qu’il est déchiré de contradictions, et que derrière son imposante façade, la panique règne. Si le parti bolchevique n’avait pas réussi à mener à bien ce travail, on ne pourrait même pas parler de révolution prolétarienne. Les soviets auraient été écrasés par la contre-révolution, et les petits sages de tous les pays auraient écrit des articles ou des livres dont le leitmotiv aurait été que seuls des visionnaires impénitents pouvaient rêver, en Russie, de la dictature d’un prolétariat si faible, numériquement, et si peu mûr.
Le rôle auxiliaire des paysans
Tout aussi abstraite, pédante et fausse est la référence au « manque d’indépendance » de la paysannerie. Où et quand notre sage a-t-il vu, dans une société capitaliste, une paysannerie avec un programme révolutionnaire indépendant ou une capacité à l’initiative révolutionnaire indépendante ? La paysannerie peut jouer dans la révolution un très grand rôle, mais seulement un rôle auxiliaire.
Dans bien des cas, les paysans espagnols ont agi avec audace et combattu avec courage. Mais pour soulever la masse de la paysannerie toute entière, il aurait fallu que le prolétariat donne l’exemple d’un soulèvement décisif contre la bourgeoisie et inspire aux paysans confiance dans la possibilité de la victoire. Or l’initiative révolutionnaire du prolétariat lui-même était à chaque pas paralysée par ses propres organisations.
L’« immaturité » du prolétariat et le « manque d’indépendance » de la paysannerie ne sont des facteurs ni ultimes, ni fondamentaux dans les événements historiques. Ce qui sous-tend la conscience des classes, c’est un système de production spécifique, lequel est à son tour déterminé par le niveau de développement des forces productives. Pourquoi, dès lors, ne pas expliquer que la défaite du prolétariat espagnol a été déterminée par le bas niveau de sa technologie ?
Le rôle des personnalités
Notre auteur substitue un déterminisme mécanique au conditionnement dialectique du processus historique. D’où ses mauvaises plaisanteries sur le rôle des individus bons ou mauvais. L’histoire est un processus de lutte de classes. Mais les classes ne pèsent pas de tout leur poids de façon automatique ou simultanée. Dans le processus de la lutte, les classes créent des organes différents qui jouent un rôle important et indépendant, et sont sujets à des déformations. C’est cela qui nous permet également de comprendre le rôle des personnalités dans l’histoire. Il existe naturellement de grandes causes objectives qui ont engendré le règne autocratique de Hitler. Mais seuls de pédants et obtus professeurs de « déterminisme » pourraient nier aujourd’hui l’immense rôle historique qu’a joué Hitler lui-même. De même, l’arrivée à Petrograd de Lénine, le 3 avril 1917, a fait tourner à temps le parti bolchevique, et lui a permis de mener la révolution à la victoire.
Nos sages peuvent dire que, si Lénine était mort à l’étranger au début de 1917, la révolution d’Octobre aurait eu lieu « de la même façon ». Mais ce n’est pas vrai. Lénine constituait un des éléments vivants du processus historique. Il incarnait l’expérience et la perspicacité de la section la plus active du prolétariat. Son apparition au bon moment dans l’arène de la révolution était nécessaire afin de mobiliser l’avant-garde et de lui offrir la possibilité de conquérir la classe ouvrière et les masses paysannes. Dans les moments cruciaux de tournants historiques, la direction politique peut devenir un facteur aussi décisif que l’est celui d’un commandant en chef aux moments critiques de la guerre. L’histoire n’est pas un processus automatique. Autrement, pourquoi des dirigeants ? Pourquoi des partis ? Pourquoi des programmes ? Pourquoi des luttes théoriques ?
« Mais pourquoi diable », s’écrie notre auteur, « les masses révolutionnaires, qui ont lâché leurs anciens dirigeants, se sont-elles rangées sous les drapeaux du PC ? » La question est mal posée. Il est faux de dire que les masses avaient lâché tous leurs anciens dirigeants. Les ouvriers qui étaient auparavant liés à des organisations données ont continué à s’accrocher à elles, tout en observant et en contrôlant. D’une manière générale, les ouvriers ne rompent pas facilement avec le parti qui les a éveillés à la vie consciente. En outre, l’existence dans le Front populaire d’un système de protection mutuelle les a dupés : puisque tout le monde était d’accord, c’est qu’il devait y avoir du bon. Les masses nouvelles, fraîchement éveillées, se tournaient naturellement vers le Cominterm comme le parti qui avait réalisé la seule révolution victorieuse et qui, espérait-on, était capable de fournir des armes à l’Espagne.
Par ailleurs, le Cominterm était le champion le plus zélé de l’idée de Front populaire ; cela inspirait confiance aux couches ouvrières inexpérimentées. Au sein du Front populaire, le Cominterm était le champion le plus zélé du caractère bourgeois de la révolution : cela inspirait confiance à la petite bourgeoisie et à une partie de la moyenne bourgeoisie. Voilà pourquoi les masses « se rangèrent sous les drapeaux du PC ».
Notre auteur traite cette question comme si le prolétariat se trouvait dans un magasin bien approvisionné pour y choisir une paire de bottes neuves. Mais on sait bien que même une opération aussi simple ne se solde pas toujours par un succès. Quand il s’agit d’une nouvelle direction, le choix est très limité. Ce n’est que peu à peu, et seulement sur la base de leur propre expérience, à travers les diverses étapes, que les couches les plus larges des masses finissent par se convaincre que la nouvelle direction est plus ferme, plus sûre, plus loyale que l’ancienne. Il est certain que, dans le cours d’une révolution, c’est-à-dire quand les événements se succèdent à un rythme accéléré, un parti faible peut rapidement devenir un parti puissant, à condition seulement qu’il comprenne lucidement le cours de la révolution et possède des cadres éprouvés qui ne se laissent pas griser de mots ni terroriser par la répression. Mais il faut qu’un tel parti existe avant la révolution, dans la mesure où le processus de formation de cadres exige des délais considérables et où la révolution n’en laisse pas le temps.
La trahison du POUM
Le POUM était, en Espagne, à la gauche de tous les autres partis. Il comptait incontestablement dans ses rangs des éléments révolutionnaires prolétariens qui n’avaient pas été auparavant solidement liés à l’anarchisme. Or ce parti joua précisément un rôle funeste dans le développement de la révolution espagnole. Il n’a pas pu devenir un parti de masses parce que, pour le devenir, il lui aurait fallu auparavant démolir les autres partis et que cela n’était possible que par une lutte sans compromission, une dénonciation impitoyable de leur caractère bourgeois.
Or le POUM, tout en critiquant les anciens partis, se subordonnait à eux sur toutes les questions fondamentales. Il a participé au bloc électoral « populaire » ; il est entré dans le gouvernement qui a liquidé les comités ouvriers ; il a lutté pour reconstituer cette coalition gouvernementale ; il a capitulé à chaque instant devant la direction anarchiste ; il conduisit, en liaison avec cela, une politique fausse dans les syndicats ; il a pris une attitude hésitante et non-révolutionnaire à l’égard de l’insurrection de mai 1937.
Sous l’angle d’un déterminisme général, on peut, bien sûr, admettre que sa politique n’était pas accidentelle. Tout, dans ce monde, a une cause. Néanmoins, la série de celles qui ont donné au POUM son caractère centriste ne constitue en rien un simple reflet de l’état du prolétariat catalan ou espagnol. Deux séries causales ont avancé en direction l’une de l’autre, sous un certain angle, et, à un moment donné, sont entrées en conflit. Il est possible, en faisant entrer en ligne de compte son expérience internationale antérieure, l’influence de Moscou, celle d’un certain nombre de défaites, etc., d’expliquer politiquement et psychologiquement pourquoi le POUM a été un parti centriste. Mais cela ne modifie en rien ce caractère centriste. Ni le fait qu’un parti centriste joue inéluctablement le rôle de frein dans la révolution, qu’il doit chaque fois inévitablement se briser le crâne, et qu’il peut conduire la révolution à son écrasement. Cela ne change rien au fait que les masses catalanes étaient beaucoup plus révolutionnaires que le POUM – lequel, à son tour, était beaucoup plus révolutionnaire que sa direction. Dans ces conditions, reporter la responsabilité de la fausse politique suivie sur l’immaturité des masses, c’est s’engager dans le plus pur charlatanisme – auquel ont fréquemment recours les banqueroutiers de la politique.
La responsabilité de la direction
La falsification historique consiste à attribuer la responsabilité de la défaite espagnole aux masses ouvrières, et non aux partis qui ont paralysé, ou purement et simplement écrasé, le mouvement révolutionnaire des masses. Les avocats du POUM contestent tout simplement le fait que les dirigeants portent quelque responsabilité que ce soit, afin d’éviter d’avoir à assumer leurs propres responsabilités. Cette philosophie de l’impuissance, qui cherche à faire accepter les défaites comme de nécessaires anneaux dans la chaîne des développements cosmiques, est parfaitement incapable de poser, et se refuse à poser, la question du rôle des facteurs aussi concrets que les programmes, les partis, les personnalités qui furent les organisateurs de la défaite. Cette philosophie du fatalisme et de la prostration est diamétralement opposée au marxisme, théorie de l’action révolutionnaire.
La guerre civile est un processus au cours duquel les tâches politiques sont résolues par des moyens militaires. Si l’issue d’une telle guerre était déterminée par l’« état des forces de classe », la guerre elle-même ne serait pas nécessaire. La guerre a sa propre organisation, ses propres méthodes, sa propre direction, qui déterminent directement son issue. Naturellement, l’« état des forces de classes » sert de fondement à tous les autres facteurs politiques. Mais, de même que les fondations d’un immeuble ne diminuent pas l’importance que peuvent avoir les murs, les fenêtres, les portes, les toits, de même l’« état des forces de classes » ne diminue en rien l’importance des partis, de leur stratégie et de leur direction. En dissolvant le concret dans l’abstrait, nos sages se sont en réalité arrêtés à mi-chemin. La réponse la plus « profonde » au problème posé aurait été de déclarer que la défaite du prolétariat espagnol était due au développement insuffisant des forces productives. Mais une telle explication est à la portée de n’importe quel imbécile.
En réduisant à zéro la signification du parti et de sa direction, ces sages nient la possibilité d’une victoire révolutionnaire en général. Car il n’y a pas la moindre raison d’espérer des conditions plus favorables. Le capitalisme a cessé de progresser, le prolétariat n’augmente plus en nombre ; c’est au contraire l’armée des chômeurs qui augmente, ce qui n’accroît pas, mais réduit la puissance de combat du prolétariat, et produit également dans sa conscience un effet négatif. De même, il n’y a aucune raison de croire que la paysannerie soit capable, sous le régime capitaliste, d’atteindre une conscience révolutionnaire plus élevée. La conclusion de l’analyse de notre auteur est donc le plus total pessimisme, l’abandon progressif des perspectives révolutionnaires. Mais, pour être justes, il faut ajouter que nos sages ne comprennent même pas eux-mêmes ce qu’ils disent.
En fait, ce qu’ils réclament de la conscience des masses est absolument fantastique. Les ouvriers espagnols, de même que les paysans espagnols, ont donné le maximum de ce que les classes sont capables de donner dans une situation révolutionnaire. Nous pensons ici précisément à la classe de millions et de dizaines de millions.
Mais Que faire ? ne représente qu’une de ces petites écoles, églises ou chapelles qui, effrayées par la montée de la réaction, publient leurs petits journaux et leurs revues théoriques dans leur petit coin, sur la touche, loin des développements réels de la pensée révolutionnaire, pour ne pas parler du mouvement des masses.
Répression de la révolution espagnole
Le prolétariat espagnol a été victime d’une coalition formée des impérialistes, des républicains espagnols, des socialistes, des anarchistes, des staliniens, et, sur le flanc gauche, du POUM. A eux tous, ils ont paralysé la révolution socialiste que le prolétariat espagnol avait commencé à réaliser. Il n’est pas facile de venir à bout d’une révolution socialiste. Personne n’a encore trouvé pour cela d’autres méthodes que la répression féroce, le massacre de l’avant-garde, l’exécution des dirigeants, etc. Le POUM, bien sûr, ne voulait pas cela. Il voulait, d’une part, participer au gouvernement républicain et s’intégrer, comme une opposition pacifique et loyale, dans le bloc général des partis dirigeants. D’autre part, il voulait entretenir avec eux de paisibles relations de camaraderie à une époque de guerre civile implacable. C’est précisément pour cela qu’il a été victime des contradictions de sa propre politique.
A l’intérieur du bloc républicain, ce sont les staliniens qui ont suivi la politique la plus cohérente. Ils ont constitué l’avant-garde combattante de la contre-révolution bourgeoise-républicaine. Ils voulaient éliminer la nécessité du fascisme, en prouvant à la bourgeoisie espagnole et mondiale qu’ils étaient capables d’étrangler eux-mêmes la révolution espagnole sous le drapeau de la « démocratie ». C’était l’essence de leur politique. Les banqueroutiers du Front populaire espagnol essaient aujourd’hui de rejeter le blâme sur le GPU. On ne peut nous suspecter d’indulgence à l’égard des crimes du GPU. Mais nous voyons clairement, et nous disons aux travailleurs, que le GPU en la circonstance n’a agi qu’en qualité de détachement le plus résolu au service du Front populaire. C’est là que résidait la force du GPU. C’est en cela que consistait le rôle historique de Staline. Seul un philistin ignorant peut écarter cette réalité par de petites plaisanteries stupides sur le « Démon en chef ».
Ces messieurs ne se posent même pas la question du caractère social de la révolution. Les laquais de Moscou, pour le compte de l’Angleterre et de la France, ont proclamé que la révolution espagnole était une révolution bourgeoise. C’est sur cette fraude qu’a été bâtie la politique perfide du Front populaire, politique qui aurait en outre été complètement fausse même si la révolution espagnole avait été réellement une révolution bourgeoise. Mais, dès le début, la révolution a manifesté avec beaucoup plus de netteté que la révolution de 1917, en Russie, son caractère prolétarien. Il y a aujourd’hui à la direction du POUM des gens qui trouvent que la politique d’Andrés Nin a été trop « gauchiste », que la ligne vraiment correcte aurait été de demeurer le flanc gauche du Front populaire. Le vrai malheur, c’est que Nin, se couvrant de l’autorité de Lénine et de la révolution d’Octobre, ne pouvait se faire à l’idée de rompre avec le Front populaire.
Victor Serge, qui est toujours pressé de se compromettre, par sa frivolité, sur toutes les questions sérieuses, écrit que Nin ne voulait pas se soumettre à des ordres venus d’Oslo ou Coyoacan [c’est-à-dire de Trotsky, ndlr]. Un homme sérieux peut-il réellement réduire à des commérages aussi mesquins la question du contenu de classe de la révolution ? Les sages de Que faire ? n’ont aucune espèce de réponse à donner à cette question. Ils ne comprennent même pas la signification de la question elle-même. Quelle peut être, au vrai, la signification du fait que le prolétariat, « qui manquait de maturité », a créé ses propres organes de pouvoir, tenté de régler la production après s’être emparé des entreprises, cependant que le POUM s’employait de toutes ses forces à ne pas rompre avec les anarchistes bourgeois qui, alliés aux républicains bourgeois et aux non moins bourgeois socialistes et staliniens, attaquaient et étranglaient la révolution prolétarienne ? De telles bagatelles n’offrent évidemment d’intérêt que pour des représentants d’une « orthodoxie desséchée ». Les sages de Que faire ? possèdent, à la place, un instrument spécial qui leur permet de mesurer la maturité du prolétariat et le rapport des forces, indépendamment de toutes les questions de stratégie révolutionnaire de classe…
Eté 1939