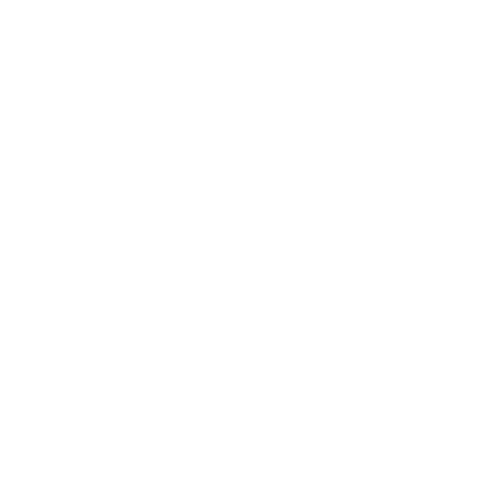Nous publions ci-dessous la première partie de nos Perspectives mondiales 2016. La deuxième partie sera publiée très prochainement. Ce document sera discuté, amendé et adopté lors du Congrès mondial de la Tendance Marxiste Internationale, fin juillet.
L’année 2016 a été inaugurée par un effondrement brutal du marché chinois, effondrement qui s’est rapidement propagé à travers le globe, trahissant un sentiment de panique chez les investisseurs. Cette nervosité exprime les craintes de la bourgeoisie de voir le monde se diriger vers une nouvelle récession. L’histoire du capitalisme est faite d’une succession de phases d’expansion et de récessions. Ce cycle continuera jusqu’à la fin du capitalisme, tout comme une personne inspire et expire jusqu’à sa mort. Cependant, en plus de ces cycles, on peut distinguer des périodes plus longues, des courbes de développement puis de déclin. Chaque période connait différentes caractéristiques qui ont des effets décisifs sur la lutte des classes.
Certains, comme Kondratiev et ses imitateurs modernes, ont essayé d’expliquer de façon mécanique l’évolution de l’économie capitaliste. Les idées de Kondratiev sont à la mode, ces temps-ci, parce qu’elles présupposent que chaque période de crise sera inévitablement suivie d’une longue période de croissance. Cette idée fournit un peu de réconfort aux économistes bourgeois, qui ont des maux de tête à force d’essayer de comprendre la nature de la crise – et comment en sortir.
La situation mondiale actuelle est caractérisée par une crise à tous les niveaux : économique, financier, social, politique, diplomatique et militaire. La cause principale de cette crise réside dans l’incapacité du capitalisme à développer les forces productives à l’échelle mondiale. L’OCDE prévoit qu’il n’y aura pas de retour à une croissance significative avant au minimum une cinquantaine d’années. Des phases de croissance et de récessions vont continuer de se succéder, mais la tendance générale sera à la baisse. Cela signifie que les masses vont devoir faire face à des décennies de stagnation – ou de recul – de leurs conditions de vie. La situation sera pire dans les pays dits « en voie de développement ». C’est la recette parfaite pour une intensification de la lutte des classes, partout.
La menace d’une nouvelle récession
Les experts capitalistes les plus sérieux ont tendance à tirer les mêmes conclusions que les marxistes, mais avec un certain retard – et du point de vue de leur propre classe. Le pessimisme des économistes bourgeois est illustré par le fait qu’ils annoncent une période de « stagnation séculaire ». Le FMI souligne que la crise financière mondiale fut pire que tous les précédents épisodes de turbulences. Il ajoute que la majorité des grandes économies du monde doivent se préparer à une longue période de faibles taux de croissance.
Les rapports du FMI sont pessimistes et ses prévisions régulièrement revues à la baisse. Par rapport aux pronostics réalisés en 2012, le FMI a dernièrement diminué ses prévisions de croissance, pour 2020, du PIB américain de 6 % ; de 3 % pour l’Europe ; de 14 % pour la Chine ; de 10 % pour les économies émergentes et de 6 % pour le monde entier. La croissance dans les pays industrialisés n’a pas dépassé les 2 % ces quatre dernières années.
Le FMI estime que la croissance à long terme dans les pays riches approchera seulement les 1,6 % entre 2015 et 2020, comparés aux 2,2 % entre 2001 et 2007. Bien sûr, cela suppose qu’il n’y aura pas de récession d’ici là, ce qu’il est précisément impossible d’affirmer. En fait, tout indique qu’une nouvelle et profonde récession mondiale pourrait éclater.
Selon Christine Lagarde, directrice du FMI, « les perspectives à moyen terme se sont affaiblies. La “nouvelle médiocrité” – le risque d’une longue phase de faible croissance, contre lequel je vous mettais en garde il y a exactement un an – s’approche. […] Certains pays avancés, notamment en Europe, restent aux prises avec les conséquences d’un endettement élevé, d’un faible niveau d’investissement et de banques en difficultés ; et beaucoup de pays émergents vivent encore à l’heure des ajustements, au sortir du boom du crédit et de l’investissement de l’après-crise. »
Christine Lagarde prévient que le ralentissement en Chine pourrait avoir des répercussions dans les pays dont l’économie dépend fortement de la demande chinoise en matières premières. Elle a déclaré qu’une période prolongée de faibles prix de ces matières premières était possible, notamment dans les grands pays exportateurs. Elle accuse la faible productivité de miner la croissance potentielle. Mais cette explication n’explique rien.
« Les risques augmentent », prévient Lagarde. « Il nous faut une nouvelle recette ». Malheureusement, elle ne nous éclaire pas sur ce que devrait être cette nouvelle recette. Mais le FMI garde son livre de cuisine ouvert à la page d’une recette bien connue : celle qui consiste à demander aux dirigeants des « marchés émergents » de « mettre en œuvre des réformes structurelles », c’est-à-dire d’ouvrir leurs marchés pour qu’ils soient pillés par les capitalistes étrangers, de privatiser les entreprises publiques et de rendre le marché du travail plus « flexible ». Cela signifie prendre des mesures qui mèneront à de nouvelles attaques contre les emplois, les salaires et les conditions de travail.
Au cœur de la crise se trouve la baisse de l’investissement productif, lequel est la clé de toute expansion économique. Les dépenses d’investissement devraient demeurer sous leur niveau d’avant la crise, même si la faible reprise économique actuelle se poursuivait. Ceci signifie que le système capitaliste a atteint ses limites à l’échelle mondiale, et qu’il les a même largement dépassées. Ce fait est illustré par la montagne de dettes accumulées, héritées de la période qui vient de s’écouler. Pendant plusieurs années, les multinationales ont frénétiquement investi dans les « économies émergentes ». Ce phénomène se ralentit aujourd’hui à cause de la surproduction (« surcapacité ») qui affecte ces économies.
Les capitalistes ont perdu confiance dans leur système. Ils sont assis sur des montagnes de milliers de milliards de dollars. Quel intérêt ont-ils à investir pour augmenter la production, alors qu’ils ne peuvent même pas utiliser toute la capacité productive existante ? La baisse de l’investissement signifie aussi une stagnation de la productivité. La productivité aux États-Unis progresse à un rythme annuel pitoyable : 0,6 %. Les capitalistes n’investissent que pour faire des profits, mais cela suppose l’existence de marchés pour y vendre leurs produits. La cause fondamentale du manque d’investissement réside dans l’existence d’une crise de surproduction mondiale.
Au lieu d’investir dans de nouvelles usines, dans l’outillage ou la technologie, les capitalistes tentent de stimuler la productivité en baissant les salaires dans une course au nivellement par le bas, sur tous les plans. Mais cela ne fait qu’exacerber davantage la contradiction en réduisant la demande, qui à son tour conduit à faire davantage chuter l’investissement.
La croissance potentielle dans les pays capitalistes avancés est estimée à 1,6 % par an entre 2015 et 2020, selon les prévisions du FMI. C’est légèrement plus que le taux de croissance de ces sept dernières années, mais significativement moins que les taux de croissance d’avant la crise, quand la croissance potentielle pouvait atteindre jusqu’à 2,25% par an. Ce chiffre lui-même était déjà insignifiant compte tenu du potentiel colossal de l’industrie moderne, de la science et de la technologie. À présent, l’économie tourne au ralenti, et même les perspectives du FMI pourraient s’avérer optimistes.
La chute des prix et les faibles taux d’intérêt, qui sont de bonnes nouvelles en temps normal, deviennent à présent un danger mortel. Ils sont le reflet de la stagnation économique et de la chute de la demande. Les taux d’intérêt ont continuellement chuté ces dix dernières années. Ils sont devenus nuls – et même devenus négatifs. Selon l’économiste en chef de la Banque britannique Andy Haldane, ils ont atteint leur taux le plus bas depuis… 5000 ans.
Une croissance faible, ajoutée à une faible inflation et à des taux d’intérêts proches de zéro, représentent ce que les économistes bourgeois appellent une « stagnation séculaire ». Le moteur économique des économies industrialisées tourne au ralenti, au risque de caler. Cette situation ne peut pas durer longtemps. Selon les stratèges du capital, l’économie globale est confrontée à des dangers plus graves encore qu’après la faillite de la banque Lehman Brothers, en 2008.
Dans son discours de septembre 2015, Andy Haldane a très bien exprimé les craintes de la bourgeoisie : il avertit que « les récents événements constituent le dernier épisode d’une crise en trois étapes qu’on pourrait qualifier de trilogie. Le premier épisode de cette trilogie a été la crise anglo-saxonne de 2008-2009 ; le deuxième, la crise européenne de 2011-2012. Et nous pourrions désormais entrer dans les premiers stades de la troisième partie de la trilogie, la crise des « marchés émergents » de 2015 ».
Le problème des bourgeois, c’est qu’ils ont déjà épuisé tous les mécanismes qui existent pour sortir d’une crise ou limiter ses impacts. Quand la prochaine crise surviendra (la question est quand, et non si elle finira par arriver), ils manqueront d’outils pour y répondre. Les taux d’intérêt restent très bas, et le poids de plus en plus lourd de la dette interdit aux États de recourir à des dépenses publiques massives. Comme le déclare évasivement Martin Wolf : « Les instruments pour faire face à la situation ne sont pas mobilisables facilement ».
La dette mondiale et les BRICs
La dette mondiale a augmenté depuis le début de la crise. Le rétablissement financier tant espéré n’a eu lieu qu’en quelques endroits isolés de l’économie mondiale, et la dette a atteint des records. Jamais, en temps de paix, le déficit public n’a atteint de tels niveaux ; la dette des ménages et celle des entreprises n’ont également jamais été aussi élevées. Avant la crise, la dette augmentait partout : aux États-Unis elle atteignait 160 % du PIB en 2007 – et presque 200 % en Grande-Bretagne. En 2009, au Portugal, elle s’élevait à 226,7 % du PIB et se maintenait à 220,4 % en 2013. Actuellement, la dette totale des États-Unis représente 269 % du PIB, ce qui n’avait été le cas qu’une seule fois dans l’Histoire, vers 1933. Elle était alors de 258 %, et chuta ensuite rapidement à 180 %.
L’objectif des politiques d’austérité était de réduire le volume de la dette, notamment de la dette publique. Mais les chiffres montrent que c’est loin d’être une réussite : on peut ainsi lire dans le rapport du McKinsey Global Institute de février 2015 que la dette mondiale a enflé de 57 000 milliards de dollars depuis 2007, passant de 269 % à 286 % du PIB mondial. Cela se produit dans tous les secteurs de l’économie mondiale, mais surtout au niveau de la dette publique, qui croît de 9,3 % par an. Cette croissance de la dette (« effet de levier ») a également lieu dans quasiment chaque pays pris individuellement. Seuls quelques pays, dépendants de la Chine ou des prix du pétrole, parvenaient à réduire leur niveau d’endettement, phénomène qui a brutalement pris fin au cours des deux dernières années. Cette accumulation de dette est un fardeau pour l’économie mondiale ; elle étouffe la demande et tire la production vers le bas.
Même les économies dites des « BRICs » (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont en crise. Le Brésil et la Russie se trouvent en plein marasme économique. Le ralentissement sur les marchés dits « émergents » devrait même être encore plus sévère que dans les pays capitalistes avancés. Si leur économie a continué de croître au début de la crise, le FMI prédit que la croissance potentielle des BRICs devrait baisser de 6,5 % (taux de croissance annuel de 2008 à 2014), à 5,2 % pour les cinq prochaines années.
La croissance de ces économies est un des facteurs qui ont empêché que la crise de 2008 ne se transforme en un effondrement économique mondial. Sur les cinq dernières années, les économies dites « émergentes » ont contribué à hauteur de 80 % à la croissance mondiale. Ces marchés, et en particulier la Chine, ont joué un rôle de locomotive pour l’économie mondiale avant et après la crise. Ils ont constitué un terrain d’investissement très important au moment où les débouchés rentables se raréfiaient en Occident.
Ce processus s’est aujourd’hui inversé : de soutien au capitalisme mondial, les économies « émergentes » sont devenues le principal danger qui menace de tirer vers le bas l’ensemble de l’économie mondiale. La dette n’a pas explosé seulement dans les économies développées traditionnelles, mais également dans les pays « émergents ». Selon le rapport de McKinsey, la dette des marchés « émergents » a atteint 49 000 milliards de dollars à la fin 2013, contribuant pour 47 % à l’augmentation de la dette mondiale depuis 2007 ; c’est plus de deux fois sa part dans la croissance de la dette mondiale entre 2000 et 2007.
Selon le FMI, les réserves en devises étrangères détenues par les pays « émergents » (un indicateur clef des flux de capitaux), en 2014, ont enregistré leur première baisse depuis 1995 (date de leur premier enregistrement statistique). Ces flux sont comparables à une transfusion sanguine pour un malade ; sans un flux constant de capital, les économies dites « émergentes » ne pourront pas payer leur dette, ni financer les déficits liés aux investissements dans les infrastructures et dans le développement de la production.
La BBC cite également des chiffres du Centre International d’Études Monétaires et Bancaires (ICMBS) :
« Depuis [2008], c’est le monde en développement, particulièrement la Chine, qui a été le moteur de l’augmentation de la dette. Dans le cas chinois, le rapport évoque une augmentation « sidérale » de la dette : hors compagnies financières, elle a augmenté de 72 points, atteignant un niveau plus élevé que dans n’importe quelle autre économie émergente. Le rapport indique également des augmentations importantes en Turquie, en Argentine et en Thaïlande. »
Les économies émergentes sont particulièrement inquiétantes pour les auteurs de ce rapport : « Elles pourraient être l’épicentre de la prochaine crise. Bien que l’effet de levier soit plus important sur les marchés développés, sa vitesse de mise en œuvre dans les économies émergentes, et surtout en Asie, est une préoccupation grandissante. »
Certains des plus importants flux de capitaux proviennent de pays qui ont accumulé des dettes le plus rapidement. La Corée du Sud a ainsi vu sa dette augmenter de 45 % entre 2007 et 2013, alors que la Chine, la Malaisie, la Thaïlande et Taïwan ont connu des hausses respectives de 83 %, 49 % et 16 %.
Ces économies sont également en train de ralentir, voire sont déjà en récession, préparant ainsi un effondrement économique mondial.
Turbulences en Chine
Encore plus grave, l’économie chinoise connaît un net ralentissement. Le ralentissement des économies dites émergentes est dû, d’une part, à la baisse de la demande dans les économies capitalistes avancées, et d’autre part, au déclin de la Chine. Cet état de fait entraînera une faiblesse durable du commerce mondial. Dialectiquement, tout est interconnecté en un cercle vicieux, de telle façon qu’une faible demande et la fragilité des marchés conduisent à une baisse de la production et à un investissement en berne ; ce faible investissement entraîne une reprise atone qui, à son tour, conduit à une faible demande, et ainsi de suite.
La croissance industrielle explosive de la Chine peut être illustrée par les statistiques montrant qu’entre 2010 et 2013 elle a produit plus de béton que les États-Unis n’en ont produit pendant tout le XXe siècle. Mais les énormes capacités productives de l’industrie chinoise ne sont pas accompagnées d’une croissance correspondante de la demande mondiale. Le résultat inévitable de cette situation, c’est une crise de surproduction.
Jusqu’en 2007, la demande mondiale était soutenue par le crédit et la construction immobilière, en particulier aux États-Unis et en Espagne. Puis c’est la Chine qui a pris le relais, déversant des milliards dans les infrastructures et les prêts bancaires. Plus de 40 % du PIB a été investi, ce qui a renforcé les forces productives et la demande de matières premières, accroissant la « surcapacité » productive.
L’éclatement de la bulle en Occident, en 2008, a conduit la Chine à injecter d’énormes quantités de liquidités dans son économie, ce qui, en retour, a créé une énorme bulle spéculative et une accumulation massive de dettes à tous les niveaux de l’économie chinoise. Cette bulle est sur le point d’éclater, avec des conséquences d’une grande portée. La Chine suit le même chemin que le Japon, celui de la stagnation prolongée. Le ralentissement chinois a débouché, entre autres, sur un effondrement des prix des marchandises, qui a frappé de plein fouet les économies émergentes. Plus généralement, la Chine représente 16 % de la production mondiale et 30 % de la croissance mondiale. Quand la Chine ralentit, le monde ralentit.
La surproduction en Chine affecte la production d’acier et d’autres biens manufacturés. Il y a eu une accumulation massive de dettes et les observateurs redoutent un effondrement du secteur immobilier, qui est en surchauffe. Plus de 1000 mines de minerai de fer sont au bord de la banqueroute. Le Financial Times affirme : « La Chine, en particulier, pourrait connaître une forte contraction de la croissance potentielle de sa production, alors qu’elle essaie de rééquilibrer son économie vers la consommation et non plus vers l’investissement ».
Le Premier Ministre chinois, Li Keqiang, a expliqué à l’ambassadeur des États-Unis qu’il comptait sur trois choses pour juger de la croissance économique : la consommation d’électricité, le volume du fret ferroviaire et les prêts bancaires. Les économistes du Fathom Consulting Group ont réalisé une compilation de ces trois données, appelée « Indicateur dynamique de la Chine ». Cet indicateur montre que le rythme de croissance actuel du pays pourrait être de 2,4 %. Les volumes de fret ferroviaire reculent et la courbe de la consommation d’électricité est pratiquement plate. Suite au recul de la croissance, la Chine a baissé ses taux d’intérêts six fois au cours des douze derniers mois. Elle a également dévalué sa monnaie pour relancer ses exportations, ce qui intensifie le conflit avec les États-Unis et créé partout une instabilité massive.
Le ralentissement de la croissance chinoise a touché les économies émergentes, en particulier celles qui dépendaient fortement de la Chine. Les craintes d’un ralentissement de la Chine se sont faites sentir en Chine même, avec la chute des marchés boursiers. Les autorités sont intervenues à hauteur de 200 milliards de dollars pour tenter de stabiliser le marché, puis ont renoncé. La panique a gagné les investisseurs. « Si nous ne réformons pas, l’économie chinoise pourrait bien ralentir jusqu’à l’effondrement », affirme Tao Ran, professeur d’économie à l’université de Beijing. « Tout ce que nous avons accompli ces 20 ou 30 dernières années serait alors perdu ».
La division « Recherche » de la seconde plus grosse maison de courtage du Japon, Daiwa, a rédigé un rapport prévoyant, comme le plus probable des scénarios, un effondrement financier mondial. Cet effondrement résulterait d’un cataclysme économique venu de Chine. Son impact serait « le pire que le monde ait jamais vu ».
Le commerce mondial
La plus grande menace pesant sur l’économie mondiale est la réémergence de tendances protectionnistes. Au cours des dernières décennies, l’économie mondiale a été principalement tirée par la croissance du commerce mondial et l’intensification de la division internationale du travail (« mondialisation »). Ainsi, les capitalistes avaient partiellement réussi, pendant un temps, à surmonter les limites des États-nations. A présent, le processus s’inverse.
Un exemple flagrant en est l’Union Européenne, que les bourgeoisies européennes (dirigées au début par la France et l’Allemagne, puis par l’Allemagne seule) ont essayé d’unifier dans un marché unique, avec une monnaie unique : l’euro. Les marxistes avaient prédit que ce projet était voué à l’échec et que les vieilles rivalités nationales – simplement cachées par le marché unique – referaient surface à l’occasion d’une grave crise économique.
La crise de l’euro, dont le cours a plongé par rapport au dollar, témoigne de la gravité de la crise économique. La crise grecque n’est que l’expression la plus évidente d’une crise qui peut mener à l’effondrement de l’euro, voire de l’Union Européenne (UE). Un tel développement aurait les pires conséquences pour l’économie mondiale. C’est la raison pour laquelle Obama exhorte les Européens à trouver coûte que coûte une solution à la crise grecque. Il comprend que l’effondrement de l’UE mènerait à une crise aux États-Unis.
2015 prend place dans une série de cinq années consécutives de baisse de la croissance moyenne des « économies émergentes », entraînant la croissance mondiale sur la même pente. Avant 2008, le volume des échanges mondiaux augmentait de 6 % par an, selon l’Organisation Mondiale du Commerce. Au cours des trois dernières années, ce chiffre est tombé à 2,4 % par an – et les six premiers mois de 2015 ont enregistré la pire performance depuis 2009.
Par le passé, le commerce mondial était l’un des principaux facteurs de la croissance ; ce n’est plus le cas. Depuis 2013, chaque point de croissance mondiale n’a été accompagné que de 0,7 % de croissance des échanges commerciaux. Aux États-Unis, la part des importations de produits manufacturés dans le PIB n’a pas augmenté depuis 2000, alors qu’elle avait presque doublé au cours de la décennie précédente.
Le constat est sans appel : la « mondialisation » ralentit. Le commerce mondial, moteur de la croissance économique, est en train de caler. Le volume des échanges mondiaux a chuté de 1,2 % en mai 2015, et de 4% sur les cinq premiers mois de 2015. Les négociations de Doha, qui duraient depuis 14 ans, ont été abandonnées. A la place, les États-Unis essayent de développer des blocs régionaux de libre-échange, dans l’intérêt de leur propre impérialisme. Ils ont ainsi négocié le TPP (Trans Pacific Partnership) qui pourrait concerner jusqu’à 40 % de l’économie mondiale, mais est miné de contradictions. La ratification de ce traité par de nombreux pays, dont les États-Unis, est loin d’être acquise : Obama doit notamment faire face à l’hostilité du Congrès et pourrait ne pas obtenir la ratification du texte avant la fin de son mandat.
Inégalités
La concentration du capital prédite par Marx a atteint des niveaux sans précédent, engendrant des inégalités vertigineuses. Un pouvoir énorme est concentré entre les mains d’une infime minorité de super-riches, qui contrôlent la vie et le sort du reste du monde.
Les jeunes, les femmes et les minorités ethniques souffrent tout particulièrement de la crise. Les travailleurs noirs et asiatiques (en Europe) ou les Mexicains et immigrés latino-américains (aux États-Unis) sont les premiers à être licenciés ou à voir leur salaire baisser. La crise aggrave les inégalités et les discriminations de genre, tout en nourrissant une atmosphère de racisme, de xénophobie et d’intolérance envers les minorités, dans les couches les moins conscientisées de la population.
La jeunesse fait face aux perspectives économiques les plus sombres depuis plusieurs générations, comme le reconnaissent tous les économistes bourgeois. Le chômage et les bas salaires frappent particulièrement les jeunes. L’éducation publique – à tous les niveaux – est impitoyablement démantelée et privatisée dans l’intérêt du capital financier. L’université devient toujours plus l’apanage d’une minorité privilégiée.
La majorité des jeunes se voit privée de droits et d’opportunités qui étaient jusque-là considérés comme acquis. C’est une cause fondamentale d’instabilité et pourrait entraîner des explosions sociales ; c’était l’un des facteurs principaux de ce qui fut appelé le « printemps arabe ». De tels soulèvements de la jeunesse auront lieu dans d’autre pays.
Partout, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches. Selon un rapport de l’organisation Oxfam, la part de richesses mondiales détenue par les 1 % les plus riches est passée de 44 % en 2009 à 48 % en 2014, alors que les 80 % les plus pauvres « possèdent » seulement 5,5 % des richesses mondiales. Fin 2015, les 1 % les plus riches détenaient déjà 50,4 % des richesses, soit plus que l’ensemble des 99 % restants.
Les capitalistes les plus intelligents sont conscients du danger que représente cette polarisation, du point de vue de la survie de leur système. L’OCDE souligne que des problèmes politiques et sociaux s’ajoutent aux problèmes économiques. Winnie Byanyima, directrice générale d’Oxfam international, explique que l’exacerbation de la concentration des richesses à laquelle on assiste depuis la récession de 2008-2009 est « dangereuse et doit être contrebalancée ».
Les réformistes bien-pensants enjoignent aux dirigeants mondiaux de s’attaquer au problème des inégalités, de la discrimination et de l’exclusion sociale, ainsi qu’au changement climatique et à tous les défis auxquels l’humanité fait face. Cependant, ils n’expliquent jamais comment ce genre de miracle est censé se produire sous le capitalisme : les sommets, conférences et discours se succèdent, des résolutions sont prises… Et rien ne change.
Austérité permanente
Les perspectives sont les suivantes : une longue période de récessions entrecoupées de phases de faible croissance, sur fond d’austérité permanente. C’est une situation nouvelle, totalement différente de ce que les pays capitalistes avancés ont connu au cours du demi-siècle qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Les conséquences politiques seront donc aussi totalement différentes.
Nous avons souvent expliqué que chaque tentative de la bourgeoisie de restaurer l’équilibre économique se solderait par une destruction de l’équilibre politique et social. C’est précisément ce qui se passe à l’échelle mondiale : une récession prolongée entraîne de profondes difficultés économiques et perturbe les anciens équilibres. Les vieilles certitudes se fissurent et on assiste à une remise en cause générale du statu quo, de ses valeurs et de ses idéologies.
Depuis les débuts de la crise de 2008, plus de 61 millions d’emplois ont été détruits. Selon les estimations de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le nombre de personnes sans-emploi continuera de croître sur les cinq prochaines années, pour atteindre plus de 212 millions en 2019. L’OIT indique que « l’économie mondiale est entrée dans une nouvelle période combinant un ralentissement de la croissance, une aggravation des inégalités et des turbulences. » Si l’on ajoute le nombre élevé de personnes travaillant dans le secteur « informel », on atteint le chiffre d’au moins 850 millions de sans-emplois à l’échelle mondiale. Cela suffit à démontrer que le capitalisme est devenu un intolérable obstacle au progrès.
Dans les pays capitalistes avancés, les gouvernements tentent de réduire les dettes accumulées pendant la crise en coupant dans les salaires et les pensions. Mais ces politiques d’austérité n’ont fait que réduire drastiquement les niveaux de vie sans avoir aucun véritable effet sur l’endettement. Tous les douloureux sacrifices infligés aux masses, ces sept dernières années, ont échoué à résoudre la crise ; pire, ils l’ont aggravée.
Ni les keynésiens, ni les monétaristes orthodoxes n’ont de solution. Le niveau de la dette, déjà intolérable, continue d’augmenter inéluctablement, entravant toute croissance. Les gouvernements et entreprises essayent de faire peser ce fardeau sur les épaules des classes ouvrières et des classes moyennes. Ceci a de profonds effets sur les relations sociales et la conscience de toutes les classes.
Effets politiques de la crise
Néanmoins, nous sommes ici confrontés à un paradoxe à première vue inexplicable. Jusqu’à très récemment, les banquiers et les capitalistes se félicitaient d’avoir réussi à traverser la plus grave crise économique de l’Histoire sans provoquer de révolution. Ce résultat surprenant a développé chez eux une arrogante complaisance, toute aussi déplacée que stupide.
Le principal problème de ces individus est qu’il leur manque la plus élémentaire compréhension de la dialectique, laquelle explique que, tôt ou tard, tout se transforme en son contraire. Sous le calme apparent de la surface, la colère grandit, contre les élites politiques, contre les riches, les puissants, les privilégiés. Cette réaction contre le statu quo contient les germes de développements révolutionnaires.
Le matérialisme dialectique souligne que la conscience humaine est généralement en retard sur les événements. Mais tôt ou tard, elle rattrape ce retard avec fracas : c’est précisément la définition d’une révolution. Nous assistons dans de nombreux pays aux débuts d’un changement révolutionnaire dans la conscience politique, changement qui ébranle profondément les institutions et les partis de l’establishment. Il est vrai que la conscience est en grande partie façonnée par les événements passés ; il faudra donc du temps pour que les vieilles illusions réformistes soient éliminées de la conscience des masses. Mais les coups de massue des événements provoqueront de puissants et soudains changements dans les consciences. Malheur à ceux qui se réfèrent uniquement à la connaissance d’un passé depuis longtemps révolu ! Les marxistes doivent se baser sur les processus en cours et les perspectives à venir, qui ne ressembleront en rien à ce que nous avons vécu jusqu’à maintenant.
Dans leur recherche d’une sortie de crise, les masses mettent à l’épreuve les partis politiques, les uns après les autres. Les vieux dirigeants et leur programme sont passés au crible, puis rejetés. Les partis qui, une fois élus, violent leurs promesses et trahissent les espoirs des gens, subissent rapidement le même sort. Les idéologies autrefois dominantes sont abandonnées ; les dirigeants autrefois adulés deviennent des objets de haine. Des changements radicaux sont à l’ordre du jour.
Il y a une révolte croissante contre les classes dirigeantes et leurs appendices. La population ne croit plus aux discours ou aux promesses des politiciens ; les désillusions envers l’ordre politique et les partis augmentent. Un malaise général et profond s’ancre dans la société, mais il lui manque un véhicule capable de lui donner une forme organisée.
En France, où le Parti Socialiste a remporté les dernières élections présidentielles, François Hollande est le président le plus impopulaire depuis 1958. Le Parti Socialiste a d’ailleurs essuyé une sévère défaite lors des dernières élections régionales. La Grèce a vu l’effondrement du Pasok et la montée de Syriza ; l’Espagne, le phénomène Podemos ; l’Ecosse, le SNP ; et la Grande-Bretagne assiste à l’ascension de Jeremy Corbyn. Tout ceci témoigne d’un profond mécontentement populaire à la recherche d’une expression politique. À travers l’Europe se répand la peur que les politiques d’austérité ne soient pas simplement des ajustements temporaires, mais bien une attaque permanente contre le niveau de vie. Dans des pays tels que la Grèce, le Portugal et l’Irlande, ces politiques ont déjà mené à des coupes drastiques dans les salaires et les pensions, sans avoir pour autant résolu le problème du déficit : c’est donc en vain que la population a enduré souffrances et privations.
Le même processus a eu lieu lors du récent référendum irlandais sur le mariage gay. Pendant des siècles, l’Irlande a compté parmi les pays les plus catholiques d’Europe ; il n’y a pas si longtemps, l’Église contrôlait encore chaque aspect de la vie quotidienne. Les 67 % en faveur du mariage gay ont été un véritable coup de poing porté à l’Église catholique romaine. Il s’agit d’une contestation massive de son pouvoir et de son ingérence dans la vie politique et quotidienne. Ceci constitue un changement fondamental pour la société irlandaise.
Les États-Unis
Les États-Unis sont le seul pays à avoir connu un certain redressement économique depuis 2008-2009, bien qu’il reste faible et anémique. La plus grande partie de la croissance enregistrée l’année dernière est due à l’accumulation des stocks invendus. En réalité, la croissance ralentit aux États-Unis comme elle a ralenti en Europe et au Japon. Depuis juillet 2015, le FMI a ponctué ses prévisions de signes moins : il ne reste plus rien du redressement tant vanté.
La faiblesse de l’économie mondiale, et, en première ligne, des économies dites « émergentes », a sévèrement bousculé la stabilité du dollar, pourtant toujours considéré comme une valeur refuge en temps de crise. Mais la force du dollar elle-même représente un problème pour les États-Unis, car elle donne un avantage compétitif à leurs rivaux et freine les exportations américaines. L’an dernier, les exportations et importations depuis et vers les États-Unis ont chuté, témoignant de la faiblesse générale de l’économie mondiale.
La crise polarise la société américaine. L’administration Obama est perçue comme un échec. L’écho que les messages anti-establishment de Donald Trump et Bernie Sanders trouvent chez tant d’Américains illustre le sentiment d’exclusion de millions de personnes. Cette polarisation a lieu aussi bien vers la gauche que vers la droite, une tendance qui se retrouve internationalement.
La rhétorique réactionnaire de Trump trouve un écho parmi les populations qui se sentent totalement étrangères aux élites politiques de Washington. Sa popularité grandissante a provoqué un choc au sein du parti républicain, qui fait désormais face à des crises et de possibles scissions.
Les élections présidentielles américaines sont d’un grand intérêt. Il est bien évidemment impossible d’en prédire l’issue avec certitude, vu la volatilité et l’instabilité de la conjoncture politique. Les médias se sont focalisés quasi-exclusivement sur le républicain Donald Trump. Mais il semble très peu probable que la classe dirigeante des États-Unis soit prête à confier ses affaires à un clown réactionnaire et ignare, bien qu’elle ait déjà commis cette erreur par deux fois, avec Ronald Reagan et George W. Bush. Pour la classe dirigeante, Hillary Clinton serait certainement un bien meilleur parti.
Au-delà des campagnes de Trump ou Clinton, le soutien massif apporté à Bernie Sanders, qui parle ouvertement de socialisme, est l’élément le plus significatif. L’émergence de Sanders comme candidat sérieux pour les primaires démocrates témoigne du profond mécontentement et de l’effervescence au sein de la société. Ses attaques contre la classe des milliardaires américains et son appel à une « révolution politique » résonnent chez des millions de personnes, dont les dizaines de milliers qui assistent à ses meetings.
Le mot « socialisme » est utilisé de plus en plus fréquemment dans les grands médias américains. Selon un sondage de 2011, 49 % des 18-29 ans avaient une vision positive du socialisme, contre seulement 47 % pour le capitalisme. Un sondage plus récent (juin 2014) indique que 47 % des Américains seraient prêts à voter pour un socialiste ; chez les moins de 30 ans, ce taux atteint même 69 %.
Ils sont très nombreux, dans la jeunesse mais aussi à la base des syndicats, à vouloir entendre le message de Bernie Sanders. Même si son programme s’apparente plus à celui d’une social-démocratie à la scandinave qu’au véritable socialisme, l’engouement qu’il suscite est la preuve que quelque chose est en train de changer aux États-Unis.
Bernie Sanders bénéficie du sentiment de haine contre l’establishment et le gouvernement des milliardaires de Wall Street. La crise mondiale sape les fondations de l’Amérique. Un adulte sur cinq, aux États-Unis, vit dans un foyer pauvre ou au bord de la pauvreté. Depuis le début de la crise financière mondiale, près de 5,7 millions d’individus sont tombés dans la catégorie des plus bas niveaux de revenus.
L’administration des États-Unis se vantait d’avoir ramené le taux de chômage à 5 %. La raison n’en est pas la croissance économique mais la diminution de la population active. Si les proportions de ceux qui travaillent et de ceux qui recherchent activement du travail étaient les mêmes qu’en 2008, le taux de chômage atteindrait plus de 10 %. Les travailleurs ont été contraints d’accepter des emplois mal rémunérés et précaires.
Avec une croissance stagnante dans l’Eurozone, couplée à un fort taux de chômage, un Japon sombrant dans la récession et une croissance américaine plafonnant entre 2 et 2,5 %, aucun pays ne peut servir de moteur à un nouvel essor économique mondial. Dans un passé récent, les nations industrielles « développées » dépendaient des « marchés émergents » pour soutenir l’économie mondiale. Cette option n’est désormais plus envisageable.
L’Europe
À travers toute l’Europe, les gens réalisent que les politiques d’austérité ne sont pas qu’un ajustement temporaire, mais une offensive permanente contre les niveaux de vie. Dans des pays comme la Grèce, le Portugal et l’Irlande, ces politiques ont d’ores-et-déjà débouché sur des baisses massives des salaires nominaux et des retraites, sans avoir réglé les problèmes de déficits publics. Ce qui veut dire que toutes les souffrances et les privations du peuple ont été vaines.
L’Europe fait face à la perspective d’une longue période de faible croissance et de déflation. Dans ce contexte, les futures tentatives de réduire les dettes publiques seront plus « dures et sanglantes » que celles auxquelles nous avons déjà assisté. Dans l’ensemble, la zone euro n’est pas encore revenue au niveau de 2007, avant la crise, et ce malgré une série de facteurs qui devraient être favorables à la croissance : bas prix du pétrole, programme d’assouplissement quantitatif de la BCE (qui équivaut à 60 milliards d’euros par mois) et un euro faible (ce qui devrait stimuler les exportations).
Cependant, la très faible inflation n’est pas le reflet d’une bonne santé économique, mais plutôt d’une maladie chronique ; elle reflète l’absence de demande de la part des consommateurs, qui est elle-même une conséquence de la masse de dettes accumulées et de la baisse des revenus. Cela peut mener à une spirale descendante s’achevant sur une récession prolongée. En conséquence, certains parlent déjà de nouvelles baisses des taux d’intérêts journaliers et d’un accroissement du programme d’assouplissement quantitatif.
Commentant cette situation, le président de la BCE, Mario Draghi, écrivait : « Les pays qui composent maintenant la zone euro ont eu besoin de cinq à huit trimestres pour retrouver, au lendemain des récessions des années 1970, 1980 et 1990, leur volume de production d’avant la crise. Lors de la récente récession, reconnue comme la pire depuis les années 1930, l’économie américaine a eu besoin de quatorze trimestres pour revenir au point haut relevé avant 2008. Si notre évaluation actuelle est exacte, il faudra 31 trimestres à la zone euro pour retrouver son niveau de production d’avant la crise, soit au premier trimestre 2016 ».
Ces estimations sont plus qu’optimistes. Dans son actuel état fiévreux, l’UE est sensible aux chocs. Le ralentissement en Chine et la crise des « marchés émergents » a un effet négatif avant tout sur l’Allemagne, qui exporte des biens manufacturés en Chine. Dans la mesure où les exportations comptaient pour 45,6 % du PIB allemand en 2014, le seul pays qui aurait pu jouer un rôle moteur pour une reprise économique européenne en est, en fait, incapable.
Plus la croissance sera faible, plus le fardeau de la dette sera lourd. C’est la leçon à tirer de la Grèce. Dans ces conditions, des défauts de paiement et des pertes financières suivront, comme la nuit suit le jour, accompagnés d’une vague de banqueroutes et d’effondrement, dans un pays après l’autre.
L’impasse économique a eu pour effet d’approfondir toutes les contradictions et de provoquer de sérieuses tensions entre les pays d’Europe. La crise des réfugiés, et la question de savoir qui va en payer les frais, a cristallisé toutes ces contradictions. Elle a débouché sur des conflits violents entre l’Allemagne et des pays d’Europe de l’Est (Pologne et Hongrie), qui étaient presque devenus des colonies virtuelles de l’Allemagne.
La France et l’Allemagne sont embourbées dans un conflit sur le projet d’union bancaire, que la France appelle de ses vœux, tandis que l’Allemagne traîne les pieds. Berlin n’est naturellement pas très enthousiaste à l’idée de se porter garant pour les banques d’autres pays, ce qui reviendrait, pour un homme disposant d’un bon crédit, à prêter sa carte à son voisin plusieurs fois interdit bancaire.
Le renflouement de la Grèce n’est toujours pas achevé, malgré la capitulation de Tsipras. Cela ne sera pas facile pour lui de mettre en pratique les coupes drastiques exigées par Merkel et Cie. Il y aura une nouvelle intensification de la lutte des classes lorsque les travailleurs grecs résisteront à ces coupes et aux privatisations. A un certain moment, cela provoquera une crise dans le gouvernement et mènera à une nouvelle confrontation avec la Troïka, ce qui soulèvera à nouveau la crainte d’une sortie de la Grèce de l’Euro et d’une nouvelle crise de la zone Euro.
Il y a aussi la question – qui n’est pas secondaire – du référendum sur l’UE qui doit se tenir en Grande-Bretagne. Cameron représente dans cette affaire le parti Conservateur, radicalement opposé à une intégration plus poussée de la Grande-Bretagne dans l’UE. Les négociations seront difficiles. Cameron doit montrer qu’il a obtenu des concessions substantielles.
L’expansion de l’UE s’est arrêtée brutalement. Elle n’est plus en position d’intégrer de nouveaux pays d’Europe de l’Est. Après s’être vue promettre des relations renforcées avec l’UE, l’Ukraine va maintenant être abandonnée à son sort, déjà désastreux. De plus, le processus d’intégration européenne (qui est allé bien plus loin que nous ne le pensions possible) est maintenant en train de s’inverser : les contrôles aux frontières sont rétablis.
La crise de l’Europe produit de soudains changements dans les consciences. Les élections régionales de décembre 2015, en France, montrent le processus en cours. Le Front national a émergé victorieux du premier tour, tandis que le Parti Socialiste arrivait troisième derrière les Républicains de Sarkozy. Mais le plus grand parti, et de loin, est celui de l’abstention (plus de 50 %), ce qui exprime le rejet des partis dominants de la part d’une large partie de la population.
En Espagne, en 2011, le Parti Populaire (PP, droite) a remporté les élections. Cela s’explique par le fait que le précédent gouvernement « de gauche » du Parti Socialiste (PSOE) a mené une politique d’austérité qui a déçu les masses et mené inévitablement à la victoire du PP. Mais aujourd’hui, nous assistons au processus inverse avec la montée de PODEMOS, qui est devenu un parti groupant des centaines de milliers de membres, alors qu’il n’existait pas il y a 18 mois.
En Espagne, la fermentation et la radicalisation politique sont encore en train de se développer. Les élections de décembre 2015 n’ont rien réglé. Le PP a perdu sa majorité et cela a provoqué une crise gouvernementale qui débouchera presque certainement sur de nouvelles élections. Le soutien massif pour PODEMOS, qui a gagné 69 députés alors qu’il n’en avait aucun auparavant, provoque une grande inquiétude dans la classe dominante.
La croissance rapide de PODEMOS était le reflet d’un profond mécontentement contre l’ordre politique existant. Pour l’instant, on peut dire que les masses ne savent pas exactement ce qu’elles veulent, mais savent très bien ce qu’elles ne veulent pas. Les critiques ouvertes de Pablo Iglesias contre l’establishment politique, qu’il appelle « la Caste » (la Casta), reflètent bien la colère des masses.
Il est vrai que les idées des dirigeants de PODEMOS sont confuses. Mais cela correspond à l’état de conscience actuel des masses, qui s’éveillent à peine à la vie politique. Par conséquent, cela n’a pas nui au développement de PODEMOS, au moins dans un premier temps. Mais si cela n’est pas corrigé, ce manque de clarté pourrait détruire PODEMOS. Ses dirigeants auront très vite à décider ce qu’ils défendent et ce qu’ils veulent.
Tous ces processus seraient accélérés par une profonde récession. L’Europe fait face à une situation plus proche de celle des années 1920 et 1930 que des années d’après-guerre : une période prolongée de bouleversements politiques et sociaux, accompagnés de violents virages à gauche et à droite. Néanmoins, il existe aussi des différences avec l’entre-deux-guerres. Le rapport de force entre les classes est très différent – à l’avantage de la classe ouvrière.
Cela veut dire que la bourgeoisie européenne fait face à un dilemme insoluble. Elle est obligée d’essayer de détruire les réformes conquises par la classe ouvrière au cours du dernier demi-siècle ; mais elle sera confrontée à la résistance acharnée de cette même classe ouvrière. C’est pour cela que la crise continuera pendant des années, avec des hauts et des bas.
Les prophéties de Donald Tusk
Les chiffres du chômage dans la zone Euro cachent de fortes disparités entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches. Avant la crise, les taux de chômage des plus importantes économies de la région atteignaient des niveaux plus ou moins similaires.
En 2016, l’Union Européenne tente d’accélérer sa politique brutale de coupes budgétaires et d’austérité, sous l’étendard de la « consolidation fiscale ». Les experts sérieux du capital voient bien les dangers inhérents à cette situation. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions que les marxistes. Wolfgang Munchau, dans le Financial Times du 15 juin 2014, avertissait l’Europe qu’elle était « sous la menace constante de l’insolvabilité et de l’insurrection politique. (…) L’ajustement post-crise sera bien plus brutal que celui du Japon il y a 20 ans. Dans un tel environnement, je m’attends à ce que la réaction politique soit plus sévère… Même si la politique de désendettement pouvait fonctionner – ce qui est loin d’être assuré – elle pourrait bien ne pas fonctionner politiquement. (A l’inverse), en réduisant l’instabilité politique, on finirait par augmenter l’instabilité financière ».
Plus récemment, Donald Tusk, ancien premier ministre polonais, désormais à la tête du Conseil Européen, affirmait qu’il craignait « la contagion politique » de la crise grecque bien plus que l’éventuelle faillite de cet Etat :
« Je suis vraiment effrayé, non par la contagion financière de la crise grecque, mais par la contagion idéologique ou politique. On observe toujours le même schéma, dans toutes les plus grandes tragédies de l’histoire européenne, cette alliance tactique entre les radicaux de tous bords. Aujourd’hui, nous pouvons avec certitude observer ce même phénomène politique ».
C’est le même Donald Tusk qui joua aux côtés d’Angela Merkel un rôle central dans le bras de fer les opposant à Alexis Tsipras, le poussant à accepter les conditions brutales d’un accord comprenant des mesures d’austérité drastiques, telles la privatisation pour 50 milliards d’euros de biens publics, une nouvelle coupe dans les retraites, la hausse des taxes et autres coupes budgétaires. Le même Tusk contesta fortement qu’il y ait eu « quelqu’un de puni, notamment Tsipras en Grèce. Le processus dans son ensemble n’était tout entier qu’assistance à la Grèce ».
Mais Tusk fit également part de son inquiétude face à l’extrême gauche, qui défend selon lui « cette illusion gauchiste qu’on pourrait construire une alternative » au modèle économique européen actuel. Il soutient que les dirigeants de l’extrême-gauche tentent de mettre au rebut les valeurs traditionnelles de l’Europe comme la « frugalité » et les principes libéraux de l’économie de marché, qui ont si bien servi l’Europe.
Comme ailleurs dans le monde, la jeunesse d’Europe est frappée de plein fouet par le chômage. Actuellement, en Allemagne, première puissance économique européenne, le taux de chômage des jeunes s’élève à 7,1 %. En Italie, plus de 40 % des moins de 25 ans sont au chômage. En France, ce chiffre atteint 24 %, et 17 % au Royaume-Uni. Il est de plus de 45 % en Grèce et en Espagne.
La classe dirigeante est tout à fait consciente du danger que cela représente pour son système. Mme Reichlin, de la London Business School, a déclaré : « de nombreux jeunes Italiens sont susceptibles d’être perdus pour toujours, et cette situation peut créer des tensions politiques sur le long terme. Pour le moment, l’opposition italienne est divisée, mais cela ne sera pas nécessairement toujours le cas ».
Se référant à Tsipras, Donal Tusk pense que la rhétorique des leaders de la gauche radicale, couplée à un taux de chômage élevé dans plusieurs pays, pourrait former une combinaison explosive : « Pour moi, l’atmosphère est un peu similaire à la période post-68 en Europe. Je peux ressentir, peut-être pas une ambiance révolutionnaire, mais quelque chose toutefois qui ressemble à un sentiment largement répandu d’impatience. Lorsque l’impatience n’est plus seulement une expérience individuelle, mais devient sociale, c’est la prémisse de révolutions ».
L’impact de la crise grecque a été ressenti au-delà des frontières de la Grèce. L’idée d’intégration européenne a volé en éclats. Dans les négociations, l’Allemagne s’est conduite en chef d’orchestre dictatorial. Merkel ne s’en est pas cachée. La bourgeoisie française, qui avait encore l’illusion de codiriger l’Europe, a dû renoncer à pousser trop avant ses revendications. Ces tensions ne vont faire que s’exacerber à mesure que la crise va s’accroître.
La nature fruduleuse de la démocratie bourgeoise a été exposée au grand jour à des millions d’Européens. Merkel l’a affirmé de façon très claire : les référendums populaires et les élections ne sont d’aucune valeur ; les véritables puissances et les véritables dirigeants, en Europe, ce sont les banquiers et les grands capitalistes, qui prennent toutes les décisions. Peu importe l’opinion de la majorité. De même, l’humiliante descente aux enfers de Tsipras a exposé les limites du réformisme et de la social-démocratie.
Nous sommes dans une période de guerres, de révolution et de contre-révolution. Mais cela ne signifie pas, comme les sectes ignorantes se l’imaginent, que le fascisme ou le Bonapartisme soient des dangers imminents. Sur le long terme, bien sûr, si la classe ouvrière n’offre pas d’issue, la classe dirigeante tentera de s’orienter en direction d’une réaction ouverte. Mais en raison des changements intervenus dans le rapport de forces entre classes, cela ne pourra pas prendre la forme du fascisme tel qu’il a existé par le passé ; plutôt celle d’un régime de type bonapartiste. Même dans ce cas, il serait difficile à la bourgeoisie d’installer une dictature militaire sans courir le risque d’une guerre civile – qu’elle ne serait pas certaine de gagner.
Tôt ou tard, la classe dirigeante décidera que la démocratie est un luxe qu’elle ne peut plus se permettre. Mais elle s’y prendra prudemment, pas à pas, érodant progressivement les droits démocratiques, passant d’abord par un bonapartisme parlementaire. Mais dans les conditions de la crise du capitalisme, un régime bonapartiste réactionnaire serait instable. Il ne résoudrait rien et ne durerait probablement pas longtemps ; il ne ferait que préparer le terrain à des soulèvements toujours plus puissants, comme lorsqu’en Grèce la junte au pouvoir – de 1967 à 1974 – fut renversée par une révolution. Nous devons nous préparer à de tels événements, ne pas être pris par surprise et déstabilisés.
Le Royaume-Uni
L’élection de Corbyn à la tête du Parti Travailliste, à une large majorité, a complètement transformé la situation au Royaume-Uni, pratiquement du jour au lendemain. Cet événement a été précédé par la révolte contre l’establishment, en Ecosse, concrétisée dans la forte percée du SNP (Scottish Nationalist Party). Il s’agissait clairement d’un mouvement vers la gauche, et non vers la droite. Ce ne fut pas l’expression du nationalisme, mais de la haine viscérale contre l’élite décadente qui règne à Westminster. La politique collaborationniste de classe lâchement menée par les dirigeants du parti travailliste a conduit les masses à considérer ce parti comme un élément de plus de l’establishment.
En soi, l’élection de Corbyn a été le produit d’une série d’accidents. Mais Hegel soulignait que la nécessité s’exprime à travers les accidents. Le fait que Corbyn ait réussi à prendre part au scrutin tombe sous la catégorie philosophique de l’accident – c’est-à-dire d’un événement qui aurait pu ne pas se produire. Mais une fois qu’il s’est produit, cet incident a complètement changé la situation.
Dès son premier débat télévisé, Corbyn s’est nettement distingué des autres candidats. Il défendait quelque chose de différent, de plus frais, plus honnête, plus radical et beaucoup plus en phase avec les véritables aspirations de la population, qui est excédée par le statu quo et désireuse d’exprimer son rejet de l’establishment.
Avant les élections générales, il y avait très peu de vie interne dans le Labour. Mais la campagne de Corbyn a changé la donne. Elle a été précisément le catalyseur nécessaire, cristallisant tout le mécontentement accumulé dans la société, qui n’avait pas encore trouvé de débouché – et certainement pas dans le Labour, dominé par son aile droite.
L’élection de Jeremy Corbyn a fourni la seule chose qui manquait au Royaume-Uni : un point de référence pour le mécontentement généralisé et la frustration des masses. Cela rajeunit le Labour et le pousse vers la gauche. Cela représente un danger mortel pour la classe dirigeante, qui ne s’arrêtera devant rien pour le détruire.
Pendant des décennies, le Labour, sous la coupe de l’aile droite, a été un pilier de l’ordre établi. La classe dirigeante ne l’abandonnera pas sans lutter férocement. La première ligne de défense du système capitaliste est constituée par le groupe parlementaire du Labour, le PLP (Parliamentary Labour Party). La majorité blairiste du PLP est l’agent conscient des banquiers et du capitalisme, ce qui explique leur détermination fanatique à se débarrasser de Jeremy Corbyn à n’importe quel prix. Les conditions d’une scission du Labour se développent ; cela créera une situation radicalement différente dans le pays.
Ce n’est pas seulement le Labour, mais également le Parti Conservateur (Tory) qui est divisé, notamment sur la question européenne. Les résultats du référendum britannique sont difficiles à prévoir, mais un Brexit pourrait avoir de sérieuses conséquences à la fois au Royaume-Uni et en Europe, provoquant une accélération du processus de désintégration qui pourrait aboutir à la destruction de l’UE. D’un autre côté, si le Royaume-Uni quittait l’Europe, les nationalistes écossais, pro-européens, pourraient redemander un référendum sur l’indépendance, qui pourrait faire exploser l’État britannique.
Les fractures au sein du Parti Conservateur vont s’amplifier, menant probablement à une scission de l’aile droite anti-européenne, qui pourrait fusionner avec l’Ukip anti-européenne et anti-immigration, pour former un parti Bonapartiste-monarchiste à la droite des Conservateurs. De l’autre côté, la droite blairiste se dirige clairement vers une scission du Parti Travailliste. Comme les capitalistes, ils redoutent les conséquences d’une telle scission ; mais il est possible qu’à un certain stade l’aile droite des travaillistes soit forcée de scissionner et de se rapprocher de l’aile « gauche » des Conservateurs et des Lib-Dems, pour entrer dans une sorte de gouvernement d’union nationale.
Cela semble être le seul moyen, pour la classe dirigeante britannique, d’empêcher l’élection d’un gouvernement travailliste dirigé par Corbyn. Mais c’est une stratégie très risquée, qui causerait une extrême polarisation, poussant le Parti Travailliste vers la gauche. Dans l’opposition, en période de crise, le Labour (Parti Travailliste) se reconstruirait, préparant le terrain à un gouvernement travailliste de gauche. Les généraux ont déjà menacé d’un coup d’État si Corbyn arrivait au pouvoir. Cela ouvrirait immédiatement la porte à un conflit de classes et à une crise révolutionnaire en Grande-Bretagne.
La perspective est celle d’une crise et d’une scission du Labour. De grandes possibilités vont s’offrir à la tendance marxiste. Mais notre priorité reste de gagner la jeunesse et de la former. Nous en aurons besoin lorsque la situation tournera à notre avantage. Ce n’est pas une crise normale : des changements brusques et soudains sont inévitables. Nous devons nous attendre à l’inattendu, et comprendre qu’il faudra peut-être changer de stratégie en moins de 24 heures.
Tous ces événements sont le reflet d’un changement dans les profondeurs de la société. Trotsky a très bien décrit cela lorsqu’il parlait du « processus moléculaire de la révolution socialiste ». C’est un processus d’accumulation graduelle de petit changements, jusqu’à ce qu’un point critique soit atteint ; alors, la quantité se transforme en qualité.