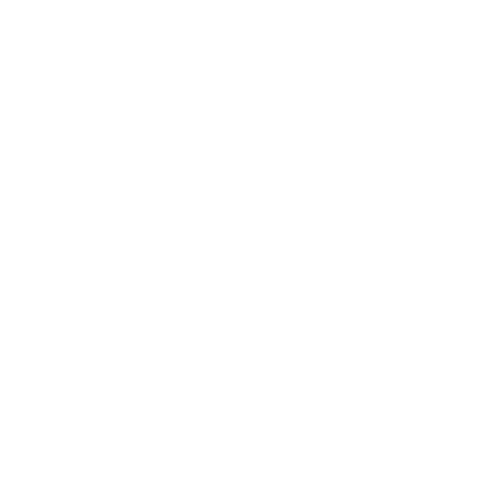Ce text est la première partie du document « Pour la crise du capitalisme: les patrons doivent payer! Manifeste de la Tendance Marxiste Internationale » achevé en octobre 2008. Depuis, comme nous l’annoncions, la crise financière s’est propagée à l’économie réelle. Son rythme s’accélère de jour en jour – et la crise sociale s’approfondit également. Les événements confirment notre analyse et renforcent la validité de ce programme d’action. Nous invitons tous nos lecteurs à faire circuler ce document le plus largement possible.
La crise mondiale du capitalisme est un fait que nul ne peut ignorer. Il n’y a pas longtemps, les économistes nous assuraient qu’une crise du type de 1929 était impossible. A présent, ils évoquent le risque d’une nouvelle Grande Dépression. Le FMI souligne le risque accru d’un déclin économique grave et prolongé, à l’échelle mondiale. Ce qui a commencé aux Etats-Unis par une débâcle financière s’est propagé à l’économie réelle – et menace l’emploi, le logement et les conditions de vie de millions de personnes.
La panique s’est emparée des marchés. Richard Fuld, l’ancien PDG de Lehman Brothers, a déclaré au Congrès américain que sa banque avait été emportée par une « tempête de peur ». Cette tempête ne montre aucun signe d’affaiblissement. Non seulement les banques sont menacées de faillite – mais aussi des pays, comme le montre le cas de l’Islande. L’Asie, qui était censée sauver le monde d’une récession, est elle aussi entraînée dans le tourbillon général. De Shanghai à Tokyo, de Moscou à Hong-Kong, les marchés enregistrent sans cesse de nouvelles baisses.
C’est l’effondrement financier le plus important depuis celui de 1929. Et comme le « Grand Krach », il a été précédé d’une période de spéculation massive. Ces vingt dernières années, l’ampleur de la spéculation était inouïe. La capitalisation boursière des Etats-Unis est passée de 5400 milliards de dollars, en 1994, à 17 700 milliards en 1999, puis à 35 000 milliards en 2007. C’est beaucoup plus que le montant des capitaux spéculatifs avant la crise de 1929. Le marché mondial des « produits dérivés » s’élève à plus de 500 000 milliards de dollars, soit dix fois la production mondiale de biens et de services.
Pendant les années de croissance, lorsque les banquiers accumulaient d’incroyables quantités de richesses, il n’était pas question de partager leurs profits avec le reste de la société. Mais maintenant qu’ils sont en difficulté, ils se précipitent vers les gouvernements et réclament de l’argent. Si vous êtes un petit boursicoteur qui a perdu 1000 dollars et ne peut pas les rembourser, vous irez en prison. Mais si vous êtes un riche banquier qui a joué et perdu des milliards de dollars, vous n’irez pas en prison : vous recevrez, en récompense, de nouveaux milliards d’argent public.
Face au risque d’effondrement complet du système bancaire, les gouvernements prennent des mesures désespérées. Dans l’espoir de redonner vie à un système financier moribond, l’administration Bush a injecté 700 milliards dans les coffres des banques. Ceci équivaut à 2400 dollars par homme, femme et enfant des Etats-Unis. Le gouvernement britannique a annoncé un plan de sauvetage de plus de 400 milliards de livres (ce qui représente beaucoup plus, en proportion, que le plan des Etats-Unis), et l’Union Européenne a rajouté des milliards supplémentaires. Le plan de sauvetage de l’Allemagne – l’économie la plus puissante d’Europe – s’élève à environ 20% de son PIB. Le gouvernement de la Chancelière Angela Merkel a promis 80 milliards d’euros pour recapitaliser les banques en difficulté, le reste étant destiné à couvrir les garanties d’emprunts et les pertes. A ce jour, environ 2500 milliards de dollars ont été dépensés, dans le monde. Mais cela n’a pas arrêté la spirale descendante de l’économie mondiale.
Des mesures désespérées
La crise actuelle est loin d’être terminée. Elle ne sera pas réglée par les mesures des gouvernements et des Banques Centrales. En injectant d’énormes sommes d’argent dans les banques, ils obtiendront tout au plus un répit temporaire, ou une très légère accalmie de la crise – au prix de placer une énorme dette sur les épaules des générations futures. Mais tous les économistes sérieux savent que les marchés peuvent encore lourdement chuter.
D’un certain point de vue, la situation actuelle est pire que celle des années 30. La gigantesque vague spéculative qui a précédé et préparé la crise financière actuelle était beaucoup plus grande que celle qui a déclenché le krach de 1929. La quantité de capital fictif injectée dans le système financier mondial – qui, tel un poison, menace de le détruire complètement – est tellement énorme que personne ne peut la quantifier. La « correction » (pour reprendre cet euphémisme des économistes) sera donc encore plus longue et plus douloureuse.
Dans les années 30, les Etats-Unis étaient les plus grands créditeurs du monde. Aujourd’hui, ce sont les plus grands débiteurs. A l’époque du New Deal, quand Roosevelt essayait de sortir l’économie de la Grande Dépression, il avait à sa disposition d’immenses quantités d’argent. Aujourd’hui, Bush doit implorer un Congrès réticent de donner l’argent qu’il ne possède pas. Le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars constitue un accroissement supplémentaire de l’endettement public. Cela se traduira par une longue période d’austérité et une baisse du niveau de vie de millions de citoyens américains.
Ces mesures prises dans la panique n’empêcheront pas la crise, qui ne fait que commencer. De même, contrairement à une idée reçue, le New Deal de Roosevelt n’a pas arrêté la Grande Dépression. A l’époque, la crise de l’économie américaine s’est poursuivie jusqu’en 1941, lorsque les Etats-Unis sont entrés dans la deuxième guerre mondiale et que d’énormes dépenses militaires ont fini par résorber le chômage. Une fois de plus, nous allons être confrontés à une longue période de baisse des niveaux de vie, de fermetures d’usines, de baisse des salaires, de réductions des dépenses sociales et d’austérité générale.
Les capitalistes sont dans une impasse. Ils ne voient pas d’issue. Tous les partis traditionnels sont dans un état de perplexité proche de la paralysie. Le président Bush a dit à la communauté internationale que « ça va prendre un moment » avant que son plan de sauvetage ne produise ses effets. Pendant ce temps-là, d’autres entreprises feront faillite, d’autres travailleurs perdront leur emploi et d’autres pays seront ruinés. La crise du crédit commence à prendre à la gorge les entreprises en bonne santé. Incapables de lever des capitaux, elles seront obligées de tailler d’abord dans leurs investissements fixes et dans leur main d’œuvre.
Les capitalistes implorent les gouvernements et les Banques Centrales de réduire leurs taux d’intérêt. Mais dans les circonstances actuelles, cela ne sera d’aucun secours. La réduction coordonnée des taux de 0,5 %, début octobre, a été suivie par de fortes baisses sur les places boursières mondiales. Lors d’une récession mondiale, personne ne veut acheter des actions et personne ne veut prêter de l’argent. Les banques arrêtent de prêter car elles doutent de pouvoir un jour récupérer leur argent. Le système tout entier est menacé de paralysie.
Malgré les efforts coordonnés des Banques Centrales pour injecter de l’argent dans le système, le marché du crédit reste gelé. Le gouvernement britannique a fait un cadeau de plus de 400 milliards de livres aux banques. Le résultat a été une chute de la bourse. Après l’annonce de ce don, les taux d’intérêt des prêts interbancaires ont même augmenté. Ces mesures n’ont pas résolu la crise et n’ont fait que verser de l’argent dans les coffres de ceux dont les activités spéculatives, si elles n’ont pas causé la crise, l’ont considérablement aggravée et lui ont donné un caractère incontrôlable et convulsif.
Les banquiers ne perdent jamais
Par le passé, le banquier était un homme respectable, vêtu d’un costume gris, que l’on supposait être un modèle de responsabilité et qui soumettait les gens à un interrogatoire sévère avant de leur prêter de l’argent. Mais tout cela a changé, ces derniers temps. Baissant les taux d’intérêt et brassant de vastes liquidités, les banquiers ont oublié toute prudence. Ils ont prêté des milliards – en escomptant de fortes marges – à des gens qui se sont rendus compte qu’ils ne pouvaient plus payer leur crédit lorsque les taux ont augmenté. Le résultat fut la crise des subprimes, qui a contribué à la déstabilisation de tout le système financier.
Dans l’espoir d’éviter une récession, les gouvernements et les Banques Centrales ont alimenté les feux de la spéculation. Sous Alan Greenspan, la Réserve Fédérale a maintenu des taux d’intérêt très bas. A l’époque, on le félicitait pour la sagesse de cette politique. De cette façon, ils ont retardé l’échéance de la crise – mais au prix de la rendre mille fois plus grave lorsqu’elle a finalement éclaté. L’argent bon marché a permis aux banquiers de se livrer à une véritable orgie spéculative. Les gens ont emprunté pour investir dans l’immobilier ou pour leur consommation courante. Les investisseurs ont utilisé la dette bon marché pour investir dans des actifs à plus haut rendement. Les prêts bancaires ont pris des proportions considérables par rapport aux dépôts des épargnants. Les activités douteuses ont été tenues à l’écart des bilans financiers de ces banques.
Désormais, tout cela s’est inversé. Tous les facteurs qui ont poussé l’économie vers le haut se combinent à présent pour créer une spirale descendante. Le manque de crédit menace de porter un coup d’arrêt sévère à l’économie. Si un ouvrier fait mal son travail, il est licencié. Mais quand les banquiers détruisent l’ensemble du système financier, ils s’attendent à être récompensés. Les hommes aux beaux costumes qui ont fait des fortunes en spéculant avec l’argent des autres exigent à présent que le contribuable les tire d’affaire. C’est une logique bien particulière, que la plupart des gens trouvent très difficile à comprendre.
Dans les années de croissance, d’énormes profits ont été réalisés par les secteurs bancaire et financier. En 2006, aux Etats-Unis, les grandes banques ont, à elles seules, réalisé environ 40% de tous les profits. Dans ce secteur, les cadres dirigeants sont payés 344 fois plus que l’employé américain moyen. Il y a trente ans, les PDG gagnaient en moyenne 35 fois le salaire d’un ouvrier. L’an passé, les PDG des 500 plus grosses sociétés ont gagné, en moyenne, 10,5 millions de dollars de « compensations » chacun.
Les banquiers veulent qu’on oublie tout cela et qu’on se concentre sur l’urgence qu’il y a à sauver les banques. Tous les besoins pressants de la société doivent être mis de côté, et toutes les richesses de la société doivent être mises à la disposition des banquiers, dont les services rendus à la société sont supposés être beaucoup plus importants que ceux des infirmières, des docteurs, des enseignants ou des ouvriers du bâtiment. En une semaine, les gouvernements de l’UE et des Etats-Unis ont dépensé l’équivalent de ce qui serait nécessaire pour soulager la faim dans le monde pendant près de 50 ans. Alors que des millions de personnes souffrent de la faim, les banquiers continuent de recevoir des salaires et des bonus faramineux. Ils maintiennent leur style de vie extravagant aux dépens du contribuable. La crise ne change rien à cela.
« Dans l’intérêt de tous » ?
La plupart des gens ne sont pas convaincus par les arguments des banquiers et des politiciens. Ils vivent très mal le fait que le fruit de leur travail soit mis à la disposition des banquiers et des riches. Mais dès qu’ils formulent une objection, ils font face au chœur assourdissant des politiciens qui leur disent : « il n’y a aucune alternative ». Cet argument est répété si souvent et avec une telle insistance que cela fait taire la plupart des critiques – d’autant que pratiquement tous les partis sont d’accord, à ce sujet.
Démocrates et républicains, sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates, conservateurs et travaillistes : tous ont uni leurs forces dans une véritable conspiration visant à persuader le public qu’il est « dans l’intérêt de tous » que les travailleurs ordinaires se fassent rouler pour donner plus d’argent aux gangsters de la finance. « Nous avons besoin d’un système bancaire sain (c’est-à-dire profitable) », expliquent-ils. « Nous devons restaurer la confiance, ou bien nous aurons l’apocalypse demain matin. »
Ce genre d’argument a pour but de créer une atmosphère de crainte et de panique, afin de rendre impossible toute discussion raisonnable. Mais que signifie vraiment cet argument ? Dépouillé de tout mensonge, il signifie seulement ceci : puisque les banques sont entre les mains des riches, puisque les riches ne « risquent » leur argent que s’ils obtiennent en retour des profits importants, et puisqu’ils ne font pas de profits à l’heure actuelle, mais seulement des pertes, le gouvernement doit intervenir et leur donner d’énormes sommes d’argent afin de restaurer leurs profits – et donc leur confiance. Alors, tout ira bien.
Le célèbre économiste américain John Kenneth Galbraith a résumé cet argument de la façon suivante : « les pauvres ont trop d’argent, et les riches pas assez. » L’idée, c’est que si les riches s’enrichissent toujours plus, à long terme une partie de leur richesse se diffusera vers le bas de la société, et nous en profiterons donc tous. Mais comme le faisait remarquer Keynes : à long terme, nous serons tous morts. En outre, l’expérience a montré que cette théorie est fausse.
L’idée qu’il serait absolument nécessaire de pomper d’énormes sommes d’argent public pour les injecter dans les banques, sans quoi on risquerait la catastrophe – cette idée ne convainc pas les hommes et les femmes ordinaires. Ils se posent cette question très simple : pourquoi devrions-nous payer pour les erreurs des banquiers ? S’ils se sont mis tous seuls dans cette situation, ils doivent la régler eux-mêmes. Outre une perte considérable d’emplois dans les secteurs financier et tertiaire, la crise financière affecte directement le niveau de vie des gens. La crise des marchés boursiers a déjà ruiné les économies de toute une section de la classe ouvrière et des classes moyennes.
A ce jour, les organismes de retraite des Américains ont perdu au moins 2000 milliards de dollars. Cela signifie que des gens qui ont travaillé dur toute leur vie, et qui ont économisé dans l’espoir d’une retraite relativement confortable, sont forcés de retarder leur départ à la retraite. Lors d’un récent sondage d’opinion, plus de la moitié des Américains interrogés ont dit s’inquiéter de devoir travailler plus longtemps du fait de la baisse de la valeur de leur épargne-retraite. Près d’une personne sur quatre déclare avoir augmenté son temps de travail hebdomadaire.
Beaucoup de gens font face à des saisies immobilières. Si une famille perd sa maison, on dit que c’est le résultat de son manque de prudence. Les lois d’airain du marché et de « la survie du plus fort » la condamnent à la rue. C’est une question privée – et non le problème du gouvernement. Mais si une banque est ruinée par la spéculation vorace des banquiers, c’est un malheur épouvantable pour toute la société. En conséquence, toute la société doit s’unir pour la sauver. Telle est la logique absurde du capitalisme !
Il faut combattre cette tentative honteuse de placer le fardeau de la crise sur les épaules de ceux qui peuvent le moins le supporter. Pour résoudre la crise, il faut arracher l’ensemble du système bancaire et financier des mains des spéculateurs et le soumettre au contrôle démocratique de la société, pour qu’il puisse servir l’intérêt de la majorité, et non celui des riches.
Nos revendications :
1) Non aux plans de sauvetage pour les riches ! Nationalisation des banques et des sociétés d’assurance, sous le contrôle et la gestion démocratique des salariés. Seuls les petits investisseurs doivent être indemnisés – sur la base de besoins prouvés. La nationalisation des banques est la seule façon de garantir les dépôts et les économies des gens ordinaires. Les décisions bancaires doivent être prises dans l’intérêt de la majorité, et non d’une minorité de riches parasites.
2) Contrôle démocratique des banques. Leurs conseils d’administration devraient être composés de la façon suivante : un tiers élu par les salariés de la banque ; un tiers élu par les syndicats, pour représenter les intérêts de toute la classe ouvrière ; et enfin un tiers représentant le gouvernement.
3) Pour une suppression immédiate des bonus exorbitants. La rémunération d’un dirigeant ne devrait pas dépasser le salaire d’un travailleur qualifié. Pourquoi un banquier devrait-il gagner plus qu’un docteur ou un dentiste ? Si les banquiers ne sont pas prêts à travailler sur ces bases, on doit leur montrer la porte et les remplacer par des diplômés qualifiés. Beaucoup cherchent du travail et désirent servir la société.
4) Une réduction immédiate des taux d’intérêt, qui devraient être limités aux coûts réels des opérations bancaires. Le crédit bon marché doit être disponible pour ceux qui en ont besoin, pour les petites entreprises et les travailleurs qui s’achètent une maison – pas pour les banquiers et les capitalistes.
5) Droit au logement : arrêt immédiat des saisies et des expulsions, réduction générale des loyers et programme massif de construction de logements sociaux abordables.
La cause de la crise
La cause profonde de la crise ne réside pas dans le mauvais comportement de quelques individus. Si c’était le cas, alors la solution serait simple : il suffirait d’amener ces individus à mieux se comporter, à l’avenir. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Gordon Brown, en appelant à « la transparence, l’honnêteté et la responsabilité ». Mais tout le monde sait que la finance internationale est aussi transparente qu’un cloaque, et que la fraternité bancaire est aussi sincère qu’une promesse de mafieux et aussi responsable qu’un joueur compulsif. Ceci dit, même si tous les banquiers étaient des saints, cela ne changerait rien.
Il est faux d’attribuer la cause de la crise à la cupidité et la corruption des banquiers (bien qu’ils soient extrêmement corrompus et cupides). C’est plutôt l’expression de la maladie de tout un système – une expression de la crise organique du capitalisme. Le problème n’est pas la cupidité de certaines personnes, le manque de liquidités ou l’absence de confiance. Le problème est que le système capitaliste se trouve dans une impasse complète, à l’échelle mondiale. La cause profonde de la crise, c’est le fait que le développement des forces productives a dépassé les limites étroites de la propriété privée capitaliste et de l’Etat-nation. La contraction du crédit est souvent présentée comme la cause de la crise. Mais en fait, ce n’est que le symptôme le plus visible. Les crises font partie intégrante du système capitaliste.
Marx et Engels l’expliquaient déjà, en leur temps :
« Les conditions bourgeoises de production et d’échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d’échange, ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu’il a invoquées. Depuis des dizaines d’années, l’histoire de l’industrie et du commerce n’est pas autre chose que l’histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionne l’existence de la bourgeoisie et sa domination.
« Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l’existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s’abat sur la société – l’épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu’une famine, une guerre d’extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l’industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d’industrie, trop de commerce.
« Les forces productives dont elle dispose ne favorisent plus le régime de la propriété bourgeoise ; au contraire, elles sont devenues trop puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle ; et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société bourgeoise tout entière et menacent l’existence de la propriété bourgeoise. Le système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein. Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D’un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l’autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit ? A préparer des crises plus générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. »
Ce passage du Manifeste du Parti Communiste, écrit en 1848, est aussi actuel et pertinent aujourd’hui qu’à l’époque. Il aurait pu être écrit hier.
La question la plus importante n’est pas le système bancaire, mais l’économie réelle : la production de biens et de services. Pour que les capitalistes fassent des profits, ces biens et services doivent trouver un marché. Mais la demande est en forte baisse, et cette situation est aggravée par le manque de crédit. Nous sommes confrontés à une crise classique du capitalisme, qui a déjà fait de nombreuses victimes innocentes. Aux Etats-Unis, l’effondrement des prix de l’immobilier a entraîné une crise de l’industrie de la construction, qui a détruit des centaines de milliers d’emplois. L’industrie automobile est en crise, elle aussi : les ventes, aux Etats-Unis, sont à leur plus bas niveau depuis 16 ans. Cela entraîne une baisse de la demande d’acier, de plastique, de caoutchouc, d’électricité, de pétrole et d’autres produits. Il y aura un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’économie, avec une flambée du chômage et une chute du niveau de vie des masses.
Anarchie capitaliste
Ces trente dernières années, on nous a expliqué que le meilleur système économique possible est cette chose ayant pour nom « économie de marché ». Depuis la fin des années 1970, la bourgeoise avait pour mantra : « laissons les marchés fonctionner » et « tenons l’Etat à l’écart de l’économie. » Le marché était censé posséder des pouvoirs magiques lui permettant d’organiser les forces productives sans aucune intervention de l’Etat. Cette idée est aussi vieille qu’Adam Smith qui, au XVIIIe siècle, évoquait la « main invisible du marché. » Les politiciens et les économistes se vantaient d’avoir aboli les cycles économiques.
Pour eux, il n’était pas question d’introduire la moindre régulation. Au contraire, ils exigeaient haut et fort que toute régulation soit éliminée, comme « préjudiciable à l’économie de marché ». Ils jetèrent donc toutes les régulations dans un grand bûcher et permirent aux « libres forces du marché » de régner. La soif de profit fit le reste. D’énormes quantités de capitaux passèrent d’un continent à un autre, sans aucune entrave. D’un clic de souris, des industries étaient détruites et des monnaies nationales sabordées. C’est ce que Marx appelait l’anarchie du capitalisme. Nous en voyons aujourd’hui les résultats.
Une très ancienne loi, l’instinct grégaire, régit le comportement des marchés. La moindre odeur d’un lion rôdant dans la brousse jettera le troupeau de gnous dans un état de panique que rien ne calmera. C’est ce genre de mécanisme qui détermine le sort de millions de personnes. Telle est la réalité brute de l’économie de marché. Comme les bêtes sauvages sentent l’odeur du lion, les marchés sentent l’imminence d’une récession. La perspective d’une récession est la véritable cause de la panique. Une fois que cela se produit, rien ne peut l’arrêter. Tous les discours, toutes les baisses de taux d’intérêt et toutes les aides aux banques n’auront aucun effet sur les marchés financiers. Ceux-ci y liront la peur des gouvernements et des Banques Centrales – et ils en tireront les conclusions nécessaires.
La concurrence entre places financières était censée garantir un fonctionnement efficace du marché, grâce à sa « main invisible ». Mais à l’été 2007, la faillite des politiques de « laisser-faire » a été cruellement révélée. Désormais, ils s’auto-flagellent et se lamentent tous face aux conséquences de leurs propres actions. Ils présentent à la société la facture des politiques par lesquelles les capitalistes et leurs représentants politiques ont tenté de maintenir le boom en faisant gonfler différentes bulles spéculatives. Tous ont été impliqués dans cette fraude massive. Républicains et démocrates, travaillistes et conservateurs, sociaux-démocrates et anciens « communistes » : tous ont soutenu l’économie de marché et acclamé le joyeux carnaval des profits.
Il est très facile d’être sage après les événements : tous les ivrognes le sont, le lendemain d’une cuite. Après quoi ils jurent tous qu’ils ont appris la leçon et ne reboiront plus – une excellente résolution qu’ils envisagent sincèrement de respecter, jusqu’à leur prochaine cuite. Aujourd’hui, les « régulateurs financiers » scrutent jusqu’aux plus petits détails des affaires bancaires – après la débâcle. Mais où étaient-ils et que faisaient-ils, avant la crise ?
A présent, tout le monde accuse les banquiers avides d’avoir provoqué la crise. Mais hier, ces mêmes banquiers cupides étaient unanimement salués comme les sauveurs de la nation, les créateurs de richesses, ceux qui prennent des risques et créent des emplois. A la City de Londres et à Wall Street, de nombreux emplois vont être supprimés. Mais les traders ont gagné des millions en bonus sur des opérations spéculatives à court terme. Et les supérieurs hiérarchiques des traders, dans les conseils d’administration, ont laissé tourner ce casino parce que leurs propres rémunérations étaient liées à ces opérations à court terme.
Les autorités tentent désormais d’imposer des restrictions aux rémunérations des banquiers, comme un prix à payer pour leur sauvetage. Ils le font, non pas par principe ou par conviction, mais parce qu’ils craignent la réaction du public à l’énorme scandale que constitue le versement de primes, à partir de fonds publics, à des gens qui ont plongé l’économie dans le chaos. Les patrons sont généralement insensibles à la colère et à la haine qui montent des profondeurs de la société. A tout le moins, ils y sont indifférents. Mais les politiciens ne peuvent pas se permettre d’être totalement indifférents à l’égard de citoyens qui peuvent les éjecter, lors des prochaines échéances électorales.
Leur problème, c’est qu’il est impossible de réglementer l’anarchie capitaliste. Ils se plaignent de la cupidité des patrons, mais la cupidité est au cœur de l’économie de marché, et ne tolère aucune entrave. Toute tentative de limiter les primes et rémunérations « excessives » sera sabotée. Le marché exprimera sa désapprobation par une chute brutale des actions. Cela captera l’attention des gouvernements et leur rappellera qui est le vrai Electorat : ceux qui possèdent les richesses. Quand, une année, un travailleur sacrifie une augmentation de salaire, cet argent est perdu à jamais. Mais cette règle ne s’applique pas aux banquiers et aux capitalistes. Même si, exceptionnellement, ils acceptent de limiter leurs primes cette année, ils compenseront ce grand « sacrifice » en augmentant leurs primes l’année prochaine. Cela ne présente aucune difficulté, pour eux.
L’idée que les hommes et les femmes sont incapables de mieux organiser la société est une monstrueuse calomnie contre l’humanité. Depuis 10 000 ans, l’humanité s’est révélée capable de surmonter chaque obstacle et de progresser vers l’objectif final de la liberté. Les merveilleuses découvertes de la science et de la technologie nous ouvrent la possibilité de résoudre tous les problèmes qui nous ont tourmentés depuis des siècles et des millénaires. Mais ce potentiel colossal ne pourra jamais être pleinement développé tant qu’il sera subordonné à la loi du profit.
Pour une vie meilleure
Dans leurs efforts pour défendre le capitalisme, certains commentateurs n’hésitent pas à accuser les consommateurs d’être responsables de la crise. « Nous sommes tous coupables », affirment-ils sans sourciller. Après tout, expliquent-ils, personne ne nous a obligés à acheter un logement ou à partir en vacances. Mais dans une situation où l’économie se développe rapidement, où le crédit n’est pas cher, tous les pauvres sont tentés de « vivre au-dessus de leurs moyens ». De fait, il y a même eu une période où, aux Etats-Unis, les taux d’intérêts réels étaient négatifs (inférieurs à l’inflation), ce qui signifie qu’il était désavantageux de ne pas s’endetter !
Le capitalisme crée sans cesse de nouveaux besoins, et la publicité est désormais une immense industrie qui utilise les méthodes les plus sophistiquées pour convaincre les consommateurs qu’ils ont besoin de ceci ou de cela. Le style de vie des riches « célébrités » est exposé au regard des pauvres, qu’on soumet à un lavage de cerveau pour qu’ils désirent des choses qu’ils n’auront jamais. Après quoi les hypocrites bourgeois pointent un doigt accusateur sur les masses qui, comme Tantale, sont accusées de contempler un banquet tout en mourant de faim et de soif.
Il n’y a rien d’immoral ou d’illogique à souhaiter une vie meilleure. Si les hommes n’aspiraient pas constamment à de meilleures conditions de vie, il n’y aurait aucun progrès. Nous n’avons qu’une vie, et il est bien normal qu’on veuille l’améliorer. Si nous ne pouvions aspirer à rien de plus que ce que nous avons aujourd’hui, les perspectives de l’humanité seraient bien sinistres. Ce qui, par contre, est clairement immoral et inhumain, c’est la foire d’empoigne et l’avidité individuelle que crée le capitalisme, où le progrès humain est soumis à l’avidité d’une minorité de parasites.
La classe capitaliste croit à la prétendue « survie du plus méritant ». Or en réalité, il s’agit de la survie, non des plus méritants ou des plus intelligents, mais des plus riches, aussi stupides et incapables soient-ils, alors que tant de gens talentueux et intelligents meurent en cours de route. On cultive systématiquement l’idée selon laquelle mon avancement personnel doit se faire au détriment de tous les autres, si bien qu’il serait nécessaire, pour progresser, d’écraser les autres. Ce type d’individualisme bourgeois constitue la base psychologique et morale de bien des maux qui affectent la société, rongent ses entrailles et l’abaissent au niveau d’une barbarie primitive. C’est la morale du « chacun pour soi et sauve qui peut ».
Cette misérable caricature de la sélection naturelle est une insulte à la mémoire de Charles Darwin. De fait, ce n’est pas la compétition mais la coopération qui fut la clé de la survie et du développement de la race humaine, dès ses origines. Nos très vieux ancêtres des savanes d’Afrique orientale (dont nous descendons tous) étaient des créatures petites et faibles. Ils n’avaient ni griffes, ni dents puissantes. Ils ne couraient pas aussi vite que les animaux dont ils se nourrissaient – ou qui voulaient se nourrir d’eux. D’après la théorie de la « survie du plus méritant », notre espèce aurait dû s’éteindre il y a quelque trois millions d’années. Le principal avantage de nos ancêtres, du point de vue de l’évolution, c’était la coopération et la production sociale. Dans ces conditions, l’individualisme aurait signifié la mort.
Changements de la conscience
Il faut poser une question simple aux partisans de la théorie de la « survie du plus méritant » : comment se fait-il qu’on ne laisse pas mourir des banques qui se sont révélées complètement inaptes à la survie ? Pourquoi faut-il à tout prix les sauver grâce à une générosité qui, dans nos sociétés, n’est pas supposée exister ? Pour sauver des banques en déroute, dirigées par des banquiers stupides et inefficaces, la grande majorité – intelligente, méritante et laborieuse – est supposée se sacrifier avec joie. Mais cette majorité n’est pas du tout convaincue que pour servir cette cause, elle doit se passer de choses telles que des écoles et des hôpitaux, et accepter un régime d’austérité pendant une durée indéterminée.
La signification des chocs économiques que les journaux et la télévision annoncent chaque jour est assez claire pour tous : le système actuel ne fonctionne pas. Pour utiliser une expression américaine : ce système « ne livre pas la marchandise ». Il n’y a pas d’argent pour la santé, l’éducation publique ou les retraites – mais pour Wall Street, il y a tout l’argent du monde. Comme le dit le grand écrivain américain Gore Vidal, nous avons le socialisme pour les riches et la libre-entreprise pour les pauvres.
Beaucoup de gens ordinaires tirent les bonnes conclusions de cette situation. Ils commencent à remettre en cause le système capitaliste et cherchent des alternatives. Malheureusement, il n’y a aucune alternative immédiatement évidente. Aux Etats-Unis, les gens se tournent vers Obama et les Démocrates. Mais les Républicains et les Démocrates ne sont que les pieds droit et gauche du grand capital. Comme l’écrit Gore Vidal : « dans notre République, il n’y a qu’un seul parti, le Parti de la Propriété, avec deux ailes droites. » Obama et McCain ont tous deux soutenu le plan de sauvetage de 700 milliards de dollars au profit des capitalistes. Ils représentent les mêmes intérêts fondamentaux, et ne divergent légèrement que sur des questions tactiques.
Tout cela aura de puissants effets sur la conscience des gens. C’est une proposition élémentaire du marxisme que la conscience humaine est profondément conservatrice. En général, les gens n’aiment pas le changement. Les habitudes, les traditions et la routine pèsent de tout leur poids sur les idées politiques des masses, qui résistent normalement à la perspective de modifications importantes dans leurs vies et leurs habitudes. Mais lorsque de grands événements ébranlent jusqu’aux fondations de la société, les gens sont obligés de réviser leurs vieilles idées et leurs vieux préjugés.
Nous sommes précisément entrés dans une telle période. La longue période de prospérité relative, qui, dans les pays capitalistes avancés, a duré plus de deux décennies – abstraction faite de la légère récession de 2001 – a laissé sa marque. Malgré les injustices flagrantes du capitalisme, malgré les longues heures de travail, l’intensification de l’exploitation, les inégalités criantes, la richesse obscène de quelques-uns face au développement de la grande pauvreté, malgré tout cela, la plupart des gens pensaient que l’économie de marché fonctionnait et pouvait même leur bénéficier. C’était particulièrement le cas aux Etats-Unis. Mais à présent, un nombre croissant de gens perd ces illusions.