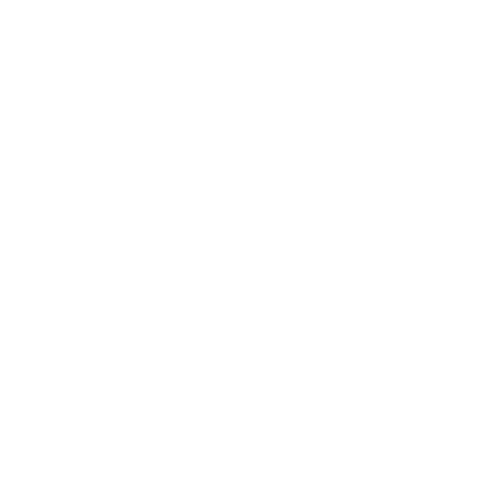Ce texte, achevé en janvier 2008, est la première partie du document « Perspectives Mondiales » qui sera discuté et amendé lors du Congrès mondial de la Tendance Marxiste Internationale, en août. Les autres parties seront mises en ligne dans les prochaines semaines.
« L’économie décide, mais seulement en dernière analyse. Les processus politico-psychologiques qui ont lieu actuellement au sein du prolétariat allemand, et qui ont également leur logique propre – ont une signification plus directe. » (Léon Trotsky, Les cinq premières années de l’Internationale Communiste, Introduction à l’édition de 1924).
Les perspectives économiques sont d’une grande importance, mais elles ne doivent pas être étudiées indépendamment du contexte général du capitalisme mondial. Les marxistes ne s’appuient pas sur un déterminisme économique, mais sur le matérialisme dialectique. Une perspective scientifique doit nécessairement tenir compte de toutes les variables de l’équation. L’analyse dialectique examine l’action, la réaction et l’interaction de tous les facteurs, aussi bien économiques que superstructurels (politiques, militaires, diplomatiques, etc.).
Les crises économiques jouent un rôle très important, comme on l’a vu en Asie, en Russie et en Argentine lors des crises de 1997-2001, qui ont eu de sérieuses répercussions sociales et politiques. Mais dans la situation actuelle du capitalisme mondial, où les contradictions s’accumulent à tous les niveaux, n’importe quel choc externe – qu’il soit lié à l’économie mondiale ou à d’autres facteurs – peut avoir des conséquences majeures.
Le cycle économique est important, mais il n’épuise pas la question de la conscience de classe et des perspectives révolutionnaires. C’est également une question politique. Par exemple, les effets de l’instabilité au Moyen-Orient ou l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak ont eu de sérieuses répercussions politiques en Italie et en Espagne. La guerre en Irak a plongé les Etats-Unis dans une crise politique. De l’autre côté de la planète, le Pakistan a été profondément déstabilisé par les événements en Afghanistan.
En Espagne, la chute du gouvernement Aznar a marqué un tournant brusque et décisif qui s’enracinait dans la crise mondiale du capitalisme, mais n’était pas directement lié à la conjoncture économique. Dans la période actuelle, des chocs soudains de ce type sont inhérents au contexte général. Cela s’applique également à l’économie qui, en dernière analyse, demeure le facteur déterminant de l’histoire mondiale.
Le facteur le plus décisif de l’histoire contemporaine est l’écrasante domination de l’économie mondiale, que Marx avait prévue en son temps. Aucune nation, quelle que soit sa puissance, ne peut résister à la formidable attraction magnétique de l’économie mondiale. Ni l’URSS, ni la Chine – deux puissantes économies – n’ont pu y résister, et les minuscules Etats européens le peuvent encore moins.
La chute de l’Union Soviétique – puis l’incorporation, dans le marché mondial, de près de deux milliards de personnes d’Inde, de Chine et d’ex-URSS – a puissamment stimulé le commerce mondial et agi comme un ballon d’oxygène pour le capitalisme. L’intensification de la division internationale du travail, comme l’ouverture de nouveaux marchés et zones d’investissement, ont offert aux capitalistes de nouvelles opportunités de super-profits et de pillages.
Cela ne signifie en rien que les contradictions fondamentales du capitalisme ont été résolues. Elles ont simplement été reproduites à une échelle inédite dans l’histoire de l’humanité. Dans un premier temps, les économistes bourgeois, qui raisonnent de façon empirique, ont une fois de plus succombé à l’illusion que le cycle économique était terminé et que les crises appartenaient au passé. Ils nous ont expliqué que nous étions entrés dans un « nouveau paradigme économique ».
Aujourd’hui, plus personne n’invoque ce prétendu « nouveau paradigme ». La crise internet de 2000 a fait éclater la bulle spéculative. Puis, après quelques années de reprise, les économistes bourgeois évoquent désormais la perspective d’un ralentissement de l’économie mondiale, en 2008 – voire d’une récession. La confiance et l’« exubérance irrationnelle » des classes dirigeantes se sont envolées, laissant place à un profond sentiment d’inquiétude.
Turbulence économique
Tout cycle économique commence par un « boom » et s’achève par une récession. Cependant, il est impossible d’en prévoir précisément le rythme. Aujourd’hui, tous les ingrédients d’une récession sont réunis, en particulier aux Etats-Unis. En 2000, l’éclatement de la bulle technologique a provoqué une récession relativement légère. Mais rien ne garantit qu’il en sera de même pour la prochaine récession. En économie, le passé n’est pas un guide pour l’avenir. La crise actuelle des marchés monétaires renforce la perspective d’une récession affectant l’ensemble de l’économie. Malgré tout, le dollar reste la « monnaie de réserve ». Cependant, si le dollar continue de chuter, cela pourrait déstabiliser l’économie mondiale.
Au cours des cinq dernières années, l’économie mondiale s’est développée au rythme moyen de près de 5% par an, non loin de son meilleur niveau historique. Cependant, les pays capitalistes avancés n’ont connu, eux, qu’une croissance de 2,8% par an. Avec 7,8% de croissance, ce sont les économies dites « émergentes » qui dopent la croissance mondiale. La croissance chinoise a été de 11% et celle de l’Inde de 9%. C’est un nouveau phénomène, mais les perspectives pour l’économie mondiale dépendent toujours des performances des pays capitalistes avancés, et en particulier des Etats-Unis.
Bien qu’une croissance mondiale de 5% soit comparable à la période d’expansion économique d’après-guerre (1948-1973), la période actuelle est différente. Elle inspire moins d’optimisme aux capitalistes. Il y a d’ailleurs des indices clairs que ces niveaux de croissance ne se maintiendront pas. La crise de l’été 2007, qui a commencé sur le marché américain des subprimes et s’est rapidement étendue à d’autres pays, a sonné comme un avertissement. Le boom économique américain tire à sa fin. Le chaos, sur les marchés boursiers, illustrait la turbulence générale qui caractérise l’époque actuelle.
En baissant les taux d’intérêt en réaction à la crise de l’été 2007, le bureau de la Réserve Fédérale américaine disait vouloir prévenir une « contagion » – c’est-à-dire éviter que la crise des subprimes ne s’étende au reste de l’économie et n’entraîne une récession généralisée aux Etats-Unis. Cela montre que la bourgeoisie est consciente du fait qu’une récession est une possibilité sérieuse. C’est d’ailleurs précisément la crainte d’une récession qui sous-tend l’actuelle nervosité des marchés monétaires.
La finance et l’économie réelle
Le boom économique américain a largement reposé sur la croissance de la consommation, elle-même alimentée par le crédit. Comme l’expliquait Marx, le crédit est un moyen d’étendre le marché au-delà de ses frontières naturelles. Mais cela a ses limites – qui sont désormais atteintes. Si les capitalistes ne trouvent pas de marchés pour écouler leurs marchandises, ils ne peuvent réaliser de plus-value, et une crise de surproduction se développe inévitablement.
La crise financière de l’été de 2007 a marqué un tournant. Cela peut – ou non – signifier que le point critique a été atteint à partir duquel l’économie mondiale amorce une récession. C’est une possibilité. Mais les lois qui régissent les marchés monétaires ne sont pas les mêmes que celles du cycle capitaliste. Une crise des marchés boursiers pourrait être l’étincelle qui provoque une crise générale, comme en 1929. Cependant, si le processus sous-jacent est encore dans une phase ascendante, la crise boursière peut servir à purger le système des capitaux fictifs, préparant ainsi le terrain à une nouvelle période (plus ou moins longue) de croissance économique, comme ce fut le cas en 1987.
Une chute des prix de l’immobilier aura un impact beaucoup plus important sur les dépenses des ménages américains que la crise boursière de 2001. La crise des subprimes a eu pour effet immédiat une chute des prix de l’immobilier et un resserrement du crédit. En conséquence, les ménages ne peuvent plus s’appuyer sur l’augmentation du prix de leur logement pour emprunter et faire face à leurs dépenses. En octobre 2007, l’un des principaux indices mesurant la confiance des consommateurs a chuté pour le troisième mois consécutif, descendant à son plus bas niveau depuis deux ans.
Le secteur de la construction fut l’un des principaux moteurs de la croissance américaine. Ce phénomène était lié à l’augmentation des prix de l’immobilier. Mais le marché du logement décline, désormais. Les experts disaient que les prix de l’immobilier ne pourraient jamais chuter aux Etats-Unis. Pourtant, ils ont baissé de 5% au cours des 12 derniers mois. L’investissement dans la pierre s’est effondré. Une grande quantité de maisons invendues signifie une nouvelle chute des prix.
Tout ceci affectera l’économie américaine de nombreuses façons. La surproduction, dans le secteur immobilier, provoque une crise de la construction. Cela aura des répercussions sur différents secteurs industriels (l’acier, le béton, etc.). D’autre part, cela affectera négativement le crédit et la consommation, et donc la demande, ce qui devrait finalement avoir un effet sur la production.
Lorsque les Américains réduiront sérieusement leurs dépenses, cela tirera l’ensemble de l’économie vers le bas. La consommation, aux Etats-Unis, a été le moteur de la croissance depuis la récession de 2001-02. Cette croissance ne reposait pas sur une augmentation des revenus, lesquels stagnent depuis des décennies. La croissance reposait sur un « sentiment de richesse » de consommateurs, qui pariaient sur l’augmentation du prix de leur logement. Cette augmentation des prix de l’immobilier constituait évidemment une bulle spéculative. Et désormais, la bulle explose.
L’augmentation du prix du pétrole (abstraction faite des fluctuations épisodiques des prix du brut) déprimera davantage le pouvoir d’achat. C’est pour ces raisons objectives que la « confiance des consommateurs » a chuté de façon vertigineuse. Lorsque les gens ont moins d’argent, que les crédits sont resserrés, que les prix augmentent et que le chômage menace, il est naturel de ne pas se précipiter dans les magasins pour y faire des achats. La croissance de la consommation américaine ne tardera pas à s’essouffler. Et si les entreprises n’ont pas de marché où vendre leurs produits, leurs profits en seront affectés, ce qui provoquera une chute de l’investissement productif.
Capitaux fictifs
Les crises financières et le resserrement du crédit ne sont pas la cause des crises économiques, mais leur effet. Cependant, dialectiquement, la cause devient effet et l’effet devient cause. Il est vrai que le cycle capitaliste croissance-récession a des causes plus profondes. Tant que les capitalistes font des profits par l’extraction de plus-value, il y a de la « confiance » et le crédit est relativement facile à obtenir. Mais lorsque la phase ascendante du cycle atteint ses limites et que tout annonce une récession, la « confiance » s’évapore.
Dans Le Capital, Marx explique qu’il y a deux sortes de crises financières, sous le capitalisme. Il y a les paniques financières qui sont une réflexion directe de la crise de l’économie réelle, et qui aggravent cette crise. Mais il y a aussi des crises financières apparemment provoquées par des facteurs accidentels et qui, en retour, ont des répercussions sur l’économie. On ne peut pas encore dire précisément quels seront les effets de la crise du crédit sur « l’économie réelle ». Mais il est clair que l’économie américaine – et avec elle le reste du monde – s’oriente vers la récession.
Les crises financières ne provoquent pas les récessions, qui sont la conséquence de l’anarchie de la production capitaliste. Mais elles peuvent exacerber des crises en injectant d’énormes quantités de capital fictif dans le système, pendant la phase de croissance. C’est ce qui s’était produit dans la période précédant la crise de 1929 – et c’est ce qui se produit aujourd’hui à une échelle encore plus vaste.
Le renchérissement du crédit n’affecte pas seulement les consommateurs et les propriétaires de logement. Cela ronge également le taux de profit des capitalistes. A un certain stade, cela peut peser sur l’investissement, en particulier si ce phénomène se combine avec un renchérissement des matières premières, comme le pétrole.
La Fed a énormément contribué aux bulles spéculatives et à l’endettement massif de l’économie américaine. En maintenant ses taux directeurs trop bas, trop longtemps, elle a encouragé le boom du crédit – et préparé la crise actuelle. Sur la majeure partie de la période de 2002 à 2006, les taux réels étaient négatifs. Les gens étaient punis de ne pas s’endetter. Aujourd’hui, l’ex-président de la Fed, Alan Greenspan, dit que « les hommes n’ont jamais su comment faire face aux bulles spéculatives. » Il reconnaît qu’il a été pris au dépourvu par la folie des subprimes. C’est vrai de la plupart des économistes et de la bourgeoisie en général.
Les énormes quantités de capitaux fictifs qui ont été injectées dans l’économie, au cours de la dernière période, sont comme un poison que les capitalistes doivent éliminer. Mais ce faisant, ils risquent fort de percer la bulle et de tout faire s’écrouler. Les créditeurs demandent que la dette soit payée, et ne sont plus aussi disposés à prêter. Ils demandent des taux d’intérêt plus importants. Cela diminue le taux de profit et la demande. L’effet devient cause, entraînant l’ensemble du cycle économique dans une incontrôlable spirale descendante.
Au sommet du cycle économique, une crise boursière peut servir à éliminer de grandes quantités de capitaux fictifs qui ont été injectés dans le système pendant le boom. Les économistes bourgeois appellent cela une « correction ». Cela fait penser aux « saignées » qui, au Moyen-Age, étaient supposées avoir des effets bénéfiques sur le corps du malade. Mais comme chacun sait, le fait d’enlever trop de sang d’un seul coup peut avoir des conséquences désastreuses.
Voilà ce qui effraye les capitalistes. C’est pour cela que la Fed, et désormais la Banque d’Angleterre (à contre-cœur), injectent davantage d’inflation dans l’économie. Ce faisant, ils peuvent repousser le problème quelque temps, mais seulement au prix de préparer une crise plus brutale et plus profonde.
L’inflation des marchés était déjà sidérante avant la crise des subprimes. La capitalisation de tous les actifs américains est passée de 5 300 milliards de dollars en 1994 à 17 700 milliards fin 1999, puis à 35 000 milliards fin 2006. Ce n’était pas le résultat d’une expansion de l’activité productive, mais d’un accroissement massif du capital fictif.
La conséquence d’une série de baisses des taux d’intérêt, c’est que le pays vit bien au-dessus de ses moyens. Les Etats-Unis, qui étaient les plus gros créditeurs au monde, sont devenus les plus gros débiteurs, avec une dette extérieure totale de 3000 milliards de dollars. Le taux d’épargne est descendu en-dessous de zéro pour la première fois depuis la Grande Dépression des années 30. Les Etats-Unis ont, d’année en année, accumulé des déficits publics de 6,5%. Quant à la Fed, elle observait avec complaisance l’endettement massif des ménages, sans réagir. En conséquence, l’Asie, et en particulier la Chine, ont accumulé d’immenses réserves monétaires aux dépens des Etats-Unis.
La crise récente a révélé à quel point les grandes banques américaines sont engagées dans des opérations spéculatives – et notamment dans l’achat et la vente de dettes. Au cours du dernier boom économique, les banques et autres compagnies financières ont prêté beaucoup d’argent à des gens sans solvabilité réelle. Tant que les intérêts étaient bas (et même négatifs, pour un temps), cela semblait pouvoir tenir. Dans ces conditions, de nombreux travailleurs se sont laissé tenter par l’achat d’une maison. De plus, les banques vendaient ces dettes à d’autres banques, qui en étaient avides.
La « finance structurée » est le terme qu’ils utilisent pour désigner une distribution du capital prétendument plus efficace, en permettant à des acteurs du marché d’assumer un rôle jusqu’alors considéré comme le domaine exclusif des banques. Dans la pratique, il s’agit d’une énorme escroquerie. Des dettes fragiles et autres passifs sont ainsi magiquement transformés en actifs (prétendument sécurisés). C’est l’équivalent financier de l’alchimie, qui cherchait à transformer le plomb en or.
Cela signifie que les bourgeois achetaient et vendaient de la dette. D’énormes fortunes ont été accumulées par le biais de cette vaste escroquerie. C’était parfait tant que cela pouvait durer. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. La panique qui s’est emparée du marché du crédit américain a été provoquée, en mai 2007, par les révélations de Bear Stearns sur d’énormes pertes dans deux de ses fonds spéculatifs. L’un des deux fonds s’est effondré ; l’autre a été renfloué par la banque.
Les économistes bourgeois prétendent que la crise des subprimes fut la cause de tout. Mais comme l’expliquait Hegel, il y a longtemps, la nécessité s’exprime à travers l’accident. Si cela n’avait pas été les subprimes, c’eût été autre chose. Les subprimes était le maillon faible de la chaîne. Comme le reconnaît Greenspan, « ce serait tout de même arrivé d’une façon ou d’une autre. »
Parasitisme
Dans sa jeunesse, la bourgeoisie développait les forces productives (via sa course au profit et sa soif insatiable de plus-value, qui est le travail impayé de la classe ouvrière). Mais dans la période du déclin sénile de la bourgeoisie, elle ne joue absolument plus aucun rôle progressiste. Marx expliquait que l’idéal de la bourgeoisie était de faire de l’argent à partir de l’argent, sans être obligée de s’atteler à la tâche pénible de produire. La bourgeoisie est atteinte d’un virus pour lequel il n’y a pas de remède.
Par le passé, le capitalisme jouait un rôle relativement progressiste en développant les forces productives – et en créant ainsi les bases matérielles d’une société nouvelle : le socialisme. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. A l’exception de la Chine (et de quelques autres économies asiatiques), la bourgeoisie n’a pas développé les forces productives. C’est le symptôme d’un capitalisme arrivé en phase terminale de sa maladie.
Aujourd’hui, les capitalistes ne sont plus très loin de réaliser leur vieux rêve : faire de l’argent avec de l’argent. En Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays, il y a eu un énorme déclin de l’industrie et une croissance équivalente des secteurs parasitaires que sont la finance et les services. Les soit-disant « fonds d’investissement » sont impliqués dans une orgie spéculative d’OPA et de fusions qui ne débouchent sur aucune activité productive – mais au contraire sur des fermetures, des licenciements et la destruction de l’industrie sur l’autel du profit.
Les sommes dépensées dans les « leveraged buy-out » (LBO : des fonds qui spéculent sur les dettes) sont énormes. Pour 32,6 milliards de dollars en cash et le transfert de 15,9 milliards en dettes, Bell Canada Entreprise, propriétaire de la plus grande compagnie de téléphone canadienne, a accepté d’être rachetée par un fonds de pension de l’Ontario et deux fonds d’investissement américains. S’il est finalisé, ce rachat ne serait pas seulement le plus important de l’histoire du Canada, mais le plus grand LBO jamais connu. Il fait pâlir l’information selon laquelle un fonds d’investissement pourrait acheter Virgin Media, en Grande-Bretagne, pour « seulement » 11 milliards de dollars.
L’ensemble du système bancaire est désormais plongé dans toutes sortes d’affaires de fraudes et d’arnaques. Il en a toujours été ainsi. Dans un boom, lorsque la production bat son plein et qu’il y a beaucoup d’argent à faire, on assiste à une course frénétique au crédit. Dans cette phase du cycle économique, un excès de crédit joue un rôle positif en « graissant » le système, en apportant les liquidités nécessaires.
Comme l’expliquait Marx, il y a toujours alors un élément de spéculation. Quand tout le monde gagne de l’argent, personne ne cherche à savoir trop précisément d’où vient l’argent – ni même si c’est de l’argent réel. Dès 1834, l’économiste britannique Gilbart écrivait : « Tout ce qui facilite le commerce facilite la spéculation. Commerce et spéculation sont parfois si étroitement liés qu’il est impossible de dire précisément où termine le commerce et où commence la spéculation. »
A l’époque de Marx, on estimait probable que « les neuf-dixièmes de tous les dépôts du Royaume Uni n’ont aucune existence au-delà de leur inscription sur les livrets de banquier qui en sont précisément redevables. » (The Currency Theory Reviewed, pp. 62-63)
Dans ce joyeux carnaval des fortunes, tout le monde est trop grisé par la possibilité de s’enrichir pour s’attarder sur les « détails ». « Mange, bois, sois heureux – car demain nous mourrons » : tel est le credo de la bourgeoisie en période de croissance. Cependant, lorsque la croissance s’essouffle, tous les procédés frauduleux remontent à la surface. De nouvelles faillites bancaires sont inévitables.
La seule différence avec le passé est l’échelle encore plus massive de la spéculation. Dans la période récente, d’énormes quantités de capital fictif ont été injectées dans le système par le biais de la croissance boursière, de la bulle immobilière et de l’extension du crédit à des niveaux inédits. Là aussi, ce n’est qu’une expression du déclin sénile du système capitaliste.
La faillite des économistes bourgeois
Sous le capitalisme, les crises sont inévitables. Ceux qui acceptent le capitalisme doivent également accepter ses lois, à savoir les cycles croissance-récession. Par l’intervention de l’Etat, l’endettement et autres politiques de « relance », les réformistes et les Keynésiens cherchent à bricoler le système pour « adoucir le cycle ». Ce faisant, ils peuvent parvenir à retarder une récession pendant un temps – mais au prix d’en accroître l’ampleur lorsque, finalement, la crise éclate.
Les économistes bourgeois sont incapables de comprendre les crises, qui sont une conséquence inéluctable du capitalisme. Ils observent avec perplexité ce qui se passe. Toutes leurs prédictions se sont révélées fausses. Ce n’est pas nouveau. En 1929, quelques jours après le crash boursier, la Société Economique de Harvard écrivait à ses adhérents : « Une sévère dépression ne fait pas partie des hypothèses crédibles ». En mars 2001, un sondage indiquait que 95% des économistes écartaient la perspective d’une récession – et ce alors qu’une récession avait déjà commencé.
En général, les économistes bourgeois pensent qu’une récession peut être évitée grâce à l’action des banques centrales et des gouvernements. La plupart excluent la possibilité d’un crash du type de 1929 et d’une « Grande Dépression ». Ils rappellent qu’au cours des vingt dernières années, il n’y a eu que deux récessions relativement légères, et en tirent la conclusion qu’ils ont trouvé la recette magique permettant d’éviter de graves récessions. C’est une perspective complètement erronée. En fait, chaque cycle économique a ses particularités, qui sont déterminées par des facteurs spécifiques du développement du capitalisme à un moment donné. La « légèreté » des deux dernières récessions ne signifie pas que le capitalisme est entré dans une nouvelle ère.
La crise de la banque Northern Rock, en Grande-Bretagne, a précisément montré que tous les instruments pour résoudre une crise et éviter une panique sont inopérants. Au « moment de vérité », les gens se sont précipités pour vider leurs comptes, comme un troupeau d’animaux sauvages qui aperçoit un lion. De nombreux commentateurs ont raillé avec mépris la conduite « irrationnelle » des clients de la Northern Rock. Mais ils oublient que l’irrationalité est au cœur de l’économie de marché.
Le gouvernement et la Banque d’Angleterre étaient impuissants à empêcher une crise bancaire majeure et à calmer les nerfs des clients de la Northern Rock. Ils ne sont parvenus à éviter un effondrement complet qu’en s’engageant à soutenir les banquiers par des fonds illimités – aux frais des contribuables. Cela a temporairement interrompu la chute, mais prépare les éléments d’une crise encore plus grave à l’avenir.
Les économistes bourgeois expliquent toujours les crises (et l’économie en général) en termes subjectifs. De même que tous les consommateurs sont supposés avoir une connaissance universelle des marchandises, de même les crises seraient provoquées soit par les décisions erronées des gouvernements et des banques centrales – soit par la nature humaine, à en croire Alan Greespan, ex-président de la Réserve Fédérale :
« La nature humaine passe de l’euphorie à la peur », nous informe Greenspan. « C’est ce sentiment de peur que les économistes modernes oublient de prendre en compte lorsqu’ils font des prévisions. La vieille habitude des cycles croissance-récession n’a pas disparu, au cours des dernières années. Elle était seulement en veille. »
Aujourd’hui, les bourgeois cherchent à se consoler au moyen des prédictions optimistes. Cela fait penser aux incantations d’un Chaman primitif qui s’efforce d’attirer la pluie en chantant. Ils se basent sur l’hypothèse que les booms et les crises sont provoqués par des facteurs psychologiques (la « confiance » des consommateurs et des investisseurs). Mais en réalité, le cycle croissance-récession est déterminé par des facteurs objectifs qui échappent au contrôle des gouvernements et des banques centrales.
La « confiance » des investisseurs repose sur des considérations matérielles parfaitement tangibles. Tant que l’économie américaine avançait, même si ses fondamentaux étaient fragiles, les capitalistes des autres pays étaient prêts à y investir. Ils ne prêtaient pas trop d’attention au niveau colossal des déficits américains, dont un déficit courant de quelque 800 milliards de dollars par an. Les Etats-Unis doivent lever plus de 70 milliards de dollars par mois pour couvrir ce déficit.
La plupart des économistes n’anticipent pas une récession américaine. Cependant, les faits pointent précisément dans cette direction. Lors du dernier trimestre de 2007, l’économie américaine a crû de 3,9% en rythme annuel. Mais tout indique qu’elle pourrait caler en 2008, et le chômage se développer. La plupart des observateurs s’accordent à dire que la croissance américaine ne dépassera pas les 2% en 2008. Mais ils ne tiennent pas compte des effets de la panique liée aux subprimes. Greenspan, l’OCDE et d’autres estiment, de leur côté, qu’il y a une chance sur deux pour que l’économie américaine plonge dans une récession, en 2008.
Au lieu d’augmenter les taux d’intérêt pour combattre l’inflation, la Fed a donné aux marchés financiers ce qu’ils voulaient : une baisse des taux. Cette décision, qui est irresponsable d’un point de vue capitaliste, est dictée par la crainte des effets politiques et sociaux d’une récession. Ils ont estimé que les risques d’une récession étaient tels que cela commandait une baisse du prix de l’argent.
Pour faire plaisir à Wall Street, la banque centrale sous-estime les dangers inflationnistes, et ce alors que de nombreux signaux sont au rouge. L’inflation augmente – d’une façon qui ne reflète pas correctement les statistiques gouvernementales. En 2000, lorsque Bush a commencé son premier mandat, l’or était à 273 dollars l’once, le pétrole à 22 dollars le baril et l’euro s’échangeait contre 0,87 dollars. Aujourd’hui [en janvier 2008], l’or est à plus de 700 dollars, le pétrole à plus de 80 dollars et l’euro s’échange contre 1,5 dollars. Certains économistes prédisent un baril à 125 dollars pour le printemps 2008. Les récentes baisses des taux d’intérêt ne peuvent que jeter de l’huile sur le feu.
Les chiffres de l’inflation ne reflètent sans doute pas suffisamment les pressions inflationnistes, en particulier si on tient compte de la chute du dollar et de l’augmentation record des prix du pétrole. Par sa politique, la Fed a confirmé l’idée des marchés financiers : les attentes des investisseurs déterminent les décisions des dirigeants de la Fed. Si Wall Street demande un baisse des taux, la Fed s’exécute.
Ces 15 dernières années, l’inflation était relativement stable. C’était dû au développement du marché mondial, et en particulier à l’entrée, sur le marché, de millions de travailleurs mal payés, qui exerçaient une pression à la baisse sur les prix et les salaires. A cet égard, les capitalistes et leurs économistes sont devenus un peu blasés. En conséquence, les banques centrales ont adopté des politiques monétaires très laxistes, préparant des problèmes, à l’avenir, sous la forme d’une énorme bulle de crédit.
Tout cela finira par se payer. Il y aura une crise de surproduction globale aggravée par une contraction brutale du crédit et un effondrement des marchés boursiers et immobiliers. Tous les facteurs qui ont stimulé le marché se combineront pour le déprimer.
Conséquences pour l’économie mondiale
David Walker, contrôleur général des Etats-Unis, a fait un parallèle entre la crise que traversent les Etats-Unis et la fin de l’Empire romain. Il expliquait qu’il y a des « similitudes frappantes » entre la situation actuelle des Etats-Unis et les facteurs qui ont contribué à la chute de Rome, dont « le déclin des valeurs morales, l’excès de confiance et d’agressivité militaire dans la politique étrangère, et l’irresponsabilité fiscale du gouvernement central. » Cela en dit long sur la psychologie actuelle des stratèges du Capital.
Un récession américaine aura nécessairement des répercussions sérieuses sur le reste du monde.
Les économistes bourgeois s’efforcent d’expliquer que les économies d’Europe et du Japon – qui se sont reprises au quatrième trimestre de 2007 – permettront d’éviter une récession mondiale. Cependant, de nombreux économistes prédisent que cette croissance ne se maintiendra pas. Mais même si l’Europe et le Japon parvenaient à plus ou moins croître, cela ne suffirait pas à compenser une récession sur le marché américain. La chute du dollar frappera les exportations d’Europe et du Japon. En outre, l’Europe se dirige tout droit, elle aussi, vers une crise du marché immobilier – qui aura les mêmes conséquences. Certaines banques européennes ont été affectées par la crise américaine des subprimes.
C’est l’autre face de la mondialisation. L’idée selon laquelle une récession américaine pourrait ne pas affecter le reste du monde est parfaitement absurde, et contredit d’ailleurs tout ce que les économistes disaient il y a peu au sujet de la mondialisation. Une crise dans n’importe quel secteur important de l’économie mondiale affectera les autres secteurs. On l’a très bien vu lors de la crise de 1997, qui a commencé en Asie et s’est rapidement étendue à la Turquie, à la Pologne, à la Hongrie, à la Russie, au Brésil et à l’Argentine. La même chose peut se reproduire n’importe quand.
Face au spectre d’une récession américaine, les économistes placent leurs espoirs dans les « économies émergentes ». Quelle ironie ! Il y a dix ans, l’idée que toute l’économie mondiale puisse dépendre à ce point des « économies émergentes » aurait terrifié les Américains et les Européens. C’est là une expression claire de l’impasse du capitalisme et du désespoir sans cesse croissant de la bourgeoisie, à l’échelle mondiale.