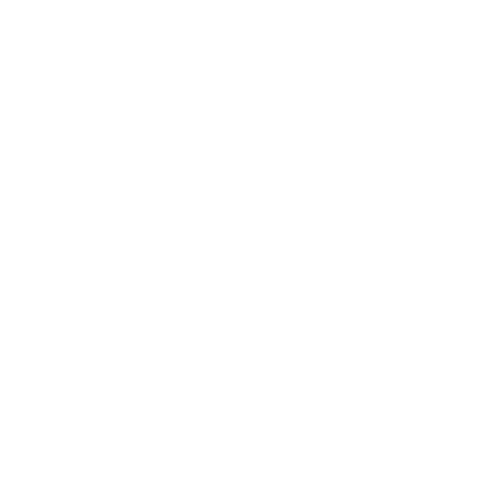Voici la 2ème partie des « Perspectives Mondiales 2010 », dont la rédaction a été terminée en février 2010. Ce document sera discuté lors du Congrès mondial de la Tendance Marxiste Internationale, début août, en Italie.
La Chine
Le développement des forces productives en Chine et en Asie du Sud-Est est un processus positif, d’un point de vue marxiste, car cela renforce la classe ouvrière de la région. L’illusion a été créée d’une croissance économique chinoise sans limites. Or, en participant au marché mondial, la Chine est désormais exposée à toutes les contradictions du capitalisme international. L’économie chinoise dépend lourdement du commerce mondial. Son excédent commercial s’élève à 12 % du PIB. D’après les statistiques officielles, ses exportations représentent 40 % de son PIB. Cependant, des économistes calculent qu’une fois déduites les importations d’éléments assemblés en Chine et réexportés, le chiffre réel tourne aux alentours de 10 % du PIB.
La surproduction mondiale affecte les exportations chinoises. Des millions de travailleurs chinois ont été licenciés. Des usines ont été fermées. La récession mondiale a détruit de larges pans de l’industrie chinoise tournée vers l’exportation, en particulier dans l’industrie légère, les usines d’assemblage, etc. Cela a essentiellement frappé le secteur privé. Dans différents secteurs de l’industrie lourde, comme l’acier et le charbon, le gouvernement a introduit des mesures de « rationalisation » de la production. Des centaines de petites entreprises ont été « consolidées » (fusionnées) pour former quelques entreprises géantes – et généralement contrôlées par l’Etat.
Comme ailleurs, la Chine a recouru, face à la crise, à un programme de stimulation économique – doublé dans ce cas d’une expansion massive des crédits accordés par les banques d’Etat. D’énormes quantités d’argent ont été injectées dans l’économie chinoise, essentiellement pour alimenter l’investissement, qui est entré pour 90 % de la croissance économique du premier semestre de 2009. La majorité de l’investissement (près de 50 % du PIB) est tournée vers la production de machines, pour l’exportation. Une autre partie importante de l’investissement a été affectée à l’immobilier résidentiel et aux investissements d’infrastructure.
Ces mesures ont été dictées au gouvernement chinois par la peur de mobilisations sociales qui menaceraient sa position, son pouvoir et ses privilèges. Il y a des divisions au sein du PCC et de l’Etat. Il ne s’agit pas de divisions entre ceux qui veulent en revenir à une économie planifiée et ceux qui veulent consolider les rapports de production capitalistes. La division est entre ceux qui pensent que la stabilité sociale passe par un haut niveau d’investissement public et de protection sociale – et ceux qui pensent qu’elle passe par une « libéralisation » encore plus poussée de l’économie, laquelle permettrait, selon eux, de maintenir la croissance économique.
Les mesures prises par le gouvernement chinois ne sont pas une remise en cause du processus de restauration du capitalisme – mais plutôt une tentative de créer de grandes entreprises d’Etat capables d’être concurrentielles, sur le marché mondial. Il s’agit également d’une tentative de contrôler la surproduction. La destruction de petites entreprises et la concentration du capital fait partie du processus normal de développement capitaliste.
Cela a conduit à un prolongement de la forte croissance chinoise. Mais dans les conditions d’une économie de marché, cela ne fera qu’aggraver le problème de la surproduction (surcapacité). La masse des marchandises produites doit être vendue. Or, le marché intérieur chinois est trop restreint pour l’absorber. La plupart des économistes bourgeois considèrent que cette politique est insoutenable, à moyen et long termes. Si l’investissement massif et l’accroissement des capacités productives ne s’accompagnent pas d’une croissance des exportations ou de la consommation domestique, cela mettra des entreprises dans l’incapacité de rembourser leurs crédits – et donc à une série de fermetures et de faillites.
Le sort de l’économie chinoise (et de l’économie asiatique en général) dépend des perspectives pour l’ensemble du monde capitaliste. Le Financial Times écrit, à propos de la Chine :
« Avec une surcapacité massive dans le secteur manufacturier et la fermeture de milliers d’entreprises, pourquoi les entreprises privées et d’Etat investiraient davantage, même si les crédits sont moins chers ? Obliger des banques d’Etat et des entreprises à, respectivement, prêter et investir davantage, ne fera qu’accroître le nombre de créances en souffrance et le niveau de surcapacité.
« Donc, sans une reprise des économies américaine et mondiale, la croissance chinoise ne peut pas se poursuivre à un rythme aussi élevé. Par ailleurs, la reprise américaine nécessitant moins de consommation, plus d’épargne privée et un moindre déficit commercial, la croissance de la Chine et des autres pays aux balances commerciales positives (Japon, Allemagne, etc.) devra dépendre davantage de leur demande domestique que de leurs exportations. Or, la croissance liée à la demande domestique, dans ces pays, est anémique, pour des raisons cycliques et structurelles. En conséquence, une reprise de l’économie mondiale est impossible sans un rapide et méthodique rééquilibrage de sa balance des paiements globale ». (FT, 3/05/09)
Cette analyse a été confirmée par des observations de Zhu Min, Vice-président du Forum Economique de Davos. En janvier 2009, il expliquait que même une croissance rapide de la consommation chinoise ne suffirait pas à compenser la baisse de la consommation américaine. Sur le marché mondial, la Chine a beaucoup moins de poids comme pays consommateur que comme pays producteur. Les Etats-Unis et l’Europe font pression sur la Chine pour qu’elle réduise sa surcapacité et se concentre sur le développement de sa consommation domestique.
L’énorme expansion du crédit a permis aux firmes chinoises d’emprunter à bas prix de façon à faire des placements financiers à haut rendement. La croissance massive des liquidités, à l’initiative du gouvernement, n’a pas seulement généré une croissance du PIB – mais également une explosion des investissements spéculatifs.
Le prix moyen du logement a atteint les 2200 dollars le mètre carré à Pékin, un tiers des revenus moyens annuels, dans la capitale. A Shanghai, les prix ont bondi de 60%, en 2009. Beaucoup d’Entreprises d’Etat, inondées de liquidités, ont dirigé ces fonds vers la spéculation sur les matières premières, la Bourse et des produits dérivés complexes. En conséquence, la Bourse de Shanghai a gagné plus de 60%, en 2009.
Ainsi, nous avons à la fois un accroissement des dépenses spéculatives et un développement du phénomène de surcapacité, qui a mené à une baisse des prix, dans certains secteurs. Le prix de l’acier chute, en Chine, ce qui reflète la baisse globale de la demande. En Asie, les exportations baissent : de 40 à 50 % au Japon, à Taiwan et en Corée.
Voici un commentaire intéressant sur la surcapacité en Chine, par un journaliste australien qui relate un entretien avec Yu Yongdin, Président de la Société Chinoise d’Economie Mondiale :
« Il pense que la Chine est prise dans un cycle où la croissance constante de l’investissement augmente l’offre, alors que la consommation n’a jamais réussi à croître assez vite pour l’absorber. En réponse, la Chine est obligée d’accroître encore l’investissement, de façon à créer assez de demande pour absorber le cycle précédent d’augmentation de l’offre, créant ainsi un cycle sans fin de « sur-offre ».
« De cette façon, la part de l’investissement dans le PIB est passée d’un quart, en 2001, à plus de la moitié aujourd’hui. « C’est une fuite en avant : la demande court derrière l’offre, puis il faut plus de demande pour soutenir plus d’offre », explique-t-il. « C’est un processus insoutenable, évidemment. »
« Depuis 2005, les problèmes de surcapacité de la Chine ont été « cachés » par la croissance continue de ses exportations. Mais cette stratégie a été interrompue par la crise financière. Puis, l’an dernier, il y a eu la politique débridée de stimulation par l’investissement, qui n’aurait pas été aussi inquiétante si la production correspondait aux besoins du peuple. Or la mainmise des autorités sur l’allocation des ressources n’a cessé de croître, depuis la crise, sans pour autant responsabiliser les officiels qui engagent les dépenses.
« « En conséquence des arrangements institutionnels, en Chine, les gouvernements locaux ont un appétit insatiable pour les investissements grandioses et les allocations de ressource sub-optimales », explique Yu Yongdin.
« Il y a donc désormais des aéroports sans villes, des autoroutes parallèles, des lignes de train à grande vitesse parallèles, et des paysans qui construisent des maisons dans le seul but de toucher une indemnisation lorsque le gouvernement local expropriera leur terre – et détruira la maison construite. »
Avant la crise, le chômage n’avait pas beaucoup baissé, en Chine, parce que l’investissement destiné à l’exportation nécessite beaucoup de capital constant (machines, etc.) : en 2005, la surcapacité de la production d’acier chinois s’élevait à 120 millions de tonnes – soit plus que la production annuelle du Japon, second producteur mondial. Telle était déjà la situation avant la crise. Pendant la crise, le chômage a rapidement augmenté. Le chômage officiel, qui ne tient compte que des travailleurs urbains enregistrés auprès de l’administration, s’élevait officiellement à 8,8 millions, en novembre 2008, soit 4,3 % de la population urbaine active. Mais le chiffre réel est bien plus important. Un sondage de l’Académie Chinoise des Sciences Sociales estime que le chômage urbain est de l’ordre de 9,4 %.
Si la croissance a été rapide dans les villes, au cours de ces dernières années, la campagne est restée à la traîne. Les paysans ont été poussés à chercher du travail dans des usines, en ville. Or, d’après une récente étude publiée par le gouvernement, 15 % des 130 millions de travailleurs migrants sont retournés dans leur ville natale, récemment, où ils sont désormais au chômage. Chaque année, 5 à 6 millions de migrants intègrent la main d’œuvre urbaine. Quelque 26 millions de Chinois ont été licenciés dans le secteur manufacturier, à cause de la crise, et ont dû rentrer au village.
Cela signifie qu’il y a plus ou moins 26 millions de travailleurs migrants qui cherchent un travail. A la campagne, beaucoup de familles dépendent de l’argent que leur envoient des migrants travaillant à l’usine ou sur des chantiers, en ville. La situation est de plus en plus explosive. Les conflits se multiplient, dans les usines. Les mobilisations de juillet et août 2009, contre des privatisations et des licenciements, étaient particulièrement significatives.
Les travailleurs luttaient contre l’impact d’une restructuration capitaliste des Entreprises d’Etat. Dans un cas, les travailleurs ont lynché un manager envoyé par le nouveau propriétaire privé de l’usine. Cela montre la colère qui grandit, sous la surface – et qui peut provoquer une explosion quand on s’y attend le moins. La discussion sur la nature de classe de la Chine est importante. Mais il faut aussi observer attentivement les mouvements des travailleurs et des paysans chinois. La classe ouvrière chinoise s’est considérablement renforcée, au cours de la dernière période. De grandes luttes se préparent.
Les relations mondiales
Le centre de gravité de l’histoire mondiale se déplace de l’Ouest vers l’Est – vers l’Asie et le Pacifique, et surtout la Chine, qui est à la fois une puissance économique et une puissance militaire. Tôt ou tard, la Chine entrera en conflit avec les Etats-Unis pour le contrôle de l’Asie et du Pacifique. Déjà, l’énorme excédent commercial de la Chine a provoqué des tendances protectionnistes, aux Etats-Unis. Ces tendances s’intensifieront, à l’avenir. Les grandes puissances chercheront à exporter leur chômage vers leurs rivaux.
L’effondrement de l’URSS a créé une situation unique, dans l’histoire mondiale. Les Etats-Unis sont devenus la seule super-puissance et ont dominé le monde dans le cadre d’une sorte de Pax Americana. En 1999, lorsque Clinton a décidé de chasser Slobodan Milosevic du Kosovo, il y est parvenu par la seule force aérienne (et la complicité des Russes, qui ont lâché Milosevic). Aucun pays n’a jamais possédé la capacité de projeter autant de forces, aussi rapidement, sur n’importe quel coin du globe. Ce sentiment de supériorité est monté à la tête des hommes de Washington, ce qui a mené à une série d’aventures militaires, en particulier après le 11 septembre.
Dans les années 30, Hitler avait recouru à un programme de dépenses militaires massif. Aux Etats-Unis, Roosevelt avait lancé le New Deal. Mais cela n’avait pas réglé la crise, aux Etats-Unis. Ce n’est pas le New Deal qui a absorbé le chômage, aux Etats-Unis, mais la Seconde guerre mondiale. Cela vaut également pour l’Allemagne. Hitler a engagé la guerre en 1938 pour éviter un effondrement de l’économie allemande. Le capitalisme allemand a cherché à régler ses problèmes au détriment de l’Europe – et il y était forcé.
Hitler a envahi l’Europe et pris le contrôle des richesses de la France et de ses autres rivaux impérialistes. Aujourd’hui, la perspective d’une guerre mondiale est exclue. Les capitalistes européens sont en compétition avec les Etats-Unis. Mais qui pourrait soutenir une guerre contre les Etats-Unis ? Il ne peut y avoir de guerre mondiale, dans ces circonstances. Mais il peut y avoir des « petites » guerres, sans cesse – comme actuellement en Irak, en Afghanistan et en Somalie. Cependant, une confrontation directe entre les grandes puissances est exclue.
Les Etats-Unis restent très au-dessus de la mêlée, en termes de puissance militaire. Leur budget de Défense excède ceux de tous leur plus proches concurrents – Chine, Japon, Europe de l’Ouest et Russie – combinés. La présence militaire mondiale des Etats-Unis est sans comparaison. Mais il y a des limites à la puissance de l’impérialisme américain, et ces limites sont atteintes. Au XIXe siècle, lorsque la Grande-Bretagne jouait le même rôle, le capitalisme était dans sa phase ascendante. Mais à présent, l’impérialisme américain a hérité du rôle de gendarme du monde dans la période de déclin sénile du capitalisme. Au lieu de bénéficier de ce rôle, les Etats-Unis en pâtissent lourdement.
La Russie n’est plus que l’ombre de l’ancienne Union Soviétique. Elle est handicapée par une démographie déclinante, la corruption et la désorganisation. Mais elle demeure une puissance militaire majeure, et elle se réaffirme et s’oppose aux prétentions des Etats-Unis. Bush pensait que la Russie ne serait pas en mesure de résister à l’expansion de l’OTAN, qui menaçait de l’encercler de bases hostiles. Il se trompait.
En septembre 2009, le président Barack Obama a annoncé qu’il renonçait aux plans d’installation de missiles en Pologne et en République tchèque. Moscou menaçait d’installer, en retour, des missiles Iskander à Kaliningrad. La toute dernière version du projet américain d’installer des missiles Patriotes a relancé les soupçons de la Russie sur les raisons du renforcement de l’OTAN à ses frontières. En conséquence, la Russie a décidé de renforcer sa flotte baltique. Cela montre, là encore, les limites de l’impérialisme américain.
Obama n’a pas la même approche de la politique étrangère que son prédécesseur – dans la forme, et non dans le contenu. Il défend les mêmes intérêts impérialistes, mais de façon plus subtile que Bush (ce qui n’est pas difficile). Il a augmenté le budget militaire global, le portant à 680 milliards de dollars. Les dépenses de prétendue « défense » consomment 35 à 42 % des recettes fiscales. Si on ajoute à cela les milliards de dollars affectés aux super-riches, on ne doit pas s’étonner qu’il n’y ait « pas assez » d’argent pour la création d’emplois, pour les écoles et la santé. C’est une version moderne du slogan : « les canons avant le beurre ». Et c’est Obama qui a remporté le Prix Nobel de la Paix !
La politique étrangère des Etats-Unis est bien évidemment dictée par des intérêts matériels – et non par l’idéalisme. Le coût global des guerres en Irak et en Afghanistan s’élève désormais à plus de 1000 milliards de dollars. Même la première puissance mondiale ne peut pas supporter indéfiniment une telle hémorragie de sang et d’argent.
Pour 2010, les analystes tablent sur des déficits de près de 11 % du PIB, aux Etats-Unis. C’est sans précédent, en période de paix. Pendant la Guerre Civile américaine comme pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiales, les Etats-Unis avaient d’énormes déficits. Mais une fois la paix restaurée, l’équilibre budgétaire était rétabli. Il n’en est plus ainsi. Même d’après les projections (optimistes) d’Obama, les déficits américains ne reviendront pas à des niveaux soutenables avant 2020.
Le déficit budgétaire des Etats-Unis peut finir par saper les bases de la puissance américaine. Lawrence H. Summers, conseiller économique d’Obama, posait la question : « Combien de temps le plus grand débiteur pourra-t-il rester la première puissance mondiale ? » Obama a rappelé au pays que « la précédente administration et le précédent Congrès ont décidé des allègements d’impôts massifs pour les plus riches et ont financé deux guerres – sans rien sortir des caisses de l’Etat. » Et désormais, pour tenter de maintenir la stabilité du système, le capitalisme américain est obligé de creuser davantage – et massivement – ses déficits.
Cela signifie qu’avant de repartir à la baisse, les déficits vont atteindre de nouveaux sommets. Cela provoque des divisions au sein de la classe dirigeante américaine. Les Républicains refusent la perspective d’augmenter les impôts. Quant aux « amis-des-travailleurs » démocrates, ils ont coupé ou gelé des dépenses discrétionnaires, dans tous les domaines – à l’exception de la Défense…
Le Trésor américain a emprunté à des taux très bas, pour financer ses déficits. Cela montre que les marchés pensent être remboursés en temps et en heure. Mais combien de temps durera cette confiance ? Les Etats-Unis doivent beaucoup d’argent à la Chine, et les Chinois ne sont pas sûrs d’être intégralement remboursés. Lorsque des membres de l’administration chinoise sont allés à Washington, l’année dernière, ils ont posé d’embarrassantes questions à propos du budget américain. Les capitalistes européens s’en inquiètent, eux aussi.
Obama commence à tirer les conclusions qui s’imposent. En décembre 2009, lorsqu’il a annoncé l’envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, il a précisé que les Etats-Unis ne pourraient pas se permettre d’y rester longtemps. « Notre prospérité constitue la base de notre pouvoir », a-t-il déclaré devant une assemblée d’élèves officiers. « C’est cette prospérité qui finance notre armée. Elle soutient notre diplomatie. Elle permet d’investir dans de nouvelles industries. […] C’est pourquoi notre implication en Afghanistan ne peut pas être indéfinie. […] La nation que je suis le plus intéressé à construire, c’est la nôtre. »
Ainsi, Obama a été contraint de reconnaître les limites de la puissance américaine. Il cherche à retirer l’armée américaine d’Irak – tout en envoyant 30 000 soldats rejoindre, en Afghanistan, les 68 000 soldats américains et les 39 000 autres soldats de l’OTAN. C’est 10 000 de moins que réclamé par le Général Stanley McChrystal, commandant des forces américaines sur place. Obama espère que ses alliés de l’OTAN apporteront leur contribution. Cela ouvre la voie à de nouvelles crises politiques aux Etats-Unis et en Europe. Mais cela ne changera rien de fondamental à l’issue de la guerre en Afghanistan.
Obama cherche à jouer sur deux tableaux en même temps. Il promet à la fois de vaincre les Talibans et de retirer les troupes américaines, à court ou moyen terme. Son objectif déclaré est de renforcer le gouvernement afghan – en équipant et en entraînant la police et l’armée locales. Mais le régime de Karzaï est complètement corrompu, et l’armée afghane ne tiendrait pas une semaine sans le soutien des forces de l’OTAN. Les bombardements américains sur des civils afghans alimentent une hostilité croissante à l’égard des forces d’occupation. Les Talibans disposent de réserves pratiquement illimitées en armes et en argent, notamment grâce au commerce de l’opium (92 % de la production mondiale). Ils ont aussi de solides soutiens au plus haut niveau de l’Etat et des Services secrets pakistanais.
Karzaï a prévenu que l’armée afghane ne serait pas opérationnelle avant « 15, voire même 20 ans ». Mais même cette estimation est optimiste. Les généraux américains pressent Obama d’envoyer davantage de soldats. Mais cela ne changerait rien. Par le passé, déjà, les impérialistes britanniques ont échoué en Afghanistan. Ils ont été obligés d’acheter la paix en corrompant les chefs de tribus. En fin de compte, les Américains seront obligés de faire la même chose. A long terme, ce sera beaucoup moins cher.
Les impérialistes américains ne peuvent pas gagner la guerre en Afghanistan. Par contre, ils ont réussi à déstabiliser toute la région. Washington est obligé de travailler avec le gouvernement pakistanais pour essayer – en vain – d’écraser les bases des Talibans au Pakistan. Obama a déclaré que « les Etats-Unis resteront un soutien puissant de la sécurité et de la prospérité pakistanaise, au-delà de la guerre. » Mais en entrant au Pakistan comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, les Etats-Unis ont complètement déstabilisé le pays.
En envahissant l’Irak, tout ce que les impérialistes américains ont réalisé, c’est la déstabilisation de la région dans son ensemble. Tous ses régimes pro-occidentaux sont extrêmement fragilisés : l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Liban, la Jordanie – et même le Maroc. Les classes dirigeantes de ces pays étaient terrifiées par les manifestations qui ont éclaté à l’époque du bombardement de Gaza, en décembre 2008.
Obama veut parvenir à un accord avec les Palestiniens, car cela aiderait ses amis, au Moyen-Orient – ce qui lui serait très utile. Mais la classe dirigeante israélienne a ses propres intérêts, qui ne coïncident pas toujours avec ceux de Washington. Elle n’est pas prête à accepter n’importe quel accord. Tout en évoquant – en parole – la nécessité d’un accord, le premier ministre israélien a laissé entendre qu’un plan de construction de 900 logements était à l’ordre du jour, à Gilo, dans la banlieue occupée de Jérusalem. Toutes les tentatives de geler ou d’arrêter la construction de colonies israéliennes n’ont abouti à rien.
En réalité, les « négociations » sont une farce. Netanyahou dit : « Oui, nous voulons un accord ». Mais il pose des conditions que les Palestiniens ne pourront jamais accepter. Il demande leur désarmement – c’est-à-dire, dans les faits, d’accepter le contrôle israélien. Quel type d’Etat et quel type d’indépendance est-ce là ? Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, il ne peut pas y avoir de solution au problème palestinien sur la base du capitalisme et dans les limites d’Israël/Palestine.
L’impuissance de l’impérialisme américain est également évidente en Somalie. Ils ont été entraînés dans un conflit qui leur posera de nombreux problèmes. Et désormais, le Yémen suit la même voie. Au Pakistan et en Somalie, les développements en cours constituent une menace potentielle encore plus grave que l’Irak et l’Afghanistan. Mais le souvenir du Vietnam les dissuade d’y envoyer davantage de soldats. La guerre du Vietnam leur a appris quels peuvent être les effets, sur les masses américaines, d’une révolution coloniale. Les aventures en Irak et en Afghanistan pourraient avoir des effets semblables – non seulement aux Etats-Unis, mais dans d’autres pays de la coalition impérialiste.
La révolution coloniale
Les pays anciennement colonisés ont partiellement réussi à se débarrasser de la domination militaro-bureaucratique directe des puissances étrangères. Mais ces pays sont toujours exploités par les pays impérialistes, qui leur imposent un contrôle encore plus sévère à travers le mécanisme du commerce mondial. Ils les saignent encore plus qu’autrefois. Dans la plupart de ces pays, le niveau de vie chutait avant la crise. A présent s’ouvre l’effrayante perspective de la famine, du chômage de masse et de souffrances inouïes.
Les libéraux occidentaux dissertent longuement, avec sentimentalisme, au sujet des « pays pauvres » – tout en continuant de les exploiter. Ces pays ont versé des milliards en remboursement de dettes, mais sont encore plus endettés. La valeur de leurs exportations (matières premières et produits agricoles) ne cesse d’être inférieure à celle des produits manufacturés qu’ils importent des puissances industrialisées. Il n’y a pas de solution à cela sur la base du capitalisme. De grandes explosions sociales sont à l’ordre du jour en Amérique latine, en Asie et en Afrique.
En Afrique, la menace constante d’une rechute dans la barbarie est l’expression, d’une part, de l’impossibilité de résoudre les problèmes de l’Afrique sur la base du capitalisme – et d’autre part de l’ingérence des puissances impérialistes, qui pillent avidement les immenses ressources du continent. Même pendant le boom, l’Afrique subsaharienne connaissait une situation absolument cauchemardesque. Ce qui s’est passé au Rwanda fut un terrible avertissement. Des événements similaires peuvent se répéter ailleurs, comme nous l’avons vu dans la terrible guerre civile au Congo, où au moins cinq à six millions de personnes ont été tuées.
Des atrocités semblables ont eu lieu en Sierra Leone et en Ouganda. Il n’y a pas longtemps, le Kenya, un pays relativement stable, s’est retrouvé au bord de la guerre civile. Aujourd’hui, une guerre sanglante fait rage en Somalie, et la guerre au Soudan est sur le point d’éclater à nouveau. Au Nigeria, il y a des pogroms religieux impliquant musulmans et chrétiens. Cependant, l’Afrique compte plusieurs pays clés dotés de puissantes classes ouvrières : le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Egypte, où de grandes grèves ont éclaté, au cours de la dernière période.
En Egypte, les puissantes grèves des ouvriers du textile, en 2007, sont une indication de ce qui se prépare, dans ce pays. Un élément frappant de ces grèves, ce fut le rôle des femmes – habillées en tenues islamiques traditionnelles, en tchador –, qui dans de nombreuses usines ont déclenché le mouvement et se sont tournées vers les hommes pour les appeler à la grève. Ces femmes ont participé à l’occupation des usines, et dormaient la nuit dans les usines avec leurs bébés. Il y a eu également d’autres grèves importantes, comme celles des enseignants. La société égyptienne est en effervescence, ce qui reflète la confiance croissante de la classe ouvrière dans l’un des pays les plus grands et les plus développés d’Afrique.
Le Nigeria, dans la dernière décennie, a connu huit grèves générales, et plusieurs autres importantes grèves de médecins, de personnel de l’université, de fonctionnaires et d’autres secteurs. Le NLC (Nigerian Labour Congress) est de loin l’organisation la plus populaire, parmi les masses. Les dirigeants du NLC jouent un rôle politique important, mais ils sont conscients de la puissance potentielle de la classe ouvrière nigériane, et c’est la raison pour laquelle ils n’ont pas encore appuyé pleinement le nouveau Parti du Travail Nigérian. Si le NLC soutenait officiellement ce parti, celui-ci deviendrait sans aucun doute une force majeure. Au lieu de quoi, en l’absence d’une politique alternative ouvrière, les masses ne peuvent choisir qu’entre différents gangsters politiciens bourgeois. Le régime actuel est en fait extrêmement faible, et ne reste en place que par inertie – et parce qu’il n’existe pas d’alternative crédible, à ce stade. Mais les masses sont exaspérées et ne tarderont pas à se mettre de nouveau en mouvement.
Mais le pays clé, en Afrique sub-saharienne, c’est l’Afrique du Sud. L’ANC est arrivé au pouvoir sur la base d’un compromis pourri avec la classe dirigeante blanche. La masse des travailleurs noirs n’a pratiquement rien gagné à cet accord. Simplement, une bourgeoisie noire et une classe moyenne noire ont fusionné avec les exploiteurs blancs. Les intérêts de cette bourgeoisie étaient représentés par la section de l’ANC dirigée par Thabo Mbeki. Ex-stalinien, il est devenu un parfait bourgeois, ce qui a provoqué une division ouverte au sein de l’ANC.
Sur la base du capitalisme, un scénario catastrophique s’ouvre à l’Afrique du Sud. Le Parti Communiste (SACP) mène une politique réformiste. L’ANC est allée vers la droite et fait le sale travail de la bourgeoisie. Il y a des millions de chômeurs. Seul un petit nombre de Noirs est devenu riche et a rejoint l’élite. Les richesses minières sont exploitées au profit des impérialistes. C’est très impopulaire. Les masses noires ont été déçues par Mbeki. Zuma lui a succédé, mais à présent l’Afrique du Sud est gravement touchée par la crise économique. Les masses ont encore de grandes illusions au sujet de l’ANC. Mais leur patience a des limites.
Le taux de chômage officiel est de 23,5%, mais le taux réel est beaucoup plus élevé. La masse des travailleurs noirs a cru que Zuma gouvernerait plus à gauche que Mbeki, qu’il défendrait ses intérêts. Mais ces espoirs ont été rapidement déçus. Il y a eu d’importantes grèves dans toutes les grandes villes du pays, impliquant les conducteurs d’autobus, le personnel des cliniques, les agents de la circulation, les agents des bibliothèques, des parcs et du secteur public en général. Il y a eu des affrontements avec la police. Des barricades ont été dressées et la police a tiré sur les travailleurs avec des balles en caoutchouc. Ce sont les prémisses d’un mouvement révolutionnaire, dans ce pays clé du continent africain. Nous devons surveiller de près ces développements.
L’Inde et le Pakistan
L’effondrement du stalinisme a aggravé la dégénérescence des directions des Partis Communistes. Par le passé, ils se tournaient vers Moscou ; à présent, ils se tournent vers la bourgeoisie. Ils ont abandonné l’idée de lutter pour le socialisme. En Inde, le PCI a toujours été le jouet du Parti du Congrès. Cela a conduit à une scission et à la création du PCI(M). Mais à présent, le PCI et le PCI(M) suivent la même ligne réformiste. Le déclenchement de la guérilla menée par les Naxalites, dans plusieurs Etats du pays, est une réaction désespérée à la politique de collaboration de classe menée par les dirigeants des Partis Communistes.
La classe ouvrière indienne est une force colossale. Au cours de la dernière période, des grèves et des grèves générales ont éclaté. Dans les Partis Communistes, il y a une fermentation et un mécontentement, à la base. La base ouvrière de ces partis croit au socialisme et au communisme ; elle est mécontente de la politique des dirigeants. Une tendance marxiste gagnerait rapidement le soutien des travailleurs et des jeunes des Partis Communistes indiens. C’est à l’ordre du jour, dans un avenir proche.
Au Pakistan, l’élection d’un gouvernement du PPP dans des conditions de crise constitue une nouvelle étape. La situation du pays est désastreuse. Les hausses de prix, le chômage, la pauvreté, la pénurie d’électricité, d’eau et de gaz, les licenciements, les privatisations et d’autres facteurs ont créé une situation d’une gravité sans précédent, pour les masses laborieuses du Pakistan.
En se basant sur le capitalisme pakistanais en faillite, les dirigeants du PPP ont été contraints d’engager une série d’attaques contre la classe ouvrière. Pire encore, Zardari a promis une soumission totale aux Américains – à un degré que même Musharraf était incapable d’offrir aux impérialistes. Ce régime a accordé un soutien total et aveugle à l’agression impérialiste qui a tué des milliers de personnes, en Afghanistan et au Pakistan.
Le rôle de nos camarades, au Pakistan, est d’une importance extraordinaire. Les marxistes pakistanais ont réussi à construire une force encore modeste, mais importante, dans les conditions les plus difficiles. C’est un accomplissement extraordinaire, dans un Etat musulman pauvre et arriéré. Nos camarades travaillent dans des conditions très difficiles et dangereuses. Ils font face à des attaques de tous côtés et ont longtemps travaillé à contre-courant. Mais le courant commence à s’inverser.
Lors du retour de Benazir Bhutto, les travailleurs et les paysans du Pakistan ont massivement soutenu le PPP. Ils ont voté pour le PPP dans l’espoir d’un changement. Mais leur espoir a été déçu. Les travailleurs et les militants de base du PPP sont hostiles à la politique droitière de Zardari et de la direction du PPP. Cette situation confirme entièrement nos perspectives pour le PPP. Les travailleurs doivent passer par l’école de Zardari afin d’apprendre la vraie nature des dirigeants du PPP. Et ils apprennent vite.
Des fissures commencent à s’ouvrir, au sein du PPP. Elles s’élargiront, avec le temps et l’expérience. Nous n’avons aucune intention d’abandonner le PPP, mais il serait fatal que nous soyons considérés comme des soutiens de la politique anti-ouvrière de Zardari, qui s’aliène les masses et prépare le retour de la réaction. Notre position est celle de Lénine : « expliquer patiemment ». Ce faisant, nous gagnerons un nombre croissant de jeunes et de travailleurs à nos idées et notre programme révolutionnaires.
Nos camarades pakistanais sont restés fermes, face à des pressions brutales. C’est la preuve que nous avons construit une force révolutionnaire viable, capable de combattre et de vaincre les éléments opportunistes et ultra-gauches – et de mener un travail sérieux au sein des masses. Dans la période à venir, nous aurons la possibilité de devenir une force décisive, non seulement au Pakistan, mais dans l’ensemble du sous-continent indien. Une révolution au Pakistan se répandrait immédiatement à l’Inde, brisant les frontières artificielles qui séparent des peuples qui parlent la même langue et ont une histoire et une culture communes remontant à des milliers d’années.
L’Iran
En Iran, l’entrée en scène des masses signifie que la révolution a commencé. Ce fait est clair pour les millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour affronter les Basijis, à plusieurs reprises, sur plusieurs mois. Malgré la terrible répression, il a y eu entre un et deux millions de personnes, dans les rues de Téhéran, suite aux élections de juin 2009. C’était une magnifique mobilisation de masse. C’est la réponse définitive à tous les lâches, les sceptiques, les cyniques, les ex-marxistes et ex-communistes qui doutaient de la possibilité d’un mouvement révolutionnaire, à notre époque.
Lénine et de Trotsky ont expliqué ce qu’est une situation révolutionnaire. Dans La faillite de la IIe Internationale (1915), Lénine explique :
« Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une situation révolutionnaire, mais toute situation révolutionnaire n’aboutit pas à la révolution. Quels sont, d’une façon générale, les indices d’une situation révolutionnaire ? Nous sommes certains de ne pas nous tromper en indiquant les trois principaux indices que voici : 1) Impossibilité, pour les classes dominantes, de maintenir leur domination sous une forme inchangée ; crise du « sommet », sous une forme ou une autre ; crise de la politique de la classe dominante, qui ouvre une fissure par laquelle le mécontentement et l’indignation des classes opprimées se fraient un chemin. Pour qu’une révolution éclate, il ne suffit pas, habituellement, que « la base ne veuille plus » vivre comme auparavant ; il importe encore que « le sommet ne le puisse plus ». 2) Aggravation, plus qu’à l’ordinaire, de la misère et de la détresse des classes opprimées. 3) Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut, de l’activité des masses, qui se laissent tranquillement piller dans les périodes « pacifiques », mais qui, en période orageuse, sont poussées, tant par la crise dans son ensemble que par le » sommet » lui-même, vers une action historique indépendante.
« Sans ces changements objectifs, indépendants de la volonté non seulement de tels ou tels groupes et partis, mais encore de telles ou telles classes, la révolution est, en règle générale, impossible. C’est l’ensemble de ces changements objectifs qui constitue une situation révolutionnaire. On a connu cette situation en 1905 en Russie et à toutes les époques de révolutions en Occident. Elle a aussi existé dans les années 60 du siècle dernier, en Allemagne, de même qu’en 1859-1861 et 1879-1880 en Russie, bien qu’il n’y ait pas eu de révolutions à ces moments-là. Pourquoi ? Parce que la révolution ne surgit pas de toute situation révolutionnaire, mais seulement dans le cas où, à tous les changements objectifs ci-dessus énumérés, vient s’ajouter un changement subjectif, à savoir : la capacité, en ce qui concerne la classe révolutionnaire, de mener des actions révolutionnaires de masse assez vigoureuses pour briser complètement (ou partiellement) l’ancien gouvernement, qui ne « tombera » jamais, même à une époque de crise, si on ne le fait pas choir.
« Telle est la conception marxiste de la révolution, conception maintes et maintes fois développée et reconnue indiscutable par tous les marxistes et qui, pour nous autres Russes, a été confirmée avec un relief tout particulier par l’expérience de 1905 »
Même lorsque commence une révolution (qui est un produit de la lutte des classes), rien ne garantit qu’elle sera victorieuse. En 1979, nous avons vu le développement d’une extraordinaire révolution en Iran. Des Soviets ont même été formés. Au Nicaragua, nous avons eu une révolution avec la victoire du Front sandiniste. Mais dans aucun de ces cas nous n’avons vu la victoire de la révolution prolétarienne au sens de l’expropriation du capital. En Iran, la révolution a été brisée par le régime réactionnaire des ayatollahs. Au Nicaragua, après la création d’un Front populaire, puis d’un gouvernement bourgeois, la droite l’a emporté.
Dans le Manifeste d’alarme, en 1940, Trotsky expliquait les conditions nécessaires à la victoire du prolétariat :
« Les conditions fondamentales pour la victoire de la révolution prolétarienne ont été établies par l’expérience historique et sur le plan théorique : 1) L’impasse de la bourgeoisie et la confusion de la classe dominante qui en résulte. 2) Le vif mécontentement et l’aspiration à des changements décisifs dans les rangs de la petite bourgeoisie, sans le soutien de laquelle la grande bourgeoisie ne peut pas se maintenir. 3) La conscience du caractère intolérable de la situation et le fait qu’on soit, dans les rangs du prolétariat, prêts à des actions révolutionnaires. 4) Un programme clair et une direction ferme de l’avant garde prolétarienne. Telles sont les quatre conditions pour la victoire de la révolution prolétarienne. » (Manifeste de la Quatrième Internationale sur la guerre impérialiste et la révolution mondiale)
Le régime iranien est divisé de haut en bas. Pour ce qui est du second point, la classe moyenne s’est rangée dans le camp de la révolution. Des sections de la classe ouvrière ont participé en tant que telles, comme par exemple les chauffeurs de bus de Téhéran. On a même parlé de grève générale, mais cela ne s’est pas matérialisé, précisément du fait de l’absence du dernier facteur : un parti et une direction révolutionnaires.
Il y avait deux faiblesses déterminantes, dans ce mouvement spontané. La première, c’est précisément la faiblesse inhérente à la spontanéité. Il n’y avait pas de direction, pas de plan, pas de stratégie. Or les masses ne peuvent pas indéfiniment descendre dans la rue sans un plan clair.
Surtout, il n’y avait pas de participation concertée des travailleurs organisés. C’est la deuxième et la plus sérieuse des faiblesses. Cela souligne à nouveau les limites des dirigeants des travailleurs iraniens. Il y a eu beaucoup de grèves, en Iran, ces dernières années ; mais au moment décisif, où était la direction des travailleurs ? Malheureusement, la soi-disant « avant-garde » ouvrière n’a pas soutenu le mouvement et n’a pas appelé les travailleurs à s’y rallier.
En 1930, à l’époque des grandes manifestations étudiantes, en Espagne, Trotsky insistait pour que les travailleurs et les communistes espagnols soutiennent ces manifestations et avancent des revendications révolutionnaires démocratiques. En Iran, malheureusement, les dirigeants ouvriers n’ont pas pris part au mouvement. Une grève générale illimitée aurait porté le coup de grâce au régime, surtout si elle s’était accompagnée de la formation de shoras (conseils ouvriers). Mais cette revendication ne s’est jamais concrétisée, et l’occasion fut perdue.
En surface, il semblait que le régime avait repris le contrôle de la situation dans la foulée des manifestations du mois de juin 2009. Mais ce n’était pas le cas. Rien n’a été résolu et la division du régime s’est aggravée. Les critiques publiques de Rafsandjani n’ont pas cessé, tout comme les divergences parmi les ayatollahs. Les manifestations se sont poursuivies et ont repris de plus belle en septembre (journée « Al Qods »), en novembre et en décembre, où elles ont culminé lors du soulèvement de masse de l’Achoura.
Les masses ont fait preuve d’un grand courage en affrontant la police, l’armée et les Basijis, dans les rues. Elles étaient à l’offensive, ont attaqué les bâtiments des Basijis. Dans certains cas, des soldats ont désobéi à leurs officiers et refusé d’ouvrir le feu sur les manifestants.
Bien sûr, il ne faut pas confondre le premier mois d’une grossesse avec le neuvième. Mais une erreur plus grande serait de nier que la conception a eu lieu. Or, certains « marxistes » continuent de nier qu’une révolution a commencé, en Iran. Certains, comme James Petras, commettent la petite erreur de confondre révolution et contre-révolution. D’autres ne vont pas aussi loin, dans l’erreur, mais nient tout de même qu’il y ait une révolution, en Iran, parce que la classe ouvrière et les marxistes ne sont pas à la tête du mouvement. Ils ergotent et coupent les cheveux en quatre d’une façon purement doctrinaire. Mais pour les masses, il ne fait aucun doute qu’une révolution a commencé, en Iran.
Pour prétendre diriger les masses, il faut déjà comprendre la nature réelle du mouvement. A ses débuts, il est forcément hétérogène, confus et politiquement naïf. En Iran, la révolution en est encore à la phase précoce des illusions démocratiques. Comment pourrait-il en être autrement, après des décennies d’une monstrueuse dictature ? Si les marxistes iraniens ne sont pas en mesure de se connecter au mouvement réel, en avançant les mots d’ordre révolutionnaires démocratiques adéquats, ils seront condamnés à n’être qu’une secte commentant le mouvement de l’extérieur.
Lorsqu’on dit que la révolution a commencé, en Iran, cela ne signifie pas que les travailleurs prendront le pouvoir lundi prochain, à 9 heures du matin. Au contraire, du fait de l’absence du facteur subjectif (le parti révolutionnaire), la révolution s’étendra sur une longue période, avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Comme dans l’Espagne des années 30, où la révolution a duré près de sept ans, les périodes d’intense activité seront suivies par des périodes de fatigue, de déception – et même de réaction. Mais ces périodes ne seront que le prélude à des nouvelles irruptions – de plus en plus explosives – des masses.
Lorsque la révolution de 1979 approchait, en Iran, le Shah Mohammad Reza Pahlavi vacillait entre conciliation et répression brutale. Mais rien ne pouvait sauver son régime. A présent, le Guide Suprême Khamenei est dans une situation similaire.
Mir Hosein Moussavi cherche désespérément un accord avec le régime. Mais aucune de ses offres de conciliation n’a été entendue. Le Guide Suprême a fait savoir à ses critiques qu’il ne leur accorderait sa clémence que s’ils se repentaient et sollicitaient sa miséricorde. Certains pourraient y être disposés ; mais, dans le même temps, ils sentent sur leur nuque le souffle chaud de la Révolution.
Certains des dirigeants plus intelligents sont exaspérés par l’inflexibilité de Khamenei. Ils préconisent des concessions, au nom de l’unité nationale. A plusieurs reprises, depuis le mois de juin, des politiciens et des religieux ont proposé des mesures telles que la libération des prisonniers politiques, la mise en place d’une commission électorale impartiale et le relâchement du contrôle du régime sur la télévision et la radio. Mais Khamenei a tout rejeté en bloc.
A présent, cinq éminents intellectuels en exil (Abdoul Karim Soroush, Mohsen Kadivar, Ataollah Mohajerani, Akbar Ganji et Abdolali Bazargan) ont publié un manifeste appelant à la levée des restrictions sur les activités politiques, universitaires et médiatiques, ainsi qu’au retour dans les casernes de la « Garde révolutionnaire ». Ils proposent également que le Guide Suprême soit élu pour une durée déterminée, qu’il ne puisse plus bloquer l’activité parlementaire via le Conseil des Gardiens, et enfin qu’il ne puisse plus nommer le n°1 du système judiciaire. En bref, ils demandent poliment au diable de se couper les griffes !
Cela n’aura aucun effet sur le régime, qui dispose toujours d’un puissant appareil de répression. Les récentes funérailles de l’ayatollah Hosein Ali Montazeri ont montré que le mouvement révolutionnaire de masse est encore très vivace – et pas du tout enclin aux compromis. Les slogans étaient plus radicaux qu’auparavant, ce qui indique une élévation de la conscience des masses. The Economist du 7 janvier 2010 rapporte :
« Le 21 décembre, le jour des funérailles, des milliers de Téhéranais de la classe moyenne ont convergé vers la ville sainte de Qom, un bastion du conservatisme clérical. Dans les rues entourant le grand sanctuaire de Qom, ils ont uni leurs forces à celles des milliers d’Iraniens provinciaux et traditionnels, adeptes fervents des enseignements de Montazeri – et tous ont hurlé des insultes à quelques-unes des figures dirigeantes de la République islamique. « C’était un grand jour pour la ville », commentait un témoin oculaire. « Les gens ne pouvaient croire qu’ils entendaient de tels slogans – qui plus est à Qom. » »
Les manifestants ont subi de lourdes pertes : au moins huit morts, de nombreux blessés et beaucoup d’arrestations. Mais cette répression sauvage n’a pas brisé la détermination des masses. Plusieurs sources rapportent que de nombreux manifestants ont répondu violemment aux assauts des Basijis, en criant des slogans contre Khamenei. A présent, on ne parle plus de « non-violence ». Le mouvement ne cesse de se radicaliser. Au fur et à mesure que les masses ont moins peur, des fissures apparaissent dans l’appareil répressif. Des soldats ont refusé de tirer sur la foule.
Moussavi s’efforce de parvenir à un accord avec le régime dans l’objectif de stopper le mouvement. Il est revenu sur l’idée que le gouvernement d’Ahmadinejad était illégal, en disant que « toutes les exigences de l’opposition ne peuvent pas être remplies en même temps ». Mais cela n’impressionne pas du tout le Guide Suprême. Le 30 décembre, le gouvernement a organisé une contre-manifestation, dans le centre de Téhéran, où la foule demandait que Moussavi et ses partisans soient exécutés « parce qu’ils font la guerre à Dieu ». Les religieux et la presse les plus réactionnaires demandent que Moussavi et Karroubi soient exécutés. Et si Khamenei ne s’est pas résolu à le faire, c’est parce qu’il craint d’en faire des martyrs et de provoquer des manifestations encore plus violentes et radicales.
En réalité, les dirigeants bourgeois de l’opposition sont le meilleur espoir de survie du régime. Dans la première semaine de janvier, Ezzatollah Sahabi, un critique du régime, a publié une lettre ouverte dans laquelle il appelait le mouvement à ne pas glisser vers « le radicalisme et la violence ». Il écrivait : « Une révolution en Iran, aujourd’hui, n’est ni possible, ni souhaitable. » Et il expliquait que si les religieux modérés et conservateurs devaient choisir entre une révolution et le statu quo, ils choisiraient la stabilité. Cela ne fait pas l’ombre d’un doute. Mais l’opposition des « modérés » et des « conservateurs » à tout mouvement révolutionnaire n’est pas un fait nouveau – et n’arrêtera pas le mouvement.
Le 11 février, les célébrations officielles de l’anniversaire de la révolution de 1979 verront une nouvelle flambée du mouvement. Des centaines de milliers de personnes descendront dans la rue, encore une fois. Mais Khamenei ne cédera pas. Comme l’écrit à juste titre The Economist :
« Khamenei semble penser que faire des concessions sous la pression est plus un signe de faiblesse que de sagesse. Aussi se contente-t-il de vagues appels à l’unité nationale, alors même que les Basijis répriment les chefs de l’opposition et que les gardiens de prisons torturent et violent ». Mais le même article ajoute :
« Après avoir survécu plus de deux décennies à la tête de la plus haute instance de l’Etat iranien, M. Khamenei paraît désormais très affaibli. En refusant d’organiser de nouvelles élections dans la foulée du scrutin de juin [2009], il a dirigé contre lui-même une grande partie de la colère qui était d’abord dirigée contre le président Ahmadinejad. Il n’y a pas si longtemps, très peu de Téhéranais auraient osé murmurer : « Mort à Khamenei ! « . Aujourd’hui, ce slogan est un lieu commun. » (The Economist du 7 janvier 2010)
La chute du régime peut être reportée de six mois, douze mois – voire plus. Mais elle est inévitable. Et s’ouvrira alors une période de très grande instabilité, dans le pays. Cela aura d’énormes répercussions dans toute la région – et au-delà. Dans ce contexte, il faut lutter pour les revendications démocratiques les plus avancées. Ici s’impose une lutte puissante pour une Assemblée Constituante démocratique et révolutionnaire, de façon à balayer toutes les institutions existantes et reconstruire le pays selon la volonté des travailleurs. La lutte pour une Assemblée Constituante doit être combinée avec la lutte pour une grève générale et la constitution de soviets (shoras). Sur cette base, le régime serait fini, et la voie serait ouverte au transfert du pouvoir à la classe ouvrière.
Nous ne pouvons pas être précis sur la nature du régime qui succédera aux Mollahs. Il est probable que dans un premier temps, il s’agira d’un régime de type démocratique-bourgeois, comme en Russie après la révolution de Février 1917, ou encore en Espagne après la chute de la monarchie, en 1931. Mais nous savons d’ores et déjà ce que ce régime ne sera pas : ce ne sera pas un régime islamique fondamentaliste. La révolution iranienne mettra un terme à la folie fondamentaliste qui sévit au Moyen-Orient. Elle va transformer radicalement la situation au Pakistan, en Afghanistan, et aura un impact majeur en Inde et dans toute l’Asie. Les régimes comme l’Egypte, la Jordanie et l’Arabie Saoudite n’y résisteront pas.
Les idées de la TMI ont déjà eu un écho, en Iran. Nos articles ont été immédiatement traduits en persan et diffusés, sur place. Ils ont eu un excellent écho. Nous devons discuter des problèmes et des perspectives de la révolution iranienne. C’est une question urgente. Il nous faut élaborer les mots d’ordre, le programme et la tactique corrects, de façon à préparer une intervention décisive dans les événements tumultueux qui se préparent.