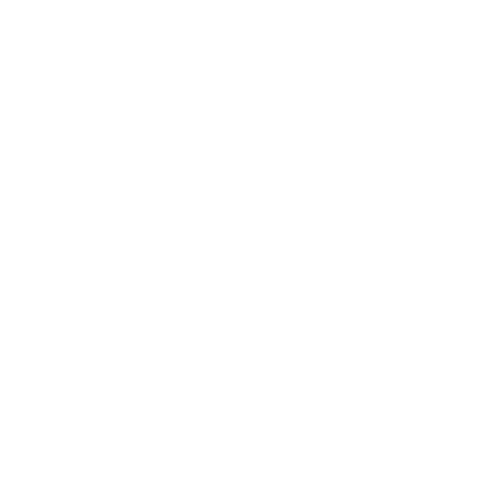La révolution de 1905 ne fut pas seulement la « répétition générale » de celle de 1917, mais se trouva être aussi le laboratoire où s’élaborèrent tous les groupements fondamentaux de la pensée politique russe et où se formèrent et se dessinèrent toutes les tendances et nuances à l’intérieur du marxisme russe. Au centre des disputes et des désaccords se trouvait, cela va de soi, la question du caractère historique de la révolution russe et des voies ultérieures de son développement.
En soi, cette lutte des conceptions et des pronostics ne concerne pas directement la biographie de Staline, qui n’y prit aucune part indépendante. Les quelques articles de propagande écrits par lui sur ce thème ne présentent pas le moindre intérêt théorique. Des dizaines de bolcheviks, la plume à la main, popularisèrent les mêmes idées, et le firent bien mieux que lui. Un exposé critique de la conception que le bolchevisme se faisait du déroulement de la révolution doit naturellement entrer dans la biographie de Lénine. Pourtant, les théories ont leur sort. Si, dans la période de la première révolution et plus tard, jusqu’en 1923, lorsque les doctrines révolutionnaires s’élaboraient et étaient mises à exécution, Staline n’occupait aucune position indépendante, à partir de 1924 la situation changea brusquement. Une période de réaction bureaucratique et de révision radicale du passé s’ouvre alors. Le film de la révolution se déroule à l’envers. Les anciennes doctrines sont soumises à une nouvelle appréciation ou à une nouvelle interprétation. De façon tout à fait inattendue, à première vue, au centre de l’attention vient ainsi se placer la conception de la « révolution permanente », source première de tous les égarements du « trotskysme ».
Au cours des années suivantes, la critique de cette conception constitue le contenu principal de l’activité théorique – sit venia verbo – de Staline et de ses collaborateurs. On peut dire que tout le « stalinisme », pris sur le plan « théorique », est sorti de la critique de la théorie de la révolution permanente telle qu’elle avait été formulée en 1905. Aussi, un exposé de cette théorie, marquant ce qui la distingue des théories des mencheviks et des bolcheviks, ne peut-il manquer d’entrer dans ce livre, ne fût-ce que sous forme d’appendice.
L’évolution de la Russie se caractérise avant tout par son retard. Un retard historique ne signifie pas, pourtant, une simple répétition de l’évolution des pays avancés, avec un délai de cent ou deux cents ans, mais engendre une formation sociale tout à fait nouvelle, « combinée », dans laquelle les dernières conquêtes de la technique et de la structure capitalistes s’implantent dans les rapports sociaux de la barbarie féodale et pré-féodale, les transforment et se les subordonnent, créant ainsi une relation originale entre les classes. Il en va de même dans le domaine des idées. Précisément par suite de son retard historique, la Russie se trouva être le seul pays européen où le marxisme, en tant que doctrine, et la social-démocratie, en tant que parti, aient pris un grand développement avant la révolution bourgeoise. Il est naturel aussi que ce soit en Russie que le problème des rapports entre la lutte pour la démocratie et la lutte pour le socialisme ait subi l’élaboration théorique la plus approfondie.
Les démocrates idéalistes, surtout les populistes, se refusaient superstitieusement à reconnaître la révolution qui approchait comme bourgeoise. Ils l’appelaient « démocratique », tentant ainsi de masquer par une formule politique neutre son contenu social, non seulement aux autres, mais aussi à eux-mêmes. Pourtant, le fondateur du marxisme russe, Plekhanov, dans sa lutte contre le populisme, avait déjà expliqué dans les années 1880-1890 que la Russie n’avait aucune raison de compter sur des voie privilégiées d’évolution ; que, tout comme les nations « profanes », elle devrait passer par le purgatoire du capitalisme et que c’était précisément dans cette voie qu’elle conquerrait la liberté politique nécessaire au prolétariat dans sa lutte ultérieure pour le socialisme. Non seulement Plekhanov séparait la révolution bourgeoise, en tant que première tâche, de la révolution socialiste, qu’il rejetait dans un avenir indéterminé, mais il traçait pour chacune d’elles une combinaison de forces tout à fait différente. Le prolétariat obtiendrait la liberté politique en alliance avec la bourgeoisie libérale ; après de longues dizaines d’années, à un niveau élevé du développement capitaliste, le prolétariat accomplirait la révolution socialiste en luttant directement contre la bourgeoisie.
« A l’intellectuel russe… écrivait à son tour Lénine à la fin de 1904, il semble toujours que reconnaître notre révolution comme bourgeoise, c’est la décolorer, la rabaisser, la vulgariser… Pour le prolétariat, la lutte pour la liberté politique et la république démocratique dans la société bourgeoise n’est qu’une des étapes nécessaires dans la lutte pour la révolution sociale. »
« Les marxistes sont absolument convaincus, écrivait-il en 1905, du caractère bourgeois de la révolution russe. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les réformes démocratiques, qui sont devenues une nécessité pour la Russie, non seulement ne signifient pas encore en elles-mêmes une atteinte au capitalisme, une atteinte à la domination de la bourgeoisie, mais, au contraire, elles vont pour la première fois vraiment déblayer le terrain pour un développement large et rapide, européen et non asiatique, du capitalisme. Elles vont pour la première fois rendre possible la domination de la bourgeoisie en tant que classe… » « Nous ne pouvons sauter hors des cadres bourgeois-démocratiques de la révolution russe, insiste-t-il, mais nous pouvons dans une formidable mesure élargir ces cadres », c’est-à-dire créer dans la société bourgeoise des conditions plus favorables à la lutte ultérieure du prolétariat. Dans ces limites, Lénine suivait Plekhanov. Le caractère bourgeois de la révolution était le point de départ des deux fractions de la social-démocratie russe.
Dans de telles conditions, il est tout à fait naturel que Koba [Staline], dans sa propagande, ne soit pas allé plus loin que ces formules populaires, qui constituaient l’avoir commun des bolcheviks et des mencheviks. « L’Assemblée constituante, élue sur les bases du suffrage universel, égal, direct et secret, écrivait-il en janvier 1905, voilà ce pour quoi il nous faut maintenant lutter ! Seule une telle assemblée nous donnera la république démocratique, qui nous est extrêmement nécessaire dans notre lutte pour le socialisme. » La république bourgeoise envisagée comme l’arène dune longue lutte de classe avec le socialisme pour but, telle est la perspective. En 1907, c’est-à-dire après d’innombrables discussions dans la presse publiée à l’étranger et à Pétersbourg, et après une sérieuse vérification des pronostics théoriques par l’expérience de la première révolution, Staline juge possible d’écrire : « Que notre révolution soit bourgeoise, qu’elle doive se terminer par l’écrasement du servage et non de l’ordre capitaliste, que seule la république démocratique puisse en être le couronnement, là-dessus, semble-t-il, tout le monde est d’accord dans notre Parti. » Staline ne parle pas du point où la révolution doit commencer, mais de celui où elle doit finir, et, d’avance, il la limite d’une façon tout à fait catégorique à la « république démocratique seulement ». Nous chercherions en vain dans ses écrits d’alors ne fût-ce qu’une remarque sur la perspective de la révolution socialiste en liaison avec la révolution démocratique. Telle reste encore sa position au début de la révolution de février I917, jusqu’à l’arrivée de Lénine à Pétrograd.
Pour Plekhanov, Axelrod et en général les chefs du menchevisme, le fait de caractériser sociologiquement la révolution comme bourgeoise avait avant tout pour valeur politique d’interdire de harceler prématurément la bourgeoisie avec le spectre rouge du socialisme et de la « rejeter » dans le camp de la réaction. « Les rapports sociaux de la Russie ne sont mûrs que pour la révolution bourgeoise » disait le principal tacticien du menchevisme, Axelrod, au congrès d’unification. « Avec l’arbitraire politique général qui règne chez nous, il ne peut être question d’un combat immédiat du prolétariat contre les autres classes pour conquérir le pouvoir politique… Il lutte pour établir les conditions d’un développement bourgeois. Les conditions historiques objectives vouent notre prolétariat à une collaboration inévitable avec la bourgeoisie dans la lutte contre 1’ennemi commun. » Le contenu de la révolution russe était ainsi limité d’avance aux réformes compatibles avec les intérêts et les vues de la bourgeoisie libérale.
C’est précisément à ce point que commençait le désaccord fondamental entre les deux fractions. Le bolchevisme se refusait résolument à reconnaître que la bourgeoisie russe fût capable de mener à bien sa propre révolution. Avec incomparablement plus de vigueur et de conséquence que Plekhanov, Lénine mettait en avant la question agraire comme le problème central de la révolution démocratique en Russie. « Le noeud de la révolution russe, répétait-il, c’est la question agraire (de la terre). Il faut conclure à la défaite ou à la victoire de la révolution… selon la manière dont on apprécie la situation des masses dans la lutte pour la terre. » Avec Plekhanov, Lénine considérait la paysannerie comme une classe petite-hourgeoise et le programme agraire paysan comme le programme du progrès bourgeois. « La nationalisation [de la terre], c’est une mesure de la bourgeoisie », insistait-il au Congrès d’unification. « Elle donnera une impulsion au développement du capitaliste en exacerbant la lutte des classes, en permettant une utilisation plus complète de la terre, en faisant affluer le capital dans l’agriculture, en abaissant le prix du pain. » Malgré le caractère manifestement bourgeois de la révolution agraire, la bourgeoisie russe reste, pourtant, hostile à 1’expropriation de la grande propriété foncière, et c’est précisément pourquoi elle s’efforce d’arriver à un compromis avec la monarchie, sur la base d’une Constitution du type prussien. A l’idée de Plekhanov d’une alliance du prolétariat avec la bourgeoisie libérale, Lénine opposait l’idée d’une alliance du prolétariat avec la paysannerie. Il proclamait que la tâche de la collaboration révolutionnaire de ces deux classes était d’établir une « dictature démocratique » comme le seul moyen de purger radicalement la Russie du bric-à-brac féodal, de créer une couche de petits cultivateurs libres et d’ouvrir la voie au développement du capitalisme, non pas à la manière prussienne, mais américaine.
La victoire de la révolution, écrivait-il, ne peut être accomplie que « par la dictature, parce que la réalisation des réformes qui sont immédiatement et absolument nécessaires au prolétariat et à la paysannerie provoquera une résistance désespérée chez les propriétaires fonciers, les grands bourgeois et le tsarisme. Sans dictature, il est impossible de briser cette résistance, de repousser les tentatives contre-révolutionnaires. Ce sera, bien entendu, une dictature, non pas socialiste, mais démocratique. Elle ne pourra porter atteinte aux fondements du capitalisme (sans toute une série d’étapes intermédiaires dans le développement révolutionnaire). Elle pourra, dans le meilleur des cas, introduire une redistribution radicale de la propriété foncière en faveur de la paysannerie, établir une démocratie conséquente et complète allant jusqu’à la république, extirper tous les traits asiatiques, tout le legs du servage, non seulement au village, mais aussi dans les usines, poser la base d’une amélioration sérieuse de la situation des ouvriers et de l’élévation de leur niveau de vie ; enfin, last but not least, porter la conflagration révolutionnaire en Europe. »
La conception de Lénine représentait un immense pas en avant, en tant qu’elle partait, non pas de réformes constitutionnelles, mais du soulèvement paysan, considéré comme la tâche centrale de la révolution, et indiquait la seule combinaison réelle de forces sociales qui plût conduire ce soulèvement à bonne fin. Le point faible de la conception de Lénine était, pourtant, la notion, contradictoire en soi, de « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie ». Lénine lui-même soulignait la limitation fondamentale de cette « dictature » quand, franchement, il l’appelait bourgeoise. Il voulait dire par là que, pour sauvegarder son alliance avec la paysannerie, le prolétariat serait forcé, dans la révolution imminente, de renoncer à poser immédiatement des tâches socialistes. Mais cela signifiait aussi que le prolétariat renoncerait à sa dictature. Il s’agissait au fond, par conséquent, de la dictature de la paysannerie, avec la participation des ouvriers. C’est précisément ce que dit Lénine en certaines occasions, par exemple au congrès de Stockholm, où il répliqua à Plekhanov, qui s’était élevé contre « l’utopie » de la prise du pouvoir : « De quel programme s’agit-il ? Du programme agraire. Qui est supposé prendre le pouvoir, dans ce programme ? Les paysans révolutionnaires. Lénine confond-il le pouvoir du prolétariat avec celui de la paysannerie ? » Non, dit-il en parlant de lui- même, Lénine distingue nettement le pouvoir socialiste du prolétariat du pouvoir bourgeois-démocratique de la paysannerie. « Et comment une révolution paysanne victorieuse, s’écrie-t-il de nouveau, serait-elle possible sans que la paysannerie révolutionnaire prit le pouvoir ? »Par cette expression polémique, Lénine révèle d’une façon particulièrement nette la vulnérabilité de sa position.
La paysannerie est dispersée sur l’étendue d’un vaste pays, dont les villes forment les points nodaux. A elle seule, elle est incapable même de formuler ses intérêts, car dans chaque région elle se les représente d’une manière différente. Le lien économique entre les provinces est créé par le marché et les chemins de fer ; mais marché et chemins de fer sont aux mains de la ville. En tentant de s’arracher à l’étroitesse du village et de mettre ses intérêts en commun, la paysannerie tombe inévitablement dans la dépendance politique de la ville. Enfin, la paysannerie ne forme pas une classe homogène par ses rapports sociaux : la couche des koulaks s’efforce naturellement de l’attirer dans une alliance avec la bourgeoisie des villes ; les couches inférieures du village tendent, au contraire, vers les ouvriers des villes. Dans ces conditions, la paysannerie, en tant que paysannerie, est absolument incapable de prendre le pouvoir.
Certes, dans la Chine ancienne, les révolutions portaient au pouvoir la paysannerie, et plus exactement les chefs militaires de l’insurrection paysanne. Cela aboutissait chaque fois à un repartage des terres et à l’instauration d’une nouvelle dynastie « paysanne », après quoi l’histoire recommençait à nouveau : nouvelle concentration des terres, nouvelle aristocratie, nouvel épanouissement de l’usure, nouvelle insurrection. Tant que la révolution garde son caractère purement paysan, la société ne sort pas de ces rotations sans issue. Telle est la base de l’histoire ancienne asiatique, y compris l’histoire ancienne russe. En Europe, à partir de la fin du Moyen Age, chaque insurrection paysanne victorieuse portait au pouvoir, non pas un gouvernement paysan, mais un parti bourgeois de gauche. Pour parler plus exactement, l’insurrection paysanne se trouvait victorieuse précisément dans la mesure où elle réussissait à affermir la position de la partie révolutionnaire de la population de la ville. Dans la Russie bourgeoise du XXe siècle, il ne pouvait plus être question de la prise du pouvoir par la paysannerie révolutionnaire.
L’attitude envers la bourgeoisie libérale était, comme on l’a dit, la pierre de touche dans les délimitations entre révolutionnaires et opportunistes parmi les social-démocrates. Jusqu’où la révolution russe peut-elle aller, quel caractère prendra le futur gouvernement révolutionnaire provisoire, quelles seront ses tâches et dans quel ordre se poseront-elles ? Ces questions, avec toute leur importance, ne pouvaient être correctement posées qu’en les rattachant à celle du caractère fondamental de la politique du prolétariat, et ce caractère était avant tout déterminé par l’attitude envers la bourgeoisie libérale. Plekhanov ferma manifestement et obstinément les yeux sur la conclusion fondamentale de l’histoire politique du XIXe siècle : là où le prolétariat apparaît comme une force indépendante, la bourgeoisie passe dans le camp de la contre-révolution. Plus la lutte des masses est hardie, plus la dégénérescence réactionnaire du libéralisme est rapide. Personne n’a encore inventé de moyens pour paralyser l’action de la loi de la lutte des classes.
« Il nous faut faire cas du soutien des partis non prolétariens, répétait Plekhanov dans les années de la première révolution, et ne pas les repousser par des incartades manquant de tact. » Par de monotones leçons de morale de ce genre, le philosophe du marxisme montrait que le dynamisme vivant de la société lui était resté inaccessible. Le « manque de tact » peut repousser un intellectuel isolé trop sensible. Les classes et les partis sont attirés ou repoussés par des intérêts sociaux. « On peut dire avec certitude, répliquait Lénine à Plekhanov, que les propriétaires fonciers qui sont libéraux vous pardonneront des millions d’actes qui manquent de tact, mais ne vous pardonneront pas des appels à la saisie des terres. » Et pas seulement les propriétaires fonciers ; les sommets de la bourgeoisie, liés aux propriétaires fonciers par les intérêts qui unissent tous les possédants et, plus étroitement, par le système des banques ; les sommets de la petite bourgeoisie et de « l’intelligentsia », matériellement et moralement dépendant des possédants grands et moyens ; tous craignaient le mouvement indépendant des masses. Cependant, pour abattre le tsarisme, il fallait dresser des dizaines de millions d’opprimés en une offensive révolutionnaire héroïque, prête aux sacrifices, téméraire, ne s’arrêtant devant rien. Dresser les masses en une insurrection, cela ne pouvait se faire que sous le drapeau de leurs propres intérêts, et par conséquent dans un esprit d’hostilité implacable envers les classes exploitantes, à commencer par les propriétaires fonciers. « Repousser » la bourgeoisie oppositionnelle, l’éloigner des ouvriers et des paysans révolutionnaires, c’était donc la loi immanente de la révolution elle-même et cela ne pouvait être évité par de la diplomatie et du « tact ».
Chaque nouveau mois confirmait l’appréciation léniniste du libéralisme. En dépit des meilleurs espoirs des mencheviks, non seulement les cadets ne se disposaient pas à se mettre à la tête de la révolution « bourgeoise », mais au contraire ils trouvaient de plus en plus que leur mission historique était de lutter contre elle. Après l’écrasement de l’insurrection de Décembre, les libéraux, qui occupaient, grâce à l’éphémère Douma, l’avant-scène politique, essayaient de toutes leurs forces de se justifier devant la monarchie de leur conduite contre-révolutionnaire insuffisamment active en automne 1905, quand les fondements les plus sacrés de la « culture » étaient en danger. Le chef des libéraux, Milioukov, qui menait des pourparlers dans les coulisses avec le Palais d’hiver, montra d’une façon tout à fait juste, dans la presse, qu’à la fin de 1905 les cadets ne pouvaient même pas paraître devant les masses. « Ceux qui reprochent maintenant au parti (cadet), écrivait-il, de n’avoir pas protesté alors en organisant des meetings contre les illusions révolutionnaires du trotskysme… ne comprennent ou ne se rappellent tout simplement pas l’état d’esprit du public démocratique qui venait aux meetings. » Par « illusions du trotskysme », le chef libéral entendait la politique indépendante du prolétariat, qui attirait aux soviets la sympathie des classes inférieures des villes, des soldats, des paysans et de tous les opprimés, et par là même repoussait la société « cultivée ». L’évolution des mencheviks se développait suivant une ligne parallèle. Il leur fallait de plus en plus souvent se justifier devant les libéraux de s’être trouvés, après octobre 1905, dans un bloc avec Trotsky. Les explications de Martov, talentueux publiciste des mencheviks, se réduisaient à dire qu’il avait fallu faire des concessions aux « illusions révolutionnaires » des masses.
A Tiflis, les groupements politiques s’étaient formés sur la même base de principe qu’à Pétersbourg. « Ecraser la réaction, écrivait le chef des mencheviks du Caucase, Jordania, obtenir et mettre en pratique une constitution, cela dépendra de l’union consciente des forces du prolétariat et de la bourgeoisie et de leur direction vers un but unique… Certes, la paysannerie sera incluse dans le mouvement et elle lui donnera le caractère d’une force élémentaire de la nature, mais c’est malgré tout ces deux classes qui joueront le rôle décisif et le mouvement paysan apportera de l’eau à leur moulin. » Lénine se moquait des craintes de Jordania, pour qui une politique intransigeante envers la bourgeoisie pouvait vouer les ouvriers à l’impuissance. Jordania « examine la question d’un possible isolement du prolétariat dans la révolution démocratique et oublie… la paysannerie ! Parmi les alliés possibles du prolétariat, il voit et trouve à son goût les propriétaires libéraux et ne voit pas les paysans. Et cela au Caucase ! »Juste quant au fond, la réplique de Lénine simplifiait la question sur un point. Jordania n’« oubliait » pas la paysannerie et, comme il ressort de la remarque de Lénine lui-même, nul ne pouvait l’oublier au Caucase, où elle se dressait alors impétueusement sous le drapeau du menchevisme. Jordania, pourtant, voyait dans la paysannerie non pas tant un allié politique qu’un bélier politique que la bourgeoisie, alliée au prolétariat, pouvait et devait utiliser. Il ne croyait pas que la paysannerie fût capable de devenir une force dirigeante ou même indépendante dans la révolution, et en cela il ne se trompait pas ; mais il ne croyait pas non plus que le prolétariat fût capable, en tant que chef, d’assurer la victoire de l’insurrection paysanne, et c’est là qu’était son erreur fatale. L’idée menchevique de l’alliance du prolétariat avec la bourgeoisie signifiait en fait la subordination aux libéraux des ouvriers aussi bien que des paysans. Le caractère utopique et réactionnaire de ce programme venait de ce que la différenciation des classes, déjà fort avancée, paralysait d’avance la bourgeoisie comme facteur révolutionnaire. Dans cette question fondamentale, la vérité était entièrement du côté du bolchevisme : la poursuite d’une alliance avec la bourgeoisie libérale devait inévitablement opposer la social-démocratie au mouvement révolutionnaire des ouvriers et des paysans. En 1905, les mencheviks n’eurent pas encore le courage de tirer toutes les conclusions inéluctables de leur théorie de la révolution « bourgeoise ». En 1917, ils poussèrent leurs idées jusqu’au bout et se rompirent le cou.
Dans la question de l’attitude envers les libéraux, Staline se trouvait, dans les années de la première révolution, du côté de Lénine. Il faut dire qu’à cette période, même la majorité des mencheviks du rang, quand il était question de la bourgeoisie oppositionnelle, se trouvait plus près de Lénine que de Plekhanov. Une attitude méprisante envers les libéraux constituait la tradition littéraire du radicalisme intellectuel. Ce serait, pourtant, peine perdue que de chercher chez Staline une contribution indépendante à cette question, une analyse des rapports sociaux au Caucase, des arguments nouveaux ou même l’expression nouvelle de vieux arguments. Le chef des mencheviks du Caucase, Jordania, avait une attitude incomparablement plus indépendante envers Plekhanov que Staline envers Lénine. « C’est en vain que messieurs les libéraux s’efforcent, écrivait Staline après le 9 janvier, de sauver le trône croulant du tsar. C’est en vain qu’ils tendent au tsar une main secourable !… Les masses populaires qui s’agitent se préparent à la révolution et non à un arrangement avec le tsar… Oui, messieurs, vains sont vos efforts ! La révolution russe est inévitable, aussi inévitable que le lever du soleil ! Pouvez-vous empêcher le soleil de se lever ? Voilà la question ! » Et ainsi de suite. Staline ne s’élève pas au-dessus de cela. Deux ans et demi plus tard, il écrivait, répétant Lénine presque mot pour mot : « La bourgeoisie libérale russe est contre-révolutionnaire, elle ne peut être le moteur, encore moins le chef de la révolution ; elle est l’ennemie jurée de la révolution et contre elle il faut mener une lutte opiniâtre. » Pourtant, précisément dans cette question fondamentale, Staline fit une métamorphose complète dans les dix ans qui suivirent, de sorte qu’il a pu accueillir la révolution de Février 1917 en partisan d’un bloc avec la bourgeoisie libérale et, par conséquent, en héraut de l’union avec les mencheviks dans un seul parti. C’est seulement Lénine, revenu de l’étranger, qui mit brusquement fin à la politique indépendante de Staline, qu’il qualifia de dérision du marxisme.
Les populistes ne voyaient dans les ouvriers et les paysans que des « travailleurs » et des « exploités », également intéressés au socialisme. Les marxistes considéraient le paysan comme un petit-bourgeois, qui ne pouvait devenir socialiste que dans la mesure où, soit matériellement, soit spirituellement, il cessait d’être un paysan. Avec la sentimentalité qui leur était propre, les populistes regardaient cette caractéristique sociologique comme un affront à la paysannerie. C’est sur cette ligne que se mena pendant deux générations la lutte principale entre les tendances révolutionnaires de Russie. Pour comprendre les disputes ultérieures entre stalinisme et trotskysme, il faut souligner encore une fois que, suivant la tradition marxiste, Lénine ne considéra pas un seul instant la paysannerie comme une alliée socialiste du prolétariat ; au contraire, il conclut à l’impossibilité de la révolution socialiste en Russie précisément par suite de l’énorme prédominance de la paysannerie. Cette idée se retrouve à travers tous ses articles qui, directement ou indirectement, touchent à la question agraire.
« Nous soutenons le mouvement paysan, écrivait Lénine en septembre 1905, en tant qu’il est révolutionnaire-démocratique. Nous nous préparons (maintenant même, immédiatement nous nous préparons) à lutter contre lui, en tant qu’il se montre réactionnaire, anti-prolétarien. Toute l’essence du marxisme est dans cette double tâche… » Lénine voyait un allié socialiste dans le prolétariat occidental, et en partie dans les éléments semi-prolétariens du village russe, mais nullement dans la paysannerie en tant que telle. « Au début, nous soutenons jusqu’au bout, par tous les moyens, y compris les confiscations, répétait-il avec l’insistance qui lui était propre, le paysan en général contre le propriétaire foncier et ensuite (et même pas ensuite, mais en même temps) nous soutenons le prolétariat contre le paysan en général. »
« La paysannerie vaincra dans la révolution bourgeoise-démocratique, écrit-il en mars 1906, et par là épuisera définitivement sa force révolutionnaire en tant que paysannerie. Le prolétariat vaincra dans la révolution bourgeoise-démocratique, et par là ne fera que commencer à déployer véritablement sa force révolutionnaire authentique, socialiste. » « Le mouvement de la paysannerie, répète-t-il en mai de la même année, est le mouvement d’une autre classe ; sa lutte n’est pas pour renverser les bases du capitalisme, mais pour les purger de tous les vestiges du servage. » On peut suivre cette manière de voir chez Lénine, d’article en article, d’année en année, de volume en volume. Les expressions et les exemples changent, l’idée fondamentale reste la même. Il ne pouvait en être autrement. Si Lénine avait vu dans la paysannerie une alliée socialiste, il n’aurait pas eu la moindre raison d’insister sur le caractère bourgeois de la révolution et de limiter la « dictature du prolétariat et de la paysannerie » à des tâches purement démocratiques. Quand Lénine m’accusait de « sous-estimer » la paysannerie, il n’avait nullement en vue mon refus de reconnaître les tendances socialistes de la paysannerie, mais, au contraire, le fait que je reconnaissais insuffisamment, selon lui, l’indépendance bourgeoise-démocratique de la paysannerie, sa capacité de créer son propre pouvoir et de faire ainsi obstacle à l’établissement de la dictature socialiste du prolétariat.
La révision des valeurs dans cette question ne commença que dans les années de réaction thermidorienne, dont le début coïncida approximativement avec la maladie et la mort de Lénine. Des lors, l’alliance des ouvriers et des paysans russes fut déclarée être une garantie suffisante en elle-même contre les dangers de restauration et un gage sûr de la réalisation du socialisme dans les limites de l’Union Soviétique. Après avoir remplacé la théorie de la révolution internationale par la théorie du socialisme dans un seul pays, Staline se mit à nommer « trotskisme » l’appréciation marxiste de la paysannerie, d’ailleurs non seulement pour le présent, mais aussi pour tout le passé.
On peut, bien entendu, poser la question de savoir si la conception marxiste de la paysannerie s’est avérée erronée. Ce sujet nous entraînerait loin des limites de la présente étude. Il suffit de dire ici que le marxisme n’a jamais donné à son appréciation de la paysannerie comme une classe non socialiste un caractère absolu et immuable. Marx lui-même dit que le paysan n’a pas seulement des préjugés, mais qu’il a aussi du jugement. Dans des conditions changeantes, la nature de la paysannerie elle-même change. Le régime de la dictature du prolétariat ouvrit de très larges possibilités d’agir sur la paysannerie et de la rééduquer. L’histoire n’a pas encore mesuré complètement les limites de ces possibilités. Néanmoins, il est clair dès maintenant que le rôle croissant de la contrainte étatique en URSS n’a pas infirmé, mais, au fond, a confirmé la conception de la paysannerie qui distinguait les marxistes russes des populistes. Pourtant, quelle que soit la façon dont se pose la question maintenant, après vingt ans du nouveau régime, il reste indubitable que, jusqu’à la Révolution d’Octobre, plus exactement jusqu’en 1924, personne dans le camp marxiste, et Lénine moins que quiconque, ne voyait dans la paysannerie un facteur socialiste de progrès. Sans l’aide de la révolution prolétarienne en Occident, répétait-il, la restauration est inévitable en Russie. Il ne se trompait pas : la bureaucratie stalinienne n’est rien d’autre que la première étape de la restauration bourgeoise.
Les positions initiales des deux fractions principales de la social-démocratie russe ont été exposées plus haut. Mais à côté d’elles, dès l’aube de la première révolution, une troisième position fut formulée qui ne rencontra presque aucune considération en ces années-là, mais que nous devons exposer ici aussi complètement qu’il se doit, non seulement parce que elle trouva sa confirmation dans les événements de 1917, mais surtout parce que, sept ans après la révolution, mise sens dessus dessous, elle se mit à jouer un rôle absolument imprévu dans l’évolution politique de Staline et de toute la bureaucratie soviétique.
Au début de 1905, je publiai à Genève une brochure qui analysait la situation politique telle qu’elle s’était formée en hiver 1904. J’arrivais à la conclusion que la campagne indépendante des pétitions et des banquets libéraux avait épuisé ses possibilités ; que l’intelligentsia radicale, après avoir mis ses espoirs dans les libéraux, se trouvait avec eux dans une impasse ; que le mouvement paysan créerait des conditions favorables à la victoire, mais ne serait pas capable de l’assurer ; que la décision ne pouvait être obtenue que par l’insurrection armée du prolétariat ; que la première étape dans cette voie devait être la grève générale. La brochure était intitulée Avant le 9 janvier, car elle avait été écrite avant le Dimanche sanglant de Pétersbourg. La forte vague de grèves qui commença ce jour-là, avec les premiers conflits armés qui la complétèrent, apporta une confirmation non équivoque au pronostic stratégique de la brochure.
La préface de mon ouvrage avait été écrite par Parvus, un émigré russe qui était déjà devenu à ce moment-là un écrivain allemand en vue. Parvus était une personnalité créatrice exceptionnelle, capable aussi bien d’être gagné par les idées d’autrui que d’enrichir autrui des siennes propres. Il lui manquait un équilibre interne et de l’application pour apporter au mouvement ouvrier une contribution digne de ses talents comme penseur et écrivain. Il eut indubitablement une influence sur mon développement personnel, surtout en ce qui est de la compréhension sociale-révolutionnaire de notre époque. Quelques années avant notre première rencontre, Parvus défendit passionnément l’idée d’une grève générale en Allemagne ; mais le pays traversait une longue période de prospérité industrielle, la social-démocratie s’adaptait au régime des Hohenzollern, la propagande révolutionnaire d’un étranger ne rencontrait qu’une indifférence ironique. Ayant pris connaissance, au lendemain des événements sanglants de Pétersbourg, de ma brochure encore manuscrite, Parvus fut séduit par l’idée du rôle exceptionnel que le prolétariat de la Russie arriérée était appelé à jouer. Les quelques jours que nous passâmes à Munich furent remplis d’entretiens qui, pour nous deux, éclaircirent bien des choses et nous rapprochèrent personnellement. La préface que Parvus écrivit alors même à ma brochure est entrée pour toujours dans l’histoire de la révolution russe. En quelques pages, il fit la lumière sur les particularités sociales de la Russie arriérée, qui, certes, étaient connues auparavant, mais dont nul avant lui n’avait tiré toutes les conclusions nécessaires.
« Le radicalisme politique en Europe occidentale, écrit Parvus, s’appuyait avant tout, comme on sait, sur la petite bourgeoisie. C’étaient les artisans, et en général toute cette partie de la bourgeoisie qui était happée par le développement industriel, mais en même temps repoussée par la classe des capitalistes… En Russie, dans la période précapitaliste, la ville se développa plutôt de la manière chinoise qu’européenne. Les villes étaient des centres administratifs, de caractère purement bureaucratique, sans la moindre importance politique et, sur le plan économique, des bazars pour le milieu artisanal et paysan qui les entourait. Leur développement était encore fort insignifiant quand il fut arrêté par le procès capitaliste, qui se mit à créer des grandes villes à sa manière, c’est-à-dire des villes d’usines et des centres du marché mondial… Ce qui empêcha le développement de la démocratie petite-bourgeoise favorisa l’apparition de la conscience de classe du prolétariat en Russie. Le prolétariat se trouva tout à coup concentré dans les usines…
« Les paysans seront entraînés dans le mouvement par masses de plus en plus grandes. Mais ils ne sont en état que d’augmenter l’anarchie politique du pays et d’affaiblir ainsi le gouvernement ; ils ne peuvent former une armée révolutionnaire serrée. C’est pourquoi, avec le développement de la révolution, une part de plus en plus grande de l’activité politique échoira au prolétariat. En même temps, sa conscience politique s’élargira, son énergie politique s’accroîtra…
« Devant la social-démocratie se posera le dilemme suivant : ou prendre sur soi la responsabilité du gouvernement provisoire, ou se mettre à l’écart du mouvement ouvrier. Les ouvriers considéreront ce gouvernement comme le leur, quelle que soit l’attitude de la social-démocratie… Seuls les ouvriers peuvent accomplir un soulèvement révolutionnaire en Russie. Le gouvernement révolutionnaire provisoire en Russie sera un gouvernement de démocratie ouvrière. Si la social-démocratie est à la tête du mouvement révolutionnaire du prolétariat russe, ce gouvernement sera social-démocrate…
« Le gouvernement provisoire social-démocrate ne peut accomplir en Russie une révolution socialiste, mais le procès même de la liquidation de l’autocratie et de l’établissement de la république démocratique créera un terrain favorable à l’activité politique. »
Dans le feu des événements révolutionnaires, en automne 1905, je rencontrai de nouveau Parvus, cette fois à Petersbourg. Tout en maintenant une indépendance d’organisation à l’égard des deux fractions, nous publiâmes ensemble un journal pour les masses ouvrières, Rousskoïé Slovo (La Parole russe), et, en coalition avec les mencheviks, un grand journal politique, Natchalo (Le Commencement). La théorie de la révolution permanente était ordinairement liée aux noms de Parvus et Trotsky. Ce n’était exact qu’en partie. La période de la plus grande activité révolutionnaire de Parvus se place à la fin du siècle dernier, quand il était à la tête de la lutte contre ce qu’on appela le « révisionnisme », c’est-à-dire la défiguration opportuniste de la théorie de Marx. L’échec des tentatives de faire entrer la social-démocratie allemande dans la voie d’une politique plus hardie mina son optimisme. Parvus devint de plus en plus réservé sur les perspectives de la révolution socialiste en Occident. Il pensait en même temps que « le gouvernement révolutionnaire provisoire ne pourrait accomplir en Russie une révolution socialiste ». Son pronostic n’était donc pas la transformation de la révolution démocratique en révolution socialiste, mais seulement l’établissement en Russie d’un régime de démocratie ouvrière, à l’exemple de l’Australie où, sur la base de la petite propriété paysanne, surgirait pour la première fois un gouvernement ouvrier qui ne sortirait pas des limites du régime bourgeois.
Je ne partageais pas cette conclusion. La démocratie australienne, croissant organiquement sur le sol vierge d’un continent presque neuf, prit immédiatement un caractère conservateur et se soumit un prolétariat jeune, mais assez privilégié. La démocratie russe, au contraire, ne pouvait surgir qu’à la suite d’un grandiose soulèvement révolutionnaire, dont le dynamisme ne permettrait en aucun cas à un gouvernement ouvrier de rester dans les cadres de la démocratie bourgeoise. Nés peu après la révolution de 1905, nos désaccords aboutirent à une rupture complète au début de la guerre, quand Parvus, en qui le sceptique avait définitivement tué le révolutionnaire, se trouva du côté de l’impérialisme allemand et devint plus tard le conseiller et l’inspirateur du premier président de la République allemande, Ebert.
Après avoir écrit ma brochure Avant le 9 janvier, je me remis plus d’une fois à développer la théorie de la révolution permanente et à en assurer les bases. Vu l’importance qu’elle prit par la suite dans l’évolution des idées du héros de cette biographie il est nécessaire de la présenter ici, sous forme de citations précises de mes écrits des années 1905 et 1906.
« Le noyau de la population d’une ville contemporaine, au moins d’une ville qui a une importance économico-politique, c’est une classe qui se distingue nettement, celle du travail salarié. C’est précisément cette classe, au fond encore inconnue dans la grande révolution française, qui est destinée à jouer dans la nôtre un rôle décisif… Dans un pays économiquement arriéré, le prolétariat peut se trouver au pouvoir plus tôt que dans un pays capitaliste avancé. L’idée que la dictature du prolétariat dépend en quelque sorte automatiquement des forces et des moyens techniques du pays représente le préjugé d’un matérialisme « économique » simplifié à l’extrême. Une telle conception n’a rien de commun avec le marxisme… Bien que les forces productives de l’industrie des Etats-Unis soient dix fois plus grandes que chez nous, le rôle politique du prolétariat russe, son action sur la politique de son pays, la possibilité qu’il influence bientôt la politique mondiale sont incomparablement plus grands que le rôle et l’importance du prolétariat américain… »
« Selon notre conception, la révolution russe créé précisément les conditions dans lesquelles le pouvoir peut (en cas de victoire, doit) passer dans les mains du prolétariat, avant que les politiciens du libéralisme bourgeois aient eu la possibilité de déployer complètement leur génie étatique… La bourgeoisie russe cèdera toutes les positions révolutionnaires au prolétariat. Il lui faudra aussi céder l’hégémonie révolutionnaire sur la paysannerie. Le prolétariat au pouvoir se présentera devant la paysannerie comme la classe émancipatrice… Le prolétariat, s’appuyant sur la paysannerie, mettra en mouvement toutes les forces pour élever le niveau culturel du village et développer la conscience politique de la paysannerie… »
« Mais, peut-être, la paysannerie elle-même évincera-t-elle le prolétariat et prendra-t-elle sa place ? C’est impossible. Toute l’expérience historique proteste contre cette supposition. Elle montre que la paysannerie est absolument incapable de jouer un rôle politique indépendant… Ce que nous avons dit montre clairement comment nous considérons l’idée de la « dictature du prolétariat et de la paysannerie ». Le fond de la question n’est pas de savoir si nous la jugeons permise par les principes, si nous « voulons » ou non une telle forme de coopération politique. Mais nous la croyons irréalisable, au moins dans le sens direct et immédiat… »
Ce qu’on vient de lire montre combien il est inexact d’affirmer que la conception exposée ici « sautait par-dessus la révolution bourgeoise », comme on ne cessa de le répéter plus tard. « La lutte pour la rénovation démocratique de la Russie… écrivais-je alors, est entièrement sortie du capitalisme, elle est menée par des forces qui se sont formées sur la base du capitalisme et est immédiatement, en premier lieu, érigée contre les obstacles hérités de la féodalité et du servage qui se trouvent sur la voie du développement de la société capitaliste ». La question se posait, pourtant, de savoir quelles forces et quelles méthodes pourraient renverser ces obstacles. « On peut limiter le cadre de tous les problèmes de la révolution avec l’affirmation que notre révolution est bourgeoise par ses buts objectifs et, donc, par ses résultais inévitables. On peut ainsi fermer les yeux sur le fait que le principal artisan de cette révolution bourgeoise, c’est le prolétariat, que toute la marche de la révolution pousse au pouvoir… On peut se tranquilliser à l’idée que les conditions sociales de la Russie ne sont pas encore mûres pour l’économie socialiste et on peut ainsi ne pas avoir l’idée que, une fois au pouvoir, le prolétariat sera inévitablement conduit, par toute la logique de la situation, à faire marcher l’économie pour le compte de l’Etat… Entrés dans le gouvernement non pas comme des otages impuissants, mais comme une force dirigeante, les représentants du prolétariat effacent par là même la limite entre programme minimum et maximum, c’est-à-dire mettent le collectivisme à l’ordre du jour. A quel point le prolétariat sera-t-il arrêté dans cette direction ? Cela dépend du rapport des forces, mais nullement des intentions primitives du parti du prolétariat… »
« Mais, dès maintenant, on peut se poser la question : la dictature du prolétariat doit-elle inévitablement se briser contre les cadres de la révolution bourgeoise ou bien, sur la base de la situation historique mondiale actuelle, peut-elle ouvrir devant elle une perspective de victoire, après avoir brisé ces cadres limités ?… Il est une chose que l’on peut dire avec certitude : sans le soutien étatique direct du prolétariat européen, la classe ouvrière de Russie ne peut se maintenir au pouvoir et faire de sa domination temporaire une longue dictature socialiste… » De là, pourtant, ne découle nullement un pronostic pessimiste : « L’émancipation politique, dirigée par la classe ouvrière de Russie, élèvera celui qui la guidera à une hauteur sans précédent dans l’histoire, lui mettra en main des forces et des moyens colossaux et fera de lui l’initiateur de la liquidation mondiale du capitalisme, pour laquelle l’histoire a créé toutes les prémisses objectives… »
Quant à savoir dans quelle mesure la social-démocratie internationale se trouverait capable de remplir sa tâche révolutionnaire, j’écrivais en 1906 : « Les partis socialistes européens, et en premier lieu le plus puissant d’entre eux, le parti allemand, ont développé leur conservatisme, qui est d’autant plus fort que plus grandes sont les masses embrassées par le socialisme et que plus grands sont l’esprit d’organisation et la discipline de ces masses. A cause de cela, la social-démocratie, en tant qu’organisation incarnant l’expérience politique du prolétariat, peut devenir à un certain moment l’obstacle immédiat sur la voie d’un conflit déclaré entre les ouvriers et la réaction bourgeoise… » Pourtant, je concluais mon analyse en exprimant la conviction que « la révolution à l’Est communiquerait au prolétariat occidental l’idéalisme révolutionnaire et ferait naître en lui le désir de parler avec l’ennemi en russe… »
Résumons-nous. Le populisme, à la suite du slavophilisme, prenait son point de départ dans ses illusions sur des voies absolument originales de l’évolution de la Russie, évitant le capitalisme et la république bourgeoise. Le marxisme de Plekhanov concentrait ses efforts sur la démonstration que les voies historiques de la Russie et de l’Occident étaient, en principe, identiques. Le programme qui en était né ignorait les particularités réelles, nullement mystiques, de la structure sociale et du développement révolutionnaire de la Russie. La conception menchevique de la révolution, épurée des additions épisodiques et des déviations individuelles, se réduisait à ceci : la victoire de la révolution bourgeoise russe n’est concevable que sous la direction de la bourgeoisie libérale et doit remettre le pouvoir à cette dernière. Le régime démocratique permettra ensuite au prolétariat russe de rattraper, avec incomparablement plus de succès qu’auparavant, ses frères aînés de l’Occident dans la voie de la lutte pour le socialisme.
La perspective de Lénine peut s’exprimer brièvement dans les termes suivants : la bourgeoisie russe en retard est incapable de mener sa propre révolution jusqu’au bout ! La victoire complète de la révolution, au moyen de la « dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie », purgera le pays de ce qu’il a de médiéval, donnera des rythmes américains au développement du capitalisme russe, renforcera le prolétariat à la ville et au village et ouvrira de larges possibilités de lutte pour le socialisme. D’autre part, la victoire de la révolution russe donnera une forte impulsion à la révolution socialiste en Occident et cette dernière, non seulement préservera la Russie des dangers de restauration, mais encore permettra au prolétariat russe d’aborder la conquête du pouvoir dans un délai historique relativement bref.
La perspective de la révolution permanente peut se résumer ainsi : la victoire complète de la révolution démocratique en Russie n’est concevable que sous la forme de la dictature du prolétariat s’appuyant sur la paysannerie. La dictature du prolétariat, qui mettra infailliblement à l’ordre du jour, non seulement les tâches démocratiques, mais aussi les tâches socialistes, donnera en même temps une forte impulsion à la révolution socialiste internationale. Seule la victoire du prolétariat en Occident préservera la Russie de la restauration bourgeoise et lui assurera la possibilité de mener l’édification socialiste jusqu’au bout.
Ce langage condensé fait apparaître aussi distinctement la similitude des deux dernières conceptions, dans leur opposition implacable à la perspective libérale et menchevique, que leur différence essentielle, dans la question du caractère social et des tâches de la « dictature » qui devait surgir de la révolution. L’objection, qui n’est pas rare dans les écrits des théoriciens actuels de Moscou, que le programme de la dictature du prolétariat était « prématuré » en 1905, est dépourvu de tout contenu. Dans un sens empirique, le programme de la dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie était tout aussi « prématuré ». Le rapport défavorable des forces à l’époque de la première révolution rendit impossible, non pas la dictature du prolétariat en tant que telle, mais la victoire de la révolution en général. Cependant, toutes les tendances révolutionnaires partaient de l’espoir en une victoire complète ; sans un tel espoir, une lutte révolutionnaire sans réserve était impossible. Les désaccords touchaient la perspective générale de la révolution et la stratégie qui en découlait. La perspective du menchevisme était radicalement fausse : elle n’indiquait nullement au prolétariat la bonne voie. La perspective du bolchevisme n’était pas complète : elle indiquait correctement la direction générale de la lutte, mais elle caractérisait incorrectement ses étapes. Si le défaut de la perspective du bolchevisme ne se manifesta pas en 1905, c’est uniquement parce que la révolution elle-même ne continua pas à se développer. Par contre, au début de 1917, Lénine dut, en conflit direct avec les vieux cadres du parti, changer sa perspective.
Un pronostic politique ne peut prétendre à une précision astronomique ; il suffit qu’il trace correctement la ligne générale du développement et permette de s’orienter dans la marche réelle des événements, laquelle s’écarte inévitablement de la ligne fondamentale à droite et à gauche. En ce sens, il est impossible de ne pas voir que la conception de la révolution permanente a subi avec un succès complet l’épreuve de l’histoire. Dans les premières années du régime soviétique, nul ne le niait ; au contraire, ce fait fut reconnu dans un certain nombre de publications officielles. Mais, quand, dans les sommets calmés et refroidis de la société soviétique, s’ouvrit la réaction bureaucratique contre Octobre, cette réaction se tourna dès le début même contre la théorie qui reflétait le plus complètement la première révolution prolétarienne et en même temps révélait ouvertement son caractère inachevé, limité, partiel. Ainsi, par répulsion, surgit la théorie du socialisme dans un seul pays, dogme fondamental du stalinisme.