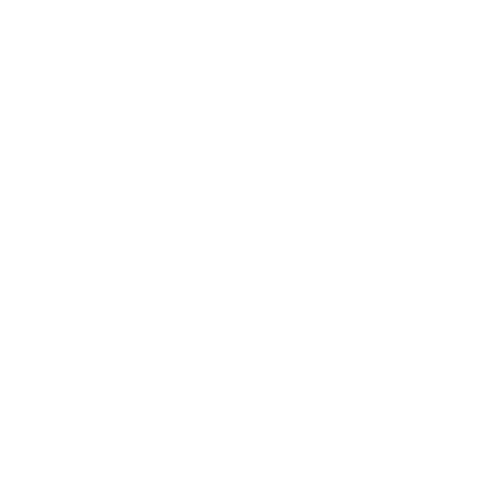La victoire de la Coalition Avenir Québec (CAQ) aux élections québécoises du 1er octobre dernier marque la fin d’une époque pour la province. Les deux partis qui s’échangent le pouvoir depuis près de 50 ans, le Parti libéral du Québec et le Parti québécois, ont chacun subi la pire défaite de leur histoire respective. Le paysage politique québécois est de plus en plus polarisé à gauche avec Québec solidaire comme à droite avec la CAQ, tandis que les partis du « centre » et de « l’establishment » ont subi la défaite.
La CAQ est le parti le plus à droite à prendre le pouvoir au Québec en 50 ans. Bien que ce soit un choc aux yeux de beaucoup de gens, il s’agit de la conclusion logique d’un processus qui se déroule depuis des décennies.
Le Québec dans l’impasse
L’État québécois tel que nous le connaissons est le produit de la lutte de libération nationale des années 60 et 70. Dans cette période, le Québec est passé d’une des provinces les plus retardataires à l’une des plus avancées en ce qui concerne l’État-providence. La création des cégeps et du réseau universitaire accessible, le Code du travail, la nationalisation de l’hydroélectricité et la création de sociétés d’État forment la base de l’État québécois moderne. C’est ce qu’on appelle le « modèle québécois » : un haut niveau de dépenses en programmes sociaux, un secteur public imposant et un taux d’imposition des entreprises relativement élevé.
Ces gains sont grandement dus à la classe ouvrière qui a mené des grèves combatives dans les années 60 et 70. La classe ouvrière québécoise compte encore aujourd’hui sur le taux de syndicalisation le plus élevé d’Amérique du Nord, à près de 40%. Grâce à de nombreuses luttes, les travailleurs ont gagné la législation du travail la plus favorable aux travailleurs au pays, avec la loi anti-briseur de grève et des lois qui rendent moins difficile la syndicalisation. Jusqu’à tout récemment, les syndicats contrôlaient l’embauche et le renvoi dans la construction. Puisque davantage de travailleurs peuvent compter sur un syndicat pour riposter aux attaques des patrons, les grèves sont plus fréquentes.
Mais la situation est devenue intenable pour les capitalistes, qui sont peu enclins à investir dans la province. Entre 2000 et 2009, aucune province canadienne n’a un taux de création d’entreprises aussi bas que le Québec. Dans le secteur manufacturier, le commerce de détail, les transports et la finance, plus d’entreprises sont parties que le nombre d’entreprises créées. La tendance s’est poursuivie entre 2011 et 2015, avec un taux de création d’entreprises de 10,4%, le plus bas au Canada.
Dans les 10 dernières années, le Québec n’a reçu qu’entre 10 et 12% des dépenses en immobilisation non résidentielle (c.-à-d. équipement, machinerie, usines, etc.) effectuées au Canada, alors qu’il représente 23% de la population canadienne. En fait, il y a une tendance au déclin des investissements privés au Québec depuis 2012, qui sont passés de 22 milliards de dollars à environ 18 milliards en 2017.
Le faible niveau d’investissement se reflète par une basse productivité du travail comparée aux autres provinces. De 1997 à 2016, la productivité du travail a progressé de 19% au Québec, tandis qu’elle a augmenté de 23,8% en Ontario et de 24,9% au Canada. En 2016, la productivité du travail était de 46,65$/h au Québec, tandis qu’au Canada et en Ontario, elle était de 53,43 $ / h et de 51,76 $/h, respectivement. En 2015, le Québec se trouvait en queue de file des provinces canadiennes sur le plan de la productivité, ne devançant que le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.
Le nouveau premier ministre François Legault a ciblé le retard relatif de l’économie québécoise par rapport aux autres provinces comme un problème qu’il souhaite régler. Lors d’une récente visite à Toronto, Legault a mentionné que le PIB par habitant au Québec est inférieur de 20% par rapport au reste du pays. Mais ce n’est pas nouveau, et le Québec accuse ce retard depuis des décennies. Résultat, 11% des recettes budgétaires du Québec proviennent de la péréquation.
Afin de régler cette situation, Legault a affirmé qu’attirer l’investissement privé sera pour lui une « obsession ». Pour y arriver, il a promis d’égaler les récentes coupes de Doug Ford dans le taux d’imposition des entreprises.
Mais ce n’est pas une nouvelle obsession pour la bourgeoisie québécoise. La faiblesse de l’économie québécoise avait déjà été soulignée en 2005, alors qu’un groupe de politiciens et de gens du milieu des affaires mené par Lucien Bouchard, l’ancien premier ministre du Parti québécois, avait publié le manifeste Pour un Québec lucide.
Ce document d’une dizaine de pages constituait essentiellement le programme de la bourgeoisie québécoise. Il contenait des « solutions » au retard économique du Québec comme une place grandissante pour le secteur privé, une augmentation des tarifs d’électricité, la « coopération » des syndicats plutôt que la confrontation, etc. Ce manifeste avait réjoui l’ancien premier ministre libéral Jean Charest, qui avait affirmé que c’était comme de la « musique à (ses) oreilles ».
Afin d’attirer les entreprises, les libéraux de Charest, au pouvoir de 2003 à 2012, ont fait des cadeaux aux entreprises, comme l’abolition de la taxe sur le capital. Puis, le PQ de Pauline Marois, en 2012-2014, a poursuivi le travail avec la loi spéciale contre les travailleurs de la construction et des congés fiscaux de 10 ans pour les investissements de plus de 300 millions de dollars. Le gouvernement Couillard a pris le relai, notamment avec une diminution des impôts des entreprises et le sauvetage de Bombardier au coût d’un milliard de dollars américains en 2015.
Les cadeaux incessants aux grandes entreprises, la faible productivité du travail, et les dépenses publiques plus élevées que la normale ont fait du gouvernement du Québec l’une des administrations les plus endettées d’Amérique du Nord. Les appels incessants de la bourgeoisie à s’attaquer à la dette ont mené à des mesures d’austérité parmi les plus draconiennes de l’histoire du Québec. Nous l’avons vu sous le gouvernement Charest, qui a eu l’audace d’affronter le combatif mouvement étudiant avec une hausse des frais de scolarité de 75%. Comme on le sait, cette mesure a provoqué le magnifique Printemps érable de 2012 qui s’est terminé avec la défaite des libéraux aux élections de cette année-là. Puis, le Parti québécois a poursuivi le travail en appliquant des mesures d’austérité semblables à celles des libéraux.
Les attaques contre les travailleurs et les jeunes ont ensuite atteint leur apogée sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard à partir de 2014. Tout y est passé au cours de ce mandat : la santé, l’éducation, les garderies, l’aide sociale, les salaires des employés du secteur public, etc.
Mais les politiciens ne sont pas simplement de mauvaises personnes qui souhaitent couper dans les services. Sous le capitalisme, le maintien de l’État-providence a un coût, et l’argent doit être pris dans les poches de quelqu’un. La question est la suivante : qui paye? Les capitalistes ou les travailleurs? Quand le système entre en crise, les capitalistes urgent les gouvernements de refiler la facture aux travailleurs en coupant dans les services publics ou en attaquant les travailleurs du secteur public.
Étant donné que le Canada n’a pas connu de crise économique majeure depuis 2008-2009, les mesures d’austérité ont permis de faire diminuer le ratio dette-PIB du Québec, en baisse depuis 2015. Également, les libéraux ont été remerciés de leur sale boulot par une augmentation de la cote de crédit de la province, qui est maintenant supérieure à celle de l’Ontario.
Cependant, malgré le fait que l’économie se porte relativement bien, les années d’austérité, de coupes et de corruption ont laissé des traces. Les travailleurs et les jeunes peuvent bien voir que ce sont eux qui ont eu à faire des sacrifices, tandis que les riches sont demeurés intouchés. Les cadeaux fiscaux faits à Bombardier, notamment, ont alimenté le ressentiment des travailleurs envers l’establishment, car l’entreprise a tout de même congédié des milliers de travailleurs. Pourquoi les patrons de Bombardier ont-ils droit à des augmentations salariales monstrueuses en pleine période d’austérité?
Le Québec se trouve dans une impasse. La crise mondiale du capitalisme met une pression immense sur tous les États. Il leur devient nécessaire d’éliminer toutes les barrières à l’investissement. Un État-providence tel que celui du Québec n’est plus soutenable sous le capitalisme, et c’est pourquoi la bourgeoisie en appelle constamment à la « responsabilité fiscale ». La CAQ est le nouveau véhicule utilisé pour remplir les tâches demandées par les capitalistes.
La lutte des classes et le rejet de l’establishment
Mais les travailleurs ne se plient pas docilement à l’ordre du jour des capitalistes sans rien faire. Les attaques subies par les travailleurs et les jeunes ont mené à des luttes de classe intenses au cours des dernières années. La grève étudiante de 2012, le Front commun de 2015 et les grèves de la construction de 2013 et 2017 en sont les principaux exemples. Lors de la période 2012-2015, les manifestations de plus de 50 000 personnes étaient monnaie courante.
L’année 2018 a également vu une résurgence de la lutte des classes. Les votes de grève à 90%, 95% ou même 99% ne se comptent plus. Une grève générale a éclaté dans les CPE de Montréal et Laval et la SAQ a tenu plusieurs journées de grève au cours des derniers mois. Le printemps dernier, les infirmières, épuisées, ont organisé des sit-in spontanés à travers la province. Mais l’exemple le plus frappant de la colère de la classe ouvrière est venu des grutiers, qui ont tenu une grève illégale spontanée cet été. Tous ces mouvements expriment la colère montante de la classe ouvrière, ainsi que son désir de lutter pour reprendre ce que les années d’austérité lui ont fait perdre.
Cette colère et ce désir de mettre fin au régime en place ont été très clairement exprimés par de nombreux sondages menés dans la dernière année. Un sondage de mai dernier montre que la confiance envers les politiciens atteint 18%. De plus, selon un sondage datant de novembre 2017, 69 % des Québécois affirment que « le Québec va mal et qu’il faut faire des changements importants ». Aussi, un énorme 78 % des Québécois affirme que « les choses sont pareilles ou pires qu’il y a 10 ans ».
Un sondage du 27 mai dernier révélait également que 47% des Québécois disent que leur revenu n’a pas augmenté depuis plusieurs années. Parmi ceux qui se définissent comme des travailleurs, cette proportion grimpe à 61%. Les libéraux de Couillard avaient un taux de désapprobation de 64% cet été, en hausse de 9% par rapport à l’été 2017.
La détérioration des services, les maigres salaires imposés aux travailleurs du secteur public, l’épuisement des enseignants et des infirmières notamment, les coupes à l’aide sociale et dans les services aux aînés, tous ces facteurs font que le statu quo devient de plus en plus intenable.
Cette colère à l’endroit de l’establishment s’est manifestée au grand jour lors des élections du 1er octobre. Les libéraux ont été remerciés de leurs quinze années d’austérité, de coupes et de corruption en encaissant la pire défaite de leur histoire.
Le PQ : le début de la fin?
Cependant, c’est le PQ de Jean-François Lisée qui a été le grand perdant de ces élections. Le parti a lui aussi subi la pire défaite de son histoire, avec un maigre 17,06% des votes, et Lisée a été battu dans sa propre circonscription.
Le PQ n’a pourtant été au pouvoir que 18 mois depuis 2003, soit lors de son court gouvernement minoritaire de 2012-2014. Comment expliquer que ce parti d’opposition ait connu une chute si brutale?
Le PQ est en crise depuis de nombreuses années. Ce score humiliant était tout à fait prévisible, et constitue en réalité l’aboutissement logique de l’histoire du parti.
Le PQ était au départ une « coalition nationale » fondée pour réaliser le projet de souveraineté. Mais une coalition qui essaye de concilier les intérêts fondamentalement opposés des travailleurs et des patrons ne peut pas durer éternellement. Aux fondements du PQ se trouvaient les germes de futurs conflits.
Et au fil du temps, le PQ a révélé ses vraies couleurs. Il a attaqué vicieusement les travailleurs du secteur public en 1982-83 avec des coupes de salaires et des lois spéciales de retour au travail, puis avec Lucien Bouchard vers la fin des années 90 avec le déficit zéro et ses mesures d’austérité.Par la suite, le gouvernement minoritaire de Pauline Marois en 2012-2014 a offert des congés fiscaux aux grandes entreprises, a coupé des postes à Hydro-Québec, a indexé les frais de scolarité et a imposé une loi de retour au travail aux travailleurs de la construction.
Les pressions du capitalisme ont forcé le PQ à attaquer les travailleurs. C’est ce qui explique que le PQ est de moins en moins vu comme un parti « social-démocrate », et de plus en plus comme un des deux partis de l’establishment québécois.
Mais la deuxième raison du déclin du PQ est la perte d’intérêt envers la souveraineté. Un sondage du mois de mai révélait que 74% des Québécois pensent que l’indépendance ne devrait pas être un sujet central lors des élections et que cet enjeu est dépassé. Lors de la campagne électorale, un sondage a montré que seuls 19% des Québécois de 18-25 ans se disent souverainistes. Ces chiffres ne sont pas surprenants : depuis le référendum de 1995, toutes les luttes de masse ont porté sur des enjeux de classe, et non sur des enjeux liés à la question nationale. La plupart des travailleurs et des jeunes voient leur ennemi principal non à Ottawa, mais chez le gouvernement provincial qui impose l’austérité. Pour la première fois en plus de 40 ans, la question de l’indépendance n’était pas un enjeu électoral dominant.
Lorsque Jean-François Lisée est devenu chef du PQ en 2016, il a promis de ne pas tenir de référendum avant un deuxième mandat, en 2022. Le fait que la direction du parti remette sa raison d’être à plus tard reflète le désintérêt qui règne présentement à propos du traditionnel débat fédéraliste-souverainiste.
Cela étant dit, il serait faux de dire que la question de l’indépendance est enterrée pour de bon. Cependant, pour l’instant, la lutte des classes est à l’ordre du jour et coupe court à cette question.
Dans cette situation, le PQ s’est vu perdre des appuis tant à sa gauche qu’à sa droite. Le mouvement nationaliste, représenté pendant des décennies presque exclusivement par le PQ, s’est divisé sur des lignes de classe, avec la gauche qui s’est coalisée autour de QS, tandis que les nationalistes conservateurs se rangent de plus en plus du côté de la CAQ.
Avec la polarisation de la société québécoise, le parti voit le sol se dérober sous ses pieds. Le PQ tente parfois de montrer son visage de gauche afin d’éviter de perdre des votes au profit de QS; il tente à d’autres moments de jouer la carte identitaire afin d’endiguer la montée de la CAQ. En tentant de plaire à tout le monde, le parti finit par ne plaire à personne.
En désespoir de cause, lors de la campagne électorale, le PQ a tenté de fomenter une « peur rouge » pour couler Québec solidaire. Lisée a affirmé que QS était « ancré dans le marxisme » et « anticapitaliste », et que son programme serait un désastre économique. Son attaque ratée contre QS montre qu’une partie grandissante de la population québécoise n’est plus effrayée par les idées « radicales » de QS, et n’est pas non plus attirée par l’image de modération et de respectabilité que le PQ veut projeter.
Bien que le PQ ait été en difficulté bien avant les élections, le résultat d’octobre 2018 a plongé le parti dans une crise existentielle profonde. Il est entièrement possible que le parti ait entamé un déclin irréversible. Le parti pourrait très bien subir le même sort que le Bloc québécois, qui est devenu un joueur insignifiant au niveau fédéral.
Déjà, Jean-Martin Aussant, candidat péquiste défait en octobre, a affirmé que le parti devait songer à une refondation complète et à changer de nom, question de repartir à neuf.
Aussant lui-même est une figure assez populaire auprès de la gauche nationaliste. Gabriel Nadeau-Dubois, le coporte-parole de QS, avait même tenté de convaincre Aussant de se présenter pour QS. Si Aussant devenait chef du PQ (ou de ce qui naîtrait des cendres du PQ), ce qui est plausible, les nationalistes feraient pression sur QS pour s’allier à cette formation afin « d’unir les forces souverainistes et progressistes ».
Déjà depuis l’élection, des articles en appelant à nouveau à une forme d’alliance entre QS et le PQ ont été publiés dans les médias. N’oublions pas que GND lui-même était en faveur d’alliances stratégiques avec le PQ lors du Congrès de QS en mai 2017. Encore récemment, un ancien ministre péquiste, Réjean Hébert, a appelé à la fusion des deux formations.
Même si le PQ tente de se donner une nouvelle image de gauche avec Aussant ou une personnalité similaire, s’unir avec ce parti serait un cadeau empoisonné. Toute alliance ou fusion supposerait une forme de compromis sur les positions plus radicales de QS. Afin de canaliser la colère contre l’establishment, le parti doit refuser toute collaboration avec le PQ, et offrir une solution de rechange au statu quo capitaliste et aux partis qui le défendent.
La lutte contre le racisme et la xénophobie
Bien que l’intérêt pour la souveraineté est à son plus bas, la question nationale est toujours bien présente. Mais le mouvement nationaliste a pris un hideux tournant vers le racisme et la xénophobie, qui s’incarnent maintenant à travers la CAQ.
Legault défend un nationalisme semblable à celui de Maurice Duplessis, ancien chef de l’Union nationale, c’est-à-dire qu’il veut plus de pouvoir pour le Québec, mais à l’intérieur du Canada. Il avait même affirmé en 2014 : « Il y a des ressemblances [avec l’Union nationale], mais on ne va pas retourner dans la grande noirceur. »
Bien que Legault ait promis de ne jamais tenir de référendum sur la souveraineté, il est le plus virulent défenseur de cette fameuse et mystérieuse « identité québécoise » supposément menacée. En effet, Legault avait promis avant les élections de faire diminuer l’immigration de 20% et de faire passer un « test des valeurs » aux immigrants. Il a également affirmé qu’il expulserait les immigrants qui ne parlent pas le français après trois ans au Québec. « Il n’y a aucune exigence concernant l’apprentissage du français, aucune exigence concernant le respect de nos valeurs. Je pense que les Québécois, comme nation, ont le droit de contrôler un peu mieux leur immigration », avait-il affirmé.
De même, la CAQ se présente comme la protectrice de la laïcité de l’État québécois, elle aussi gravement menacée, à ce qu’il paraît. Le lendemain de son élection, Legault affirmait qu’il irait de l’avant avec l’interdiction du port de signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité, y compris les enseignants. Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Laïcité, a également affirmé que le parti souhaite interdire le port du tchador pour tous les employés de l’État.
Ces mesures visent supposément à protéger la laïcité de l’État, mais cette justification n’est qu’un écran de fumée pour la campagne islamophobe et xénophobe de la CAQ. Si Legault était véritablement préoccupé par la laïcité, il mettrait fin au financement public des écoles confessionnelles et enlèverait le crucifix à l’Assemblée nationale. La CAQ instrumentalise le sentiment laïc honnête des Québécois issu de la lutte contre la domination de l’Église lors de la Révolution tranquille afin de diviser la population en s’attaquant aux musulmanes en particulier. Avec le mécontentement généralisé de la classe ouvrière, la question des signes religieux a été une diversion de choix pour les partis capitalistes.
Sans surprise, malgré ses déclarations rapides suite à son élection, Legault a repoussé l’adoption d’un projet de loi sur la laïcité au printemps 2019. En effet, pourquoi ne pas diviser la population et détourner son attention le plus longtemps possible?
Malheureusement, la direction de QS tombe dans le piège et propose un « compromis » au Parlement afin de « régler » cette question. Le « compromis » proposé par QS s’articule autour des recommandations du rapport Bouchard-Taylor qui suggérait l’interdiction de signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité (juges, policiers, gardiens de prison).
Un des arguments principaux en faveur de cette mesure est le fameux sondage disant que 76% des Québécois sont d’accord avec cette interdiction. Mais il est très facile pour les dirigeants de Québec solidaire de se rabattre sur les sondages favorables à la discrimination quand rien n’a été fait ou presque pour démasquer les diversions xénophobes.
Les mesures proposées par la CAQ sont l’aboutissement logique du « débat » sur les signes religieux, commencé en 2006. La lutte de classe et la colère contre l’establishment n’ont fait qu’augmenter au cours de la dernière décennie, et ce débat a été la diversion parfaite pour détourner la population de ces mesures et diviser les travailleurs. Il n’y a absolument aucune raison de penser qu’un « compromis » permettrait de régler ce débat si profitable pour la CAQ.
Depuis une décennie, nous expliquons dans tous nos articles sur le sujet que ce débat n’est qu’une diversion. Mais ce sont aux organisations de masse de la classe ouvrière et à Québec solidaire de défendre cette position et mobiliser les travailleurs et les jeunes contre le racisme et la xénophobie. Les syndicats et Québec solidaire doivent avoir une position de principe sur cette question, soit une défense des minorités religieuses contre les tentatives de les priver de leurs droits. Nous ne devons pas accepter les termes de ce débat, qui n’a rien à voir avec la laïcité. Nous devons démasquer la CAQ et les autres partis de l’establishment et exposer leurs tentatives de nous diviser. Les syndicats affectés par les mesures racistes de la CAQ doivent, par une action directe, protéger leurs collègues menacés de perdre leur emploi. Les marxistes de La Riposte socialiste seront à l’avant-plan de cette lutte contre les tentatives de nous diviser avec ces mesures racistes.
L’avenir de Québec solidaire
La montée de QS a été le fait saillant de la dernière campagne électorale. Le parti a doublé son nombre de votes et plus que triplé son nombre de députés. De plus, QS a finalement réussi à sortir de Montréal, faisant élire quatre députés hors de la métropole. QS ne peut plus être considéré comme un parti « montréalo-centriste ».
Beaucoup de gens parlent d’une « montée de la droite » au Québec, et montrent comme preuve la victoire de la CAQ. Mais il ne s’agit que d’un côté de la médaille. Ce que nous voyons est une polarisation à gauche comme à droite. La poussée de QS démontre qu’une partie grandissante de la population se radicalise vers la gauche.
Jusqu’à tout récemment, malgré la vague de mobilisation des travailleurs et des jeunes que le Québec a vécue, QS ne grimpait pas dans les sondages. Nous expliquions que c’était dû au fait que la direction de QS diluait constamment son discours afin d’avoir l’air plus modéré et raisonnable. Bien que dans son programme le parti prône le dépassement du capitalisme, la direction du parti n’en parle presque jamais depuis bien des années. De plus, les positions plus radicales comme la nationalisation des institutions financières et des mines, qui ont été votées par les membres, sont absentes des déclarations du parti.
Un autre facteur de l’incapacité de QS de monter dans les sondages était l’accent mis sur la question de l’indépendance alors qu’une majorité de gens se distancent de cette question et recherche des solutions de classe. C’est ce qui faisait que le parti n’avait pas l’air si différent du PQ, bien souvent. Nous expliquions constamment que le parti devait mettre au coeur de son agitation des revendications de classe pouvant différencier QS des partis capitalistes et enthousiasmer la classe ouvrière et les jeunes.
Au final, c’est ce qui est arrivé lors des élections. En mettant l’accent sur la gratuité scolaire, l’assurance dentaire, le transport public à moitié prix, la mise sur pied d’un réseau public de fibre optique, la nationalisation du transport interurbain, etc., QS a réussi à susciter l’enthousiasme des électeurs. Ces propositions concrètes et audacieuses ont donné le ton de la campagne et ont forcé les autres partis à se mettre à la remorque de QS et à proposer des versions diluées de ses propositions. Des revendications touchant concrètement la vie des travailleurs comme un salaire minimum à 15$ l’heure, davantage de congés payés et de congés de maladie, une loi anti-burnout, etc., ont permis à QS de se démarquer des autres partis.
Avec la chute du PQ et la montée de QS, la relation entre les syndicats et les deux partis risque de changer. Historiquement, les syndicats ont maintenu des relations très cordiales avec le PQ. Cependant, le virage à droite du parti a endommagé ces relations. Par exemple, depuis 2008, la FTQ, qui a toujours été la centrale syndicale la plus proche du PQ, ne donne plus d’appui ouvert au parti. Mais les syndicats ont tout de même l’habitude d’appeler à voter « contre les libéraux et la CAQ » ce qui, jusqu’aux dernières élections, constituait un appui tacite au PQ. La logique de la situation risque maintenant de pousser les syndicats dans la direction de QS, le parti dont les positions sont les plus proches du mouvement ouvrier.
Les leçons de la Grèce
Il existe un parallèle frappant entre la montée de QS et la montée de Syriza en Grèce il y a quelques années. Syriza, un parti issu du mouvement communiste grec, est passé d’une coalition insignifiante au début des années 2000 au principal parti d’opposition en 2012. La Grèce traversait une crise économique désastreuse, et les masses se radicalisaient vers la gauche comme vers la droite. Avec le discrédit total du PASOK (le parti social-démocrate grec) qui avait appliqué un programme d’austérité une fois au gouvernement, Syriza avait pu se positionner comme principal parti anti-austérité. Le parti a finalement pris le pouvoir en janvier 2015, promettant de mettre fin aux diktats du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque centrale européenne, qui imposaient l’austérité à la pauvre Grèce en échange de prêts.
La direction de Syriza, menée par Alexis Tsipras, avait la perspective de convaincre le FMI et la Banque centrale européenne de laisser le parti renverser l’austérité et appliquer un programme de réformes progressistes. La direction du parti croyait pouvoir convaincre les banquiers du bien-fondé de son programme, mais ceux-ci n’ont jamais eu l’intention de négocier. Le ministre des Finances de l’époque, Yanis Varoufakis, a plus tard révélé ce que ceux-ci lui disaient : « Vous avez raison dans ce que vous dites, mais ça ne nous empêchera pas de vous écraser de toute façon. » Les capitalistes européens et leurs représentants ont tout fait, du début jusqu’à la fin, pour empêcher Syriza de mettre en place son programme. Syriza s’est vu « forcé » de continuer les mesures d’austérité profondes. Le parti est encore au pouvoir aujourd’hui et continue de faire son sale boulot de huissier au nom des banquiers et capitalistes européens.
Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs?
Alors que Syriza se rapprochait du pouvoir, la direction du parti a succombé à la pression énorme des capitalistes grecs et européens. La réponse de Tsipras a été de calmer les capitalistes en modérant le programme du parti. La direction de Syriza a abandonné ses discours radicaux, sa critique du capitalisme et sa dénonciation vigoureuse de la « troïka » (le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne) qui imposait l’austérité au peuple grec. La direction du parti a également abandonné l’idée de nationaliser les banques au profit du vague « contrôle » des banques et a cessé de revendiquer l’annulation du plan de sauvetage qui imposait l’austérité (le « mémorandum ») au profit de sa « renégociation ».
N’étant plus un parti marginal, une pression similaire sera mise sur QS par l’establishment politique et l’opinion publique petite-bourgeoise pour que le parti soit plus « respectable » et « réaliste ». Il est possible que le virage à gauche de QS lors des élections soit suivi d’une modération de son discours et de ses positions dans le but de rassurer les capitalistes. Avec la possibilité que le parti lutte pour le pouvoir en 2022, la direction pourrait plier devant la pression et suive la voie de la modération, comme Tsipras l’avait fait. Mais le résultat sera le même qu’en Grèce.
Malheureusement, nous avons déjà vu cette tendance chez la direction de QS. Lors de la campagne électorale, comme Tsipras, QS a essayé à plusieurs reprises de calmer la classe dominante. Manon Massé s’est présentée devant la Chambre de commerce de Montréal en expliquant que QS n’était pas un parti révolutionnaire socialiste. Questionnée sur les nationalisations contenues dans le programme du parti, elle a expliqué qu’il y avait une différence entre le programme et les engagements d’un premier mandat de quatre ans. De plus, les dirigeants du parti insistaient sur le fait que leur programme représentait des dépenses moins élevées que celles des gouvernements de René Lévesque et Robert Bourassa dans les années 70.
Dans une entrevue donnée en début de campagne, Manon Massé s’est fait demander quels étaient les gouvernements de gauche qui inspiraient QS. Elle a répondu : « Le capitalisme trouve son confort dans des gouvernements de droite qui prennent des décisions complaisantes, toujours pour la même classe de privilégiés, toujours pour s’assurer que leurs règles du jeu rapportent à une minorité et non pas à une majorité. Mais je pense qu’à travers l’histoire, dans l’Amérique du Sud, on l’a vu aussi même en Grèce avec Syriza, qui a bien sûr eu à composer avec une pression énorme des banques centrales, etc., qui n’aimaient pas trop ça qu’ils [veuillent] prendre soin de leur monde. » Mais Massé, bien sûr, ne tire pas la conclusion logique de cette expérience.
Le problème fondamental en Grèce était que malgré ses critiques passées de l’austérité et du système capitaliste, la direction de Syriza n’avait aucunement la perspective de lier la lutte contre l’austérité et les diktats des banquiers à la lutte révolutionnaire contre le système capitaliste. C’était la seule solution possible dans cette situation. La direction de QS, elle aussi, n’a pas cette perspective et a la ferme intention de se contenter de lutter pour des réformes à l’Assemblée nationale. L’ancien député et fondateur du parti, Amir Khadir, l’expliquait sans détour en 2016 lorsqu’il disait : « Nous réalisons qu’il y a des obstacles importants devant nous, il y avait la perception (au début) que nous étions radicaux. En fait, nous sommes réformistes. Nous sommes à l’Assemblée nationale car nous acceptons le principe de réforme. »
Tous les militants et militantes de QS doivent méditer l’expérience de Syriza en Grèce et en tirer les conclusions qui s’imposent. Une fois au pouvoir, un programme de réformes ne pourra pas être appliqué en restant dans les limites du capitalisme. Les capitalistes organiseraient une grève de l’investissement, menaceraient de déménager leurs entreprises, les réformes seraient sabotées, et les grands médias seraient utilisés pour démoniser QS.
La solution au chantage des banques et au sabotage des capitalistes en Grèce était de mobiliser les masses dans une lutte révolutionnaire pour nationaliser les banques et les grandes entreprises et ainsi entamer la transition vers le socialisme. Mais Tsipras et les autres dirigeants du parti n’ont jamais songé à cette solution. La direction de Syriza, incapable d’envisager une lutte contre le capitalisme, s’est vue forcée de gérer la crise du système. C’est le sort inévitable réservé aux gouvernements réformistes de gauche. En voulant gérer le capitalisme, ils finissent par être gérés par lui.
Il est évident que le Québec n’est pas la Grèce. Le Québec n’est pas présentement au coeur d’une crise économique profonde. Mais comme nous l’avons expliqué plus haut, les fondements de l’économie québécoise sont loin d’être solides et la situation économique mondiale signifie que la bourgeoisie au Québec et à l’échelle internationale n’aura aucune intention de respecter les règles du jeu devant un gouvernement de QS.
Les leçons de la Grèce sont d’autant plus importantes étant donné le fait qu’il est fort possible que QS lutte pour le pouvoir en 2022. Les partis de l’establishment sont déjà discrédités, tandis que la CAQ pourrait très bien devenir l’un des gouvernements les plus impopulaires de l’histoire récente. La porte serait ouverte pour que QS se présente comme la seule solution de rechange aux yeux des travailleurs et des jeunes.
Une victoire de QS ouvrirait une nouvelle période dans la lutte des classes au Québec. Ce serait une période au cours de laquelle les travailleurs et les jeunes auraient à se battre contre le sabotage des capitalistes et les compromis de la direction de QS afin que les mesures proposées par QS soient effectivement appliquées.
La lutte des classes à l’ordre du jour
Nous ne pouvons pas prédire quand les attaques reprendront, et encore moins d’où viendra le mouvement contre ces attaques. Déjà, les étudiants sur de nombreux campus se sont mis en marche. Une grève de 58 000 étudiants a eu lieu cet automne dans le cadre de la lutte pour la rémunération des stages et la mobilisation se prépare pour une grève générale illimitée cet hiver. À ce stade-ci, il n’est pas encore clair si ce mouvement sera l’étincelle d’un mouvement plus large contre le gouvernement et le système, comme nous l’avions vu lors de la magnifique grève de 2012.
Également, les négociations dans le secteur public sont dues pour 2020. Les syndicats du secteur public se buteront à une opposition résolue de la CAQ, et les négociations pourraient devenir le théâtre d’une grande lutte. La dernière ronde de négociations, en 2015, a mené à la plus grande grève générale d’un jour de l’histoire de la province. Mais lors de ces négociations, la direction syndicale a fini par capituler en signant une entente contenant des augmentations salariales inférieures à celles que Jean Charest avait imposées par décret en 2005. La direction avait également accepté une augmentation de l’âge de la retraite. Il est crucial de tirer les leçons de cette lutte. Devant un gouvernement hostile et déterminé à réduire la taille du secteur public, les syndicats n’auront pas le choix de revenir à leurs traditions héroïques du passé : les occupations, la grève générale, les manifestations de masse, et la mobilisation en masse des autres secteurs de la classe ouvrière.
Malheureusement, en règle générale, les dirigeants syndicaux vivent dans le passé. Ils croient qu’il est encore possible de gagner en négociant « de bonne foi » avec les patrons ou l’État. Cette approche conciliatrice ne mène qu’à des défaites depuis des décennies.
Mais la bureaucratie syndicale réformiste n’est pas plus forte que les lois de l’histoire. Tôt ou tard, la radicalisation des travailleurs entrera en conflit avec le conservatisme de leur direction. Les dirigeants seront forcés de se tourner vers la gauche ou seront remplacés par les meilleurs militants venus de la base.
Il est nécessaire que la classe ouvrière québécoise fasse revivre sa riche tradition de luttes combatives. Les travailleurs devraient lire et relire Ne comptons que sur nos propres moyens, cet excellent document produit par la CSN en 1971 qui en appelle au renversement du capitalisme et à la construction d’une société socialiste.
Sous plusieurs aspects, la période qui s’ouvre au Québec pourrait ressembler à la période turbulente des années 60 et 70. Cette période avait été marquée par la radicalisation de la classe ouvrière québécoise, par des grèves combatives, par la montée et la chute de partis politiques, etc. Nous devons nous attendre à des tournants et changements brusques de ce genre. La tâche des marxistes est de donner aux travailleurs les outils idéologiques qui permettront de comprendre ce qui se passe et de lutter jusqu’à la victoire.
Turbulences politiques à venir
Sans aucun doute, nous entrons dans une période excitante pour ceux qui aspirent à lutter contre le capitalisme. L’âge d’or du capitalisme, qui correspond aux trois décennies de boom économique presque ininterrompu ayant suivi la Deuxième Guerre mondiale, fut une période où les capitalistes en Occident pouvaient se permettre de faire des concessions pour acheter la paix des classes. Mais cette période est définitivement derrière nous, et les gouvernements, au Québec et au Canada comme partout dans le monde, tentent d’enlever aux travailleurs les gains qui leur ont permis de mener une vie tolérable.
La crise du capitalisme radicalise déjà des milliers de personnes, en particulier chez les jeunes, qui formeront la première génération depuis la Deuxième Guerre mondiale à vivre plus pauvrement que leurs parents.
Pour l’instant, les marxistes sont encore une minorité. Beaucoup de gens disent que nos idées sont trop radicales. Mais avec le temps, de plus en plus de gens tireront des conclusions marxistes de leur expérience. La lente érosion de nos conditions de vie est l’argument le plus puissant et le plus convaincant qui milite contre ce système dans lequel nous vivons.
De grandes luttes de classe sont à l’ordre du jour contre le gouvernement de la CAQ. Cela pourrait se manifester sur le front syndical, à travers le mouvement étudiant ou encore dans un mouvement spontané, similaire aux gilets jaunes en France. Le Québec compte sur une grande tradition de lutte, et les années qui viennent seront l’occasion d’enrichir cette histoire.