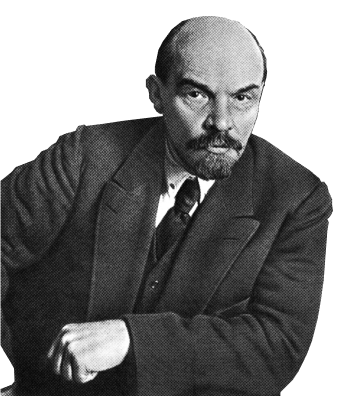L’année 2020 s’annonce comme une année charnière pour la lutte des classes au Québec. Les conventions collectives du secteur public arrivent à échéance le 31 mars, et les négociations sont amorcées. Leur résultat aura sans aucun doute des répercussions importantes pour toute la décennie à venir. L’issue des négociations signifiera soit la continuation de l’appauvrissement pour 550 000 employés du secteur public, soit le renversement de décennies d’austérité pour la classe ouvrière québécoise.
Déjà depuis l’automne, plusieurs coups de semonce ont été tirés et la lutte s’annonce amère. Les offres patronales ont été annoncées en décembre : une augmentation de 7 % sur cinq ans, largement sous l’inflation. En plus de cette proposition méprisante, le gouvernement offre de donner des augmentations à la pièce selon le métier. Entre autres, les jeunes enseignants et les préposés aux bénéficiaires auraient droit à de meilleures offres. Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, en charge des négociations du côté patronal, tente ainsi de diviser le camp syndical en jouant avec la sympathie du public pour certaines catégories de travailleurs. « On le sait que les préposés ont une charge de travail très importante. On le sait ce qui se passe dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées et il faut être capable de suivre », affirme-t-il en versant des larmes de crocodile. En réalité, ce n’est que 25 % des employés du secteur public qui auraient droit à ces offres plus avantageuses. Pire encore, ces offres demeurent elles aussi sous l’inflation, à seulement 9 % sur cinq ans. Legault semble déterminé à perpétuer les traditions austères de ses prédécesseurs.
C’est le temps de passer à l’offensive
Après deux décennies d’austérité et d’attaques répétées aux conditions de travail ainsi qu’au niveau de vie des employés du secteur public, la situation est grave. Les travailleurs croulent sous le travail. Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN décrit la situation ainsi : « Ça fait des années qu’on le répète, les travailleuses et les travailleurs des réseaux de la santé et des services sociaux, de l’éducation et des organismes gouvernementaux font face à une surcharge de travail importante et se retrouvent trop souvent en situation de précarité. » Au cours des cinq dernières années, le nombre d’absences pour cause de maladie dans le secteur public a augmenté de 25%.
C’est particulièrement grave dans le milieu de la santé. Il y a déjà deux ans, le cri du cœur de l’infirmière Émilie Ricard éveillait la population québécoise à la situation dramatique qui règne chez le personnel de la santé. Pourtant, rien n’a changé depuis. Il continue d’y avoir régulièrement dans les hôpitaux des sit-ins spontanés d’infirmières épuisées qui dénoncent le temps supplémentaire obligatoire. En date du printemps dernier, il manquait toujours 24 000 infirmières dans l’ensemble du réseau de la santé.
Et les faibles salaires contribuent directement à cette pénurie de main-d’œuvre. Le Québec a le déshonneur d’être la province où les enseignants et les infirmières sont les moins bien payés. L’écart de rémunération avec les autres provinces est d’environ 11 %. Selon l’Institut de la statistique du Québec, les employés de l’administration québécoise gagnent 6,2 % de moins que les autres salariés, avantages sociaux compris. Ce chiffre grimpe à 13,2 % en ce qui a trait au salaire seul.
S’il y a bien un moment pour passer à l’offensive afin de mettre fin à l’appauvrissement du secteur public et gagner de bonnes conditions de travail, c’est maintenant. Le vent souffle dans le sens des travailleurs. En temps normal, les arguments classiques du gouvernement pendant les négociations – « les temps sont durs », « il faut se serrer la ceinture », « la vache à lait est à sec », etc. – ne tiennent déjà pas la route, car notre société baigne dans la richesse. Chaque année, avec la régularité d’une horloge, de nouvelles statistiques révèlent une concentration croissante des richesses. Les coffres des banques regorgent d’argent, qui ne demande qu’à être pris pour être investi en santé, en éducation, en logements sociaux, etc. Mais cette fois-ci, le gouvernement ne peut même plus prétendre manquer lui-même d’argent. Avec des surplus budgétaires record de 8,28 milliards de dollars pour l’exercice 2018-2019, le gouvernement pourrait facilement concéder des hausses de salaire. Évidemment, Legault n’est pas de cet avis : « Les surplus appartiennent aux Québécois; ils n’appartiennent pas aux groupes de pression; ils n’appartiennent pas aux syndicats », a-t-il affirmé.
De plus, la situation du marché du travail penche en faveur des travailleurs. Avec un taux de chômage historiquement bas à 5,3 % au Québec, nous avons le gros bout du bâton. Depuis un an environ, on entend dans les médias les pleurnichements constants des patrons face au manque de main-d’œuvre. Cette situation devrait suffire à convaincre même les plus pessimistes que les travailleurs sont bien placés pour obtenir des gains importants. Pourtant, tout porte à croire que Legault préfère plutôt aggraver l’appauvrissement et perpétuer l’austérité de ses prédécesseurs. En fait, malgré une conjoncture favorable, les travailleurs du secteur public n’auront pas de concessions sans lutter pour celles-ci.
Où est le front commun?
Comme mentionné précédemment, les négociateurs gouvernementaux ont déjà annoncé leur intention de miser sur une stratégie de « diviser pour mieux régner ». Les disparités de traitement entre les corps de métiers, et entre les générations chez les enseignants, visent à monter les travailleurs du secteur public les uns contre les autres. En créant celles-ci, Québec tente de convaincre la population que seuls certains travailleurs méritent des augmentations.
Devant ces tactiques, l’unité est nécessaire plus que jamais. Cependant, pour une première fois depuis des décennies, les grandes centrales ne feront pas de front commun face au gouvernement. Il s’agit d’une grave erreur. En fait, seules la FIQ et l’APTS feront front de leur côté.
La direction syndicale semble avoir oublié l’essence même du front commun. Daniel Boyer, président de la FTQ, justifie ainsi la décision de ne pas faire de front commun : « On a consulté sur des bases différentes, on en est arrivés à des demandes qui sont différentes et on n’avait pas tout à fait la même stratégie. » Mais le principe du front commun ne consiste pas nécessairement à présenter les mêmes demandes ou avoir la même stratégie. Il s’agit avant tout de ne pas abandonner ses camarades de la classe ouvrière à la table des négociations, isolés devant la partie patronale. Face au patronat, la force des travailleurs repose dans leur nombre. Depuis ses débuts, le mouvement syndical a compris que l’union fait la force, et les patrons ont compris que leur meilleure arme consiste à diviser les travailleurs. La meilleure stratégie pour l’ensemble des syndicats, c’est de lutter de façon commune pour l’amélioration de la rémunération et des conditions de travail de l’entièreté des travailleurs du secteur public. La lutte doit être menée au-delà des allégeances syndicales, et les conventions ne doivent pas être signées tant que les demandes de tous les syndicats n’ont pas été satisfaites. En boudant la tactique du front commun pour des formalités, la direction des centrales syndicales prive le mouvement d’un formidable outil de lutte et de solidarité à un moment où il en a particulièrement besoin.
On peut donc se demander pourquoi la tactique du front commun a été délaissée. Il suffit de revenir un peu dans le passé pour découvrir qu’en apparence, le front commun a eu peu d’utilité. Le front commun de 2003 s’est effondré devant la loi spéciale de Jean Charest imposée en 2005. Celui de 2010 a plié l’échine sous la menace d’une nouvelle loi spéciale et a avalé une entente bidon. Celui de 2015 s’est félicité d’avoir conservé ses acquis, mais n’a en fait conservé que les reculs des années précédentes. Visiblement, le front commun intersyndical ne semble pas être en mesure de faire des gains, ou même de conserver ses acquis. Pas étonnant alors qu’il soit abandonné.
Toutefois, est-ce la tactique qui est à blâmer, ou la manière dont elle a été utilisée? Il ne faut pas se surprendre de notre incapacité à enfoncer des clous si l’on tient le marteau à l’envers. Si, à chaque négociation, une loi spéciale ou la simple menace d’en imposer une suffit pour forcer les dirigeants syndicaux à reculer, la lutte est perdue d’avance, qu’il y ait front commun ou non. Ces lois antidémocratiques constituent une épée de Damoclès qui pend au-dessus de toutes les négociations collectives dans le secteur public. Entre 1967 et 2005, il y a eu 13 négociations collectives du secteur public, et 12 lois spéciales. Il faudra qu’un jour ou l’autre, nos dirigeants syndicaux prennent leur courage à deux mains et refusent d’y obéir. C’est d’autant plus vrai avec un premier ministre friand des lois spéciales, lui qui en a réclamé une lors des grèves de la construction de 2013 et de 2017, ainsi que celle du CN l’an dernier. Il n’y a pas de doute, le résultat des négociations de 2020 dépendra de la volonté de la direction syndicale à s’unir pour entrer en grève et défier les lois spéciales.
Une occasion historique se présente à nous : renverser la vapeur après des décennies d’appauvrissement des travailleurs du secteur public, et mettre fin à la dynamique des lois de retour au travail imposées quasi systématiquement. Pour y arriver, il est impératif que les travailleurs du secteur public fassent front commun face au gouvernement. Certains dirigeants syndicaux diront qu’il est trop tard pour former le front commun habituel. Mais plutôt qu’un débat sur la forme, c’est le contenu qui importe. Les syndicats doivent organiser une escalade des moyens de pression, qui pourrait commencer par une grève générale de 24 heures, par exemple. De plus, les syndicats doivent s’engager à ne pas abandonner la lutte tant que toutes les revendications des travailleurs n’ont pas été satisfaites.
Le gouvernement de Legault peut sembler tout puissant, avec son taux d’approbation à 64%, le taux le plus élevé parmi les premiers ministres canadiens. La popularité de la CAQ provient de l’écoeurantite des Québécois après des décennies d’austérité libérale. Avec l’appauvrissement général, les Québécois se sont « donné Legault » en raison de sa promesse de « créer des bonnes jobs ». Mais comme l’a montré le lock-out à l’ABI, Legault préfère lécher les bottes des boss américains que de défendre nos « bonnes jobs ». Les appuis de ce gouvernement des patrons peuvent s’évaporer du jour au lendemain s’il s’en prend aux travailleurs. Jason Kenney en Alberta et Doug Ford en Ontario ont connu une chute vertigineuse dans les sondages suite à leurs coupes. Les négociations à venir pourraient être le cimetière de la popularité de Legault. Si nous nous mobilisons massivement pour opposer une résistance aux politiques d’appauvrissement de la CAQ, nous pouvons faire tomber ce gouvernement.