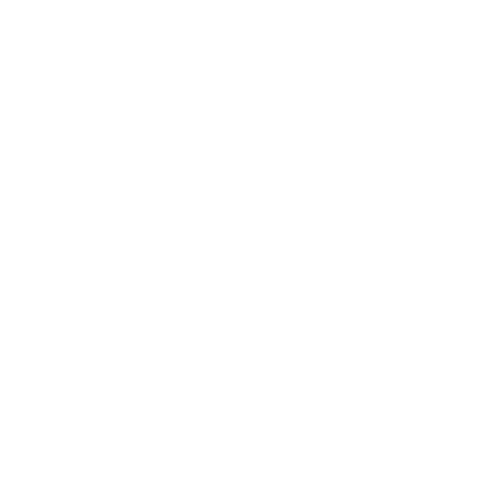Le 7 novembre, l’organisme Résilience Montréal a publié un communiqué de presse pour annoncer l’expulsion prévue le 10 novembre d’un camp de sans-abris sous l’autoroute Ville-Marie par le Service de Police de la Ville de Montréal. Depuis, l’expulsion a été reportée, mais cela ne fait que remettre le problème à plus tard : les habitants du campement n’ont simplement nulle part où aller. Alors que la mairesse Valérie Plante accorde un budget record au SPVM, le nombre de sans-abris ne cesse d’augmenter à Montréal et dans les grandes villes canadiennes, sans que personne ne propose de solution durable. En vérité, sous le capitalisme en crise, il n’y a pas de solution à l’itinérance.
La ville a du sang sur les mains
Le SPVM avait donné dix jours aux habitants du camp de survie de Ville-Marie pour évacuer les lieux, citant des travaux de maintenance sur l’échangeur de l’autoroute Ville-Marie et des plaintes des habitants du quartier avoisinant. Les travaux ont été commandés par le ministère du Transport qui aurait apparemment fait affaire avec des groupes d’interventions sociales comme ÉMMIS et Diogène pour s’assurer que les personnes sans-abris seraient prises en charge. Malheureusement, tout le soutien et la bonne volonté des travailleurs sociaux ne peuvent pas compenser pour la réalité bien matérielle des logements trop chers et du manque de place dans les refuges pour sans-abris.
On peut voir une augmentation alarmante du nombre de personnes dans la rue à Montréal depuis les dernières années. Depuis 2020, le nombre de personnes prises en charge par Résilience Montréal a plus que doublé. Selon certains travailleurs de refuge, il y aurait des centaines d’itinérants de plus qu’en 2018 à Montréal, dont un sur 10 serait Autochtone, alors que les Autochtones forment 1% de la population montréalaise. Les refuges existants ne peuvent simplement pas suivre la demande croissante. Beaucoup de ces personnes souffrent aussi de problèmes de consommation ou de santé mentale, qui requièrent des soins et un suivi spécialisés qui vont au-delà des services offerts par les refuges.
Ce n’est pas le premier démantèlement de camps de fortune ordonné par la ville de Montréal. En mai dernier seulement, Marikym Gaudreault, l’attachée de presse de la mairesse Valérie Plante, déclarait que la ville « ne tolérera pas les campements organisés de plusieurs tentes. » Il y a de cela deux ans, l’escouade anti-émeute avait été envoyée pour démanteler un campement de fortune établi sur la rue Notre-Dame en plein mois de novembre. L’été suivant, un autre camp de fortune établi au même endroit a lui aussi été détruit par des cols bleus équipés d’une pelle mécanique. À chaque fois, la même question se pose : où vont-ils aller?
Ces personnes ne se trouveront pas magiquement un logement lorsqu’on défait leur campement. Elles resteront dans la rue, où elles seront à la merci des éléments et régulièrement harcelées et déplacées par les policiers. Dans les dernières années, à Montréal seulement, au moins trois personnes, Stella Stosik, Elisapie Pootoogook et Raphaël André, sont mortes de froid dans la rue, provoquant l’indignation générale et un appel à l’action des élus municipaux, provinciaux et fédéraux. Cet appel, la maîtresse Plante y a répondu en faisant passer son budget pour combattre l’itinérance de 3 à 5,9 millions de dollars. Son budget pour la police, par contre, a été augmenté à… 724 millions de dollars.
Une crise humanitaire
Les organismes, la ville et le gouvernement provincial et fédéral se renvoient constamment la balle à savoir qui devrait subventionner quoi pour régler le problème de l’itinérance. Pour citer son rapport publié en 2022, l’ombudsman de Montréal, Nadine Mailloux, s’est retrouvée confrontée lors de son enquête à « la mobilisation de l’ensemble des entités et partenaires, la difficulté d’imputabilité entre organisations distinctes, le morcellement des responsabilités, l’étonnant dispersement des informations de base sur les ressources disponibles sur le terrain et les non-moins étonnantes réticences manifestes de certains partenaires ».
Les élus sont donc bien conscients de la crise, mais pourtant, ils continuent d’agir chaque année comme si l’arrivée de l’hiver était une urgence complètement imprévisible et à instaurer en panique des solutions temporaires. De plus, la dépendance des organismes et des refuges aux subventions et aux investissements du gouvernement rend leurs services irréguliers et instables. Comment planifier adéquatement l’hébergement de centaines de personnes, sans savoir si les fonds accordés seront toujours disponibles l’année prochaine? Déjà, certains refuges doivent ouvrir seulement la nuit, alors que d’autres peuvent ouvrir seulement quelques mois par année. Alors qu’une récession s’annonce et qu’il faut prévoir un retour de l’austérité budgétaire, ce problème risque seulement d’empirer.
Le capitalisme en cause
On n’a pas à chercher bien loin pour trouver la cause de cette crise : la pandémie, la pénurie de logements abordables et l’inflation ont durement touché les travailleurs au cours des dernières années. Alors que les salaires stagnent toujours, le coût de la vie a grimpé en flèche. Il ne faut pas oublier non plus la hausse des taux d’intérêt, qui risque de provoquer une crise hypothécaire qui aboutirait à des faillites ou des ventes à perte chez les acheteurs de maisons incapables de payer leur hypothèque. Ces derniers seraient contraints de se tourner vers la location, ce qui ferait une pression sur le marché locatif et d’augmenter le coût des loyers – sans compter ceux qui, ruinés, se retrouveraient directement à la rue.
C’est un fait indéniable que la montée de l’itinérance est directement liée à la crise du logement abordable. Pourtant, les élus se mettent la tête dans le sable en refusant carrément de reconnaître une des racines du problème. Il ne manque pourtant pas d’espace pour loger tout le monde : un rapport publié par Point2Homes en utilisant les données de Statistique Canada recensait 1,34 million de logements vacants au Canada en 2019, dont 64 000 à Montréal seulement! Il est quasiment inutile de parler de bâtir des logements sociaux quand il existe déjà dix logements vacants pour chaque personne sans-abris. Seulement, ces logements vides ne sont pas utilisés comme ils devraient l’être, pour abriter des humains, mais comme un véhicule d’investissement et une source de profit pour les capitalistes.
Notre système capitaliste montre depuis des années son impotence et son désintérêt à régler les problèmes de société : il n’a pas de solution à long terme à la crise de l’itinérance. Alors que les entreprises font des profits records, un nombre grandissant de travailleurs se retrouvent à la rue, à s’organiser dans des campements de fortune ou à se faire harceler par des policiers pour le « crime » d’être trop pauvre pour se loger.
La lutte contre l’itinérance est directement liée à la lutte contre le capitalisme : pour mettre fin une fois pour toute à cette injustice, il faut exproprier et nationaliser le marché locatif sous le contrôle démocratique des travailleurs afin de mettre un logement à disposition de tout le monde. Il faut mettre fin à ce système cruel qui fait passer le profit avant la vie humaine. Il nous faut une société socialiste.