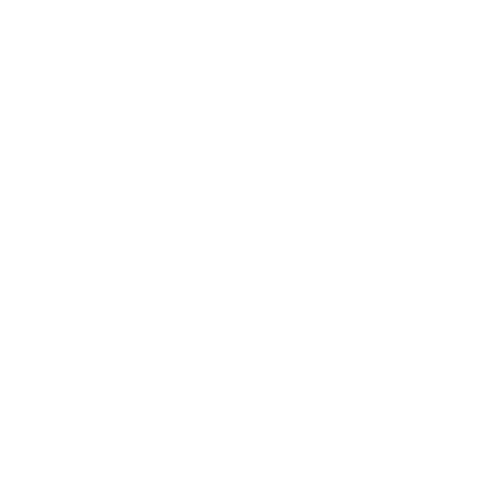Le 20 mars dernier, dix jours avant la fin des conventions collectives d’environ un demi-million de travailleurs et travailleuses du secteur public et para-public, 75 000 travailleurs et travailleuses du Québec ont inondé massivement les rues de Montréal afin d’exposer leur unité et leur force au gouvernement Charest. La fin du contrat ne pourrait survenir à un pire moment pour ce gouvernement, car il est pris aujourd’hui avec un déficit touchant presque les 5 milliards de dollars cette année.
Allant bien au-delà des estimations par le Front commun, la manifestation a été la plus importante que le Québec ait connu depuis celle des étudiants et étudiantes en 2005. Dès midi, les travailleurs et travailleurs ainsi que leurs familles se sont rassemblés au square Dorchester et à 13h, ils ont marché vers le bureau du premier ministre Jean Charest, où une scène a été installée au milieu de la rue pour que les dirigeants syndicaux puissent s’adresser aux travailleurs et travailleuses. Les manifestantEs ont occupé l’avenue McGill College et étaient si nombreux et nombreuses que la queue de la marche était coincée un bloc plus loin sur la rue Saint-Catherine. Les trois dirigeants du Front commun: Claudette Carbonneau de la Confédération des syndicats nationaux (CSN); Michel Arsenault, de la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ); et Dominique Verreault du Secrétariat intersyndical des services publics (SISP), ont chacun pris leur tour de parole pour s’adresser à la foule.
L’ambiance était à la fête, mais sous celle-ci se trouvait une colère bouillonnante et une volonté de se battre. Martine Molière, une infirmière présente à la manifestation, qui travaille à l’Hôpital de Gatineau, a déclaré que les négociations sont vouées à l’échec. « Quand les négociations échoueront, on va faire la grève. Tout le monde le sait, » a-t-elle dit.
Les négociations entre les travailleurs du secteur public et le gouvernement sont arrivé à une impasse: les ouvriers cherchent une hausse de 11,25 % des salaires sur une période de trois ans alors que le gouvernement propose une augmentation méprisable de 7 % des salaires et avantages des travailleurs sur une période de cinq ans.
Les négociations ont débuté l’an dernier, lorsque les trois plus grandes fédérations syndicales au Québec – CSN, FTQ et SISP – ont formé un front commun réunissant 475 000 du total de 550 000 travailleurs du secteur public dans la province. Ce front commun est plus grand que le Front commun de 1972 qui a rassemblé 210 000 employés du secteur public et a secoué la société québécoise avec une grève générale de proportion révolutionnaire.
Le 31 mars 2010 marquera l’expiration de la convention collective pour les travailleurs du secteur public, mais celle-ci n’était pas une convention collective ordinaire. Cette convention n’avait rien de collective ni d’agréable ; elle a été imposée en 2005 par le gouvernement Charest par l’intermédiaire du projet de loi oppressif 142 (Loi C-43). La loi a imposé un gel de deux ans sur le salaire et une maigre augmentation salariale de 2 % pour quatre ans. Elle a également mit fin à l’équité salariale, qui était censée mettre fin aux discriminations entre les sexes en augmentant les salaires des travailleurs dans les emplois à prédominance féminine. En outre, la clause la plus importante du projet de loi était la disposition anti-grève. Le C-43 prévoyait également une punition pour tout travailleur défiant ses dispositions. Tout travailleur du secteur public en grève serait confronté à la perte de deux jours de salaire pour chaque jour de travail perdu, et des amendes allant jusqu’à 500 dollars. Lorsque ce projet de loi a été adopté, il n’y a eu aucune résistance significative de la part des syndicats. Rien n’est plus décourageant qu’une bataille perdue sans combat. La démoralisation massive était évidente quand il n’y a eu guère de soutien en provenance des travailleurs pour les 60 000 étudiants qui étaient en grève en novembre 2007 malgré qu’une de leurs revendications était l’annulation de la loi C-43.
Pendant cinq ans, les travailleurs du secteur public ont gardé leur tête basse. Maintenant que la loi arrive à expiration, ils savent qu’il est temps de demander ce qui leur appartient légitimement. Les travailleurs ont fait un grand sacrifice pendant cinq ans ; selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les salaires du secteur public ont pris du retard sur ceux du secteur privé. L’ISQ signale que les salaires du secteur public québécois est de 8,7 % inférieur à la moyenne provinciale, y compris les employés fédéraux et municipaux, et 6 % de moins que le secteur privé. Cependant, au bout d’un contrat imposé de cinq ans, le désir des travailleurs de récupérer le terrain perdu est en contradiction avec la crise du capitalisme. Le Québec a une dette totale de 285,6 milliards de dollars, ce qui équivaut à 94,6 % du PIB de la province. Seul le Japon, l’Italie, la Grèce et l’Islande ont une dette plus grande en proportion du PIB que le Québec. Ainsi, une épreuve de force est imminente—qui risque de prendre plusieurs chemins.
Il est presque impossible pour le gouvernement d’accepter les demandes du Front commun, tant pour de raisons financières que politiques. Les capitalistes du Québec ont lancé une offensive idéologique contre la classe ouvrière au cours de la dernière décennie. A partir du document « Pour un Québec Lucide » de 2003 à l’appel lancé récemment par le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, à une « révolution culturelle », le gouvernement prévoit obliger les travailleurs à accepter des réductions de financement afin de payer pour la crise. Toute concession accordée aux travailleurs signifiera une retraite, et donc une défaite politique qui pourrait enhardir la population. Bien que la majorité des travailleurs ont depuis longtemps oublié le Front commun de 1972, la bourgeoisie s’en souvient encore clairement, puisque c’était l’époque où le pouvoir a brièvement glissé hors de ses mains. Les capitalistes craignent à juste titre que la victoire du Front commun, même une maigre victoire, pourrait évoquer les leçons de 1972 à la mémoire collective de la classe ouvrière. Par conséquent, dans cette lutte, la défaite n’est pas permise, et ce, de chaque côté.
En plus de se battre sur le plan industriel, les travailleurs ont également besoin d’une expression politique en vue de défaire le gouvernement. Avec un coup de crayon, le gouvernement peut faire reculer toutes les gains âprement disputés, comme le montre le projet de loi draconien 142 en 2005. Les travailleurs québécois ont besoin de leur propre parti politique qui pourrait leur donner une expression politique organisée. Le Parti Québécois (PQ) s’est avérée n’être rien d’autre qu’un parti bourgeois. En ce qui concerne le Front commun, la chef du PQ Pauline Marois a prévenu aux travailleurs du secteur public qu’ils se sont laisser aller avec leurs demandes et a dit qu’elles: «semblent à première vue un peu élevées». Dans cette épreuve décisive, le PQ a clairement pris parti pour les patrons. Au sein du parti, ils ont même expulsé les syndicalistes de SPQ-Libre à ce sujet et ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde en arrive à une vision claire du caractère de classe du PQ. Le seul parti qui a pleinement soutenu le Front commun depuis sa création est Québec Solidaire (QS). QS a soutenu le Front commun et le parti se doit de suivre cette question avec une perspective claire de se transformer en parti des travailleurs du Québec. QS doit le faire d’abord par l’adoption d’un programme socialiste de la classe ouvrière et, deuxièmement, en faisant du travail sérieux à la base afin de gagner les travailleurs organisés dans leurs rangs. De même, les dirigeants des syndicats du Front commun, la CSN, la FTQ et la SISP, doivent se rendre compte que tous les autres partis politiques sont opposés à eux. Les syndicats doivent s’affilier officiellement à QS et le transformer en un parti des travailleurs – cette unité dans la lutte est le seul moyen qui mènera à la victoire des travailleurs sur les lignes de piquetage et aux élections.
Une direction ferme est nécessaire maintenant plus que jamais. Face à la plus grande crise du capitalisme depuis la Grande Dépression, de simples revendications économiques ne conduisent qu’à la capitulation et ne suffisent plus. La raison pour laquelle le capitalisme québécois se retrouve avec un tel déficit est justement à cause de l’aide sociale accordée aux compagnies et du sauvetage massif des grandes banques et aux grandes corporations. En d’autres termes, le gouvernement a sauvé les capitalistes qui ont ruiné l’économie au détriment des travailleurs. Ainsi, si les syndicats et leurs dirigeants ont sérieusement l’intention de protéger les travailleurs, ils doivent être prêts à défier politiquement et directement le capitalisme. Les syndicats doivent se préparer dès maintenant à défier un nouveau contrat forcé comme celui imposé par la loi C-43, et la base de ces syndicats doit faire en sorte que leurs dirigeants ne les trahissent pas afin d’éviter une répétition de la démoralisante capitulation de 2005. Les 475 000 travailleurs du secteur public unis dans le Front commun n’ont pas seulement une responsabilité envers eux-mêmes, mais aussi envers l’ensemble de la classe ouvrière du Québec. Leur victoire peut servir d’exemple aux autres travailleurs et peut clarifier la confusion qui a été semée par la récession de 2009. Victoire au Front commun!