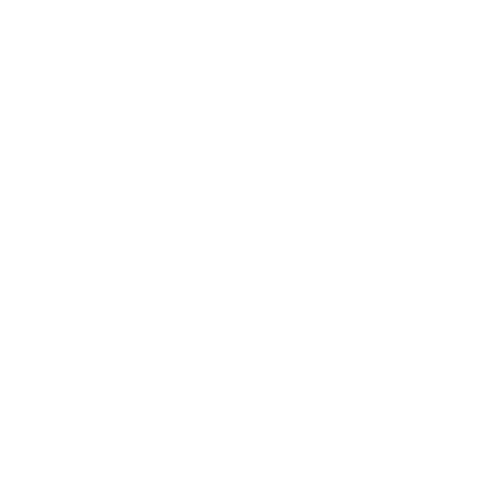La grève tant attendue du secteur public a commencé. Du 26 au 29 octobre, 400 000 travailleurs-euses du secteur public au Québec ont organisé des grèves pour protester contre les mesures d’austérité du gouvernement libéral provincial. Ces grèves étaient rotatives, avec chaque jour différentes régions en grève. Une autre vague de grèves tournantes aura lieu en novembre, puis le mouvement culminera par une grève générale provinciale de trois jours du secteur public les 1er, 2 et 3 décembre.
Après leur victoire électorale l’an dernier, les libéraux n’ont pas tardé à s’engager dans un ambitieux programme de coupures profondes dans les dépenses sociales. Des milliards de dollars ont été extorqués au secteur public alors que les frais de garderie, d’électricité et d’autres services publics ont été haussés. Cherchant à serrer la bride aux dépenses publiques, le gouvernement Couillard s’en prend aux salaires, aux pensions et aux conditions de travail dans le secteur public. Le mécontentement et la colère se sont accrus chez les travailleur-euses, alors que des manifestations de masse sont désormais monnaie courante, des actions étant constamment organisées dans toutes les régions de la province. La plus récente démonstration de force a été la manifestation du 3 octobre dernier qui a rassemblé 150 000 travailleurs-euses du secteur public dans les rues de Montréal.
Le printemps dernier, en dépit d’un désir évident dans la base militante de se battre contre le gouvernement, les directions syndicales ont étouffé la mobilisation s’embourbant dans ce qui pourrait seulement être décrit comme un cirque de négociations. Toutes les mobilisations ont été mises en attente et l’élan acquis au fil des mois a été sabordé. En dépit de cela, les syndicats d’enseignants-es d’environ 30 cégeps ont organisé une grève illégale d’une journée le 1er mai contre la volonté de leurs dirigeants syndicaux. Pour cela, de nombreux enseignant-es ont été suspendu-es ou réprimandé-es par les administrateurs.
Comme il fallait s’y attendre, les négociations au cours de l’été se sont avérées être une blague, le gouvernement insistant d’une manière intransigeante pour que les travailleurs-euses paient pour le mauvais état des finances publiques. En fait, au milieu des négociations, le premier ministre Philippe Couillard a eu le culot de se vanter de ce qu’ils étaient en train de faire. Lors d’une allocution au congrès du Parti libéral en juin dernier, il lançait :«les citoyens nous ont dit: « Vous faites ce qui doit être fait. Il faut continuer, et ne lâchez pas ! » Notre tâche n’est pas facile. Les résultats positifs commencent à se faire sentir. Soyons prudents, il reste encore du chemin à faire. L’économie du monde est encore agitée, instable».
Répression en préparation contre l’action syndicale
Face à la résistance montante de la classe ouvrière, le gouvernement a réprimé les droits démocratiques fondamentaux. En mai dernier, Marc Cuconati, président du syndicat des travailleurs de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, affirmait au journal Le Devoir que « depuis l’élection du gouvernement libéral, on subit de la répression sans précédent. Toute contestation est étouffée et bâillonnée de façon systématique. Cela se traduit par une censure digne de l’époque de Duplessis. » Nicole Daniel, la présidente du syndicat des travailleurs-euses du nouveau CIUSSS de l’Est-de-l’Île s’est également plainte de telles mesures. En mai dernier, elle expliquait au Devoir que les membres du syndicat se font maintenant même interdire de porter le chandail syndical. « Depuis février, toutes les personnes qui portent ce chandail se font avertir que c’est illégal. On a eu dix avis disciplinaires et une employée s’est même fait suspendre. On trouve que c’est intolérable, c’était notre seul moyen de protestation visible. » La présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Dominique Daigneault, croit que les administrateurs qui mettent en œuvre ces mesures disciplinaires sévères sont des « cadres qui semblent avoir peur de perdre leur emploi et [qui] appliquent de façon antidémocratique une politique interne qui limite le pouvoir syndical et la liberté d’expression ».
Tout ceci fait partie des tentatives du gouvernement d’imposer juridiquement sa volonté aux travailleurs-euses du secteur public. Cela est devenu particulièrement évident lorsque, au milieu des négociations, il a commencé à conspirer avec les municipalités pour leur permettre de dicter les conditions de travail aux employé-es municipaux par décret, s’il n’y a pas d’avancement dans le processus de négociation. Le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, lors d’une réunion avec l’Union des municipalités du Québec au mois de mai, promettait : « Vous réclamez de nouveaux outils? Nous vous en donnerons. Nous allons donc débattre des modifications à apporter au cadre des relations de travail dans le milieu municipal. »
La récrimination de maires comme Régis Labeaume est que les municipalités sont « prises en otage par les syndicats » en raison du fait qu’elles ne peuvent pas imposer de retour au travail et dicter les conditions de travail, comme le gouvernement provincial est capable de le faire. « Ça fait huit ans que je demande qu’on puisse décréter les conditions de travail. On ne pourra jamais parler d’autonomie municipale si on ne peut pas avoir de poignée sur la plus grosse dépense de la Ville. […] Pour moi le gros morceau il est vraiment là. »
Le résultat des discussions entre le gouvernement provincial et les municipalités est un nouveau « pacte fiscal », contenant une réduction annuelle de 300 millions $ dans les transferts aux municipalités. Afin de donner aux municipalités le muscle juridique pour l’imposer de force aux travailleurs-euses s’ils protestent, Moreau entend leur donner plus de pouvoirs. Cela pourrait comprendre par exemple un mécanisme de « meilleure offre finale », qui permettrait à l’arbitre d’imposer la dernière offre de l’employeur. Ça ne prend pas un génie pour voir que la « meilleure offre finale » des municipalités ne seront pas enlevantes, avec 300 millions $ de moins dans leurs coffres. La plupart des détails de ces nouveaux pouvoirs n’ont pas encore été dévoilés, mais il est évident qu’il ne s’agit pas là de bonnes nouvelles pour les travailleurs-euses. La présidente de l’Union des municipalités du Québec, Suzanne Roy a applaudi cette nouvelle entente, affirmant : « Cela nous donne une position un peu plus confortable, alors qu’auparavant on avait souvent les mains liées ».
Cette entente a été largement dénoncée par les dirigeants syndicaux, la dénonciation la plus forte venant du président de la Fraternité des policiers, Yves Francoeur, qui dénonçait ces nouveaux pouvoir comme revenant à « transformer les maires en monarques absolus ».
Le spectre d’une loi spéciale
Alors que les grèves se mettent en oeuvre et que la grève générale de trois jours se dessine dans un avenir proche, il y a un éléphant dans la pièce. C’est bien sûr la si souvent utilisée loi de retour au travail ou « loi spéciale ». À maintes reprises, à chaque fois que les travailleurs-euses commencent à lutter contre l’injustice et l’austérité imposées les gouvernements à la botte des entreprises, ces gouvernements utilisent la loi pour leur retirer leur droit de grève. Un rapide coup d’œil sur l’histoire des luttes ouvrières dans la province nous montre que peu importe quel parti est au pouvoir, le gouvernement a toujours été rapide à enlever le droit de grève. En 1972, après une grève générale du secteur public d’une semaine, le gouvernement libéral de Robert Bourassa a adopté une loi de retour au travail pour mettre fin au mouvement de grève. En 1982, le gouvernement du Parti québécois de René Lévesque a imposé une convention collective à 310 000 travailleurs-ses du secteur public en grève, mettant fin à leur grève. En 1999, Pauline Marois, ministre de la Santé à l’époque, a imposé la loi 160, mettant un terme à la grève des infirmières. En 2005, le gouvernement libéral de Jean Charest a imposé une fois de plus des contrats de travail aux travailleurs-ses du secteur public. Le dernier gouvernement péquiste de Pauline Marois a promulgué une loi de retour au travail en 2013, forçant 77 000 grévistes de la construction à retourner au travail.
Le mouvement de grève actuel représente une opportunité fantastique pour repousser l’ordre du jour d’austérité du gouvernement du Québec. La créativité, le militantisme et le désir de se battre démontrés par les travailleurs-euses de la base jusqu’à présent ont été exemplaires. Ceux-ci forment la seule force vraiment capable de vaincre les capitalistes québécois et leurs laquais dans le gouvernement Couillard. Par conséquent, les mouvements ouvrier et étudiant dans leur totalité, à la fois dans les secteurs public et privé, tant au Canada anglais que français doivent se rallier derrière les travailleurs-ses du secteur public du Québec. Des manifestations de solidarité, des grèves et des lignes de piquetage doivent être organisées pour les aider dans leur lutte. Une victoire pour les travailleurs-ses du secteur public au Québec servirait de source d’inspiration pour la classe ouvrière partout au pays.
Il est impératif que le mouvement soit armé avec la perspective de défier toute tentative par le gouvernement de légiférer pour obliger les travailleurs-euses à retourner au travail. La classe ouvrière devrait tirer inspiration de l’expérience de 2012 lorsque les étudiants-es québécois-es ont défié le projet de loi anti-démocratique 78 et ont déclenché un des plus grands mouvements de désobéissance civile dans l’histoire du Canada. Une loi n’est qu’un morceau de papier lorsque les masses refusent d’y obéir. Nous avons vu comment les grèves dans la période récente ont été vaincues par un diktat du gouvernement. Par conséquent, le mouvement doit se préparer dès maintenant à défier une loi de retour au travail. Lorsque la masse des travailleurs et des travailleuses se met en mouvement, il n’y a aucune force sur terre qui peut les arrêter!