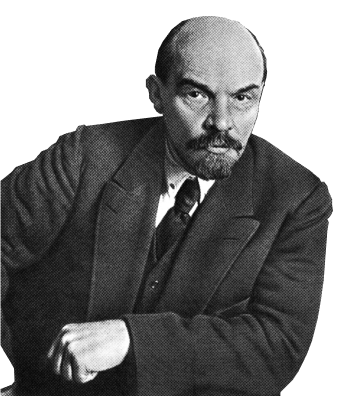Nous publions ci-dessous la deuxième partie de nos Perspectives mondiales 2016 qui seront discutées, amendées et adoptées lors du Congrès mondial de la Tendance Marxiste Internationale, fin juillet.
<<< Retour à la première partie
Les illusions de la bourgeoisie
La chute de l’Union soviétique et la fin de la guerre froide ont ouvert aux capitalistes européens la perspective éblouissante d’une prospérité économique permanente et d’une intégration européenne sans limites. L’Europe (sous contrôle allemand) pourrait continuer de s’étendre jusqu’à l’Oural. Ivres de rêves de grandeur, les capitalistes européens ont accepté d’abandonner une part importante de leur souveraineté nationale dans des domaines très sensibles. La création de la zone euro en est l’un des exemples les plus frappants.
Par le passé, nous soulignions l’impossibilité de l’union monétaire sans union politique. Nous avions prévu que l’euro durerait tant que les conditions économiques resteraient favorables, mais que dans le cas d’une récession, tous les antagonismes nationaux réémergeraient et que l’euro s’effondrerait « au milieu des récriminations mutuelles ». Vingt-cinq ans plus tard, cette prédiction garde toute sa force.
Les marxistes défendent sans aucune équivoque l’abolition de toutes les frontières et l’unification de l’Europe. Mais sur une base capitaliste, ces ambitions constituent une utopie réactionnaire. Cet aspect réactionnaire a été illustré par le traitement brutal infligé à la Grèce par Bruxelles et Berlin. Sous la domination des banques et des capitalistes, l’UE défend une politique d’austérité permanente. Une clique de bureaucrates irresponsables et non élus peut imposer des choix politiques et rejeter les décisions de gouvernements élus, comme celui de Syriza en Grèce.
Alliée à l’OTAN et à l’impérialisme américain, l’UE joue aussi un rôle réactionnaire à une échelle mondiale. Elle est intervenue dans les Balkans, où elle a contribué au démembrement criminel de la Yougoslavie. Elle a fomenté l’éclatement de la Tchécoslovaquie – au sujet duquel ni les Tchèques ni les Slovaques n’ont été consultés. Son ingérence en Ukraine, de concert avec les États-Unis, a causé le monstrueux désordre que l’on connaît. Tout cela n’a été fait que dans un seul intérêt : celui de l’impérialisme allemand, véritable maître de l’Union européenne, et qui s’est efforcé de réaffirmer sa domination en Europe de l’Est et dans les Balkans.
Les autres pouvoirs impérialistes en Europe, aux premiers rangs desquels l’Angleterre et la France, jouent désormais le rôle de partenaires subalternes de l’Allemagne. Ils poursuivent cependant leurs propres intérêts impérialistes en Afrique, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes, sous l’étendard de l’UE. Les Français et les Britanniques ont mené conjointement les opérations de bombardement de la Libye ; le Royaume-Uni s’est comporté comme l’allié le plus enthousiaste des Américains lors de l’invasion de l’Irak. La France joue à présent un rôle similaire en Syrie. Tous poursuivent leurs intérêts personnels et cyniques, évidemment sous couvert « d’humanitarisme ».
L’Euro, mais aussi l’accord de Schengen, constituent les pierres angulaires de l’Union européenne. Avec la création de l’espace Schengen, le coût et la durée du transport des marchandises à travers l’Europe ont été considérablement réduits, les transporteurs n’ayant plus à patienter des heures aux frontières ; les touristes, les travailleurs et les habitants frontaliers n’ont plus besoin de passeports ou de visas ; les frontières devenant obsolètes, des économies sont réalisées grâce à la suppression de patrouilles douanières, devenues inutiles. Ce traité devait être une étape-clé dans la création d’une Europe fédérale.
En 1995, l’accord de Schengen a éliminé les contrôles aux frontières entre les signataires, et a créé une politique commune des visas pour 26 pays. Mais aujourd’hui, le processus vers une plus grande intégration européenne s’est inversé. La crise de l’Union européenne a été abruptement révélée par le problème des réfugiés.
L’Europe et la crise des réfugiés
Après les massacres de novembre 2015 à Paris, la question du Moyen-Orient s’est finalement imposée en Europe. Simultanément, l’arrivée de milliers de personnes désespérées fuyant les horreurs de la guerre, de la famine et de l’oppression, a mis les dirigeants européens face à un dilemme. En réalité, la crise des réfugiés est une crise globale, qui n’est pas cantonnée au seul Moyen-Orient. Au niveau mondial, le nombre de personnes déplacées par les guerres, les persécutions de minorités et les violations des droits de l’homme approchait les 60 millions à la fin 2014. Ce chiffre reflète de façon criante la crise mondiale du système capitaliste – son incapacité à offrir aux populations le plus élémentaire des droits de l’homme, le droit de vivre. L’afflux massif de réfugiés en provenance de Syrie, d’Afghanistan et d’autres parties du monde déchirées par la guerre et la pauvreté a entraîné l’exigence de contrôles plus stricts des frontières.
Angela Merkel a été prompte à ouvrir ses bras aux pauvres réfugiés qui frappaient à sa porte, en partie dans une tentative de capitaliser sur les sincères sentiments de sympathie naturellement exprimés par nombre de gens en Allemagne et en Europe. Les gens ordinaires, dont les pensées et les actions ne sont pas dictées par les froids calculs qui motivent les banquiers et les capitalistes, montrent toujours de la sympathie et de la solidarité envers les pauvres et les opprimés. D’autre part, les grandes entreprises étaient favorables à une politique d’ouverture des frontières, non par compassion pour la souffrance des autres, mais dans le but de s’attacher un important réservoir de main-d’œuvre bon marché.
Quoi qu’il en soit, la générosité de Merkel n’a pas duré longtemps. L’Allemagne s’attendait à recevoir plus d’un million de demandeurs d’asile en 2015. Mais les attaques contre les camps de réfugiés ne cessent d’y progresser, tout comme les votes en faveur des partis de droite anti-immigration comme Alternativ für Deutschland. Aujourd’hui Merkel supplie la Turquie non seulement de stopper l’arrivée de réfugiés, mais également de reprendre ceux qui sont déjà en Europe. Berlin exige qu’une répartition proportionnelle des migrants soit rapidement mise en œuvre sur le territoire européen – une suggestion qui n’est pas reçue avec enthousiasme à Londres et Paris, et qui est purement et simplement rejetée à Varsovie et Budapest.
De vives contradictions ont émergé entre les membres de l’Union européenne. Les autorités françaises et autrichiennes accusent Rome de permettre aux demandeurs d’asile de quitter l’Italie, voire de les y encourager, et menacent de fermer leurs frontières avec elle. Et effectivement, la France a mis sa menace à exécution et a brièvement fermé sa frontière en juin 2015. L’Allemagne, pays le plus riche d’Europe, est en capacité d’accueillir un grand nombre de réfugiés, contrairement à d’autres : l’Italie et la Grèce ont pris en charge un plus grand nombre de réfugiés que la plupart des autres pays européens, ils ont sans cesse demandé plus de ressources et l’introduction de quotas d’immigration dans l’Union européenne, mais ces demandes sont tombées dans l’oreille d’un sourd. Les pays d’Europe centrale et de l’est ont immédiatement rejeté cette idée de quotas.
Le problème est désormais posé : que faire de l’accord de Schengen, qui permet aux immigrés de se déplacer librement au sein des États membres ? Déjà avant les événements de Paris, le président polonais du Conseil européen Donald Tusk avait affirmé : « Qu’il n’y ait aucun doute : le futur de l’espace Schengen est en jeu et le temps presse… nous devons reprendre le contrôle de nos frontières extérieures. » Les attentats de Paris ont fourni aux gouvernements – non seulement français, mais également suédois et allemand – une justification opportune pour réintroduire « temporairement » des contrôles aux frontières.
À travers l’Europe, un sentiment de méfiance et d’hostilité à l’égard de l’UE, ainsi qu’un malaise grandissant, se développent. À la suite du traitement brutal qui a été infligé à la Grèce, l’opposition politique à Bruxelles ne cesse de croître, chez les travailleurs et dans la jeunesse des pays du sud de l’Europe, opposés à l’austérité. À l’autre extrémité se dressent des partis de droite anti-immigration et populistes, en Allemagne, en France, en Finlande, au Danemark, comme dans d’autres pays d’Europe du Nord.
Plus les États maintiendront les contrôles aux frontières et les barbelés, plus le principe d’une Europe ouverte sera discrédité. La montée des partis nationalistes et anti-immigration en Allemagne, en France, en Finlande, au Danemark, en Suède ou en Hongrie, accroit la pression sur les gouvernements européens pour qu’ils ferment leurs frontières. Les jours de l’Accord de Schengen sont clairement comptés. S’il n’est pas tout simplement aboli, il sera certainement revu à un degré tel qu’il ne devrait plus rester grand-chose du « principe sacré » de libre circulation en Europe.
Les États membres réclament plus de pouvoir discrétionnaire concernant la réintroduction des contrôles aux frontières. Avec ou sans réforme de l’espace Schengen, des contrôles de police plus stricts auront lieu dans les gares, ferroviaires et routières, et dans les aéroports. C’est ce qui est déjà en train d’arriver. Les lois encadrant les droits des migrants seront durcies, pour leur rendre plus difficile l’obtention d’une protection sociale. Des pays comme la Roumanie ou la Bulgarie, qui n’ont pas encore rejoint l’espace Schengen, vont souhaiter des contrôles plus sévères. La Pologne et la Hongrie, dans l’orbite de l’impérialisme allemand, sont à présent en conflit ouvert avec Berlin sur la question des réfugiés.
La remise en cause de l’accord Schengen conduira nécessairement à des restrictions à la libre circulation des personnes, un des piliers de l’Union européenne. Une fois qu’un principe de base est ébranlé, la porte est ouverte pour que d’autres principes soient également affectés. La suppression ou la restriction de la libre circulation des personnes pourrait entraîner des restrictions à la libre circulation des marchandises. Parallèlement à un effondrement de l’euro, ce qui est tout à fait possible, cela signifierait la fin de l’Union européenne telle que nous la connaissons. Rien ne subsisterait du rêve de l’unité européenne, à part une coquille vide.
Sous le capitalisme, l’idée d’un continent sans frontières restera un rêve inatteignable. L’unification de l’Europe, une nécessité historique et une tâche progressiste, ne pourra être achevée que lorsque les travailleurs européens se seront mis en mouvement pour renverser la dictature des banques et des monopoles, et jetteront les bases d’une union libre et volontaire des peuples, sur la base des États-Unis Socialistes d’Europe.
Relations internationales
Du point de vue des relations internationales, la période que nous vivons ne connaît pas de précédent historique. Par le passé, il y avait toujours au moins trois ou quatre grandes puissances qui se disputaient le leadership à l’échelle européenne ou internationale. Ainsi, les relations internationales tendaient vers de longues périodes d’équilibre relatif, périodiquement ponctuées de guerres.
L’instabilité économique s’exprime également dans une instabilité politique croissante. Les relations internationales n’ont jamais été aussi tendues depuis la Seconde Guerre mondiale. Les tendances expansionnistes agressives de l’impérialisme américain, depuis la chute de l’URSS, ont créé le chaos absolument partout : dans les Balkans, au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Afrique du Nord, au Pakistan et dernièrement en Afrique.
Avant la Seconde Guerre mondiale, Trotsky prédisait que les États-Unis deviendraient la première puissance mondiale, après la guerre. Mais il ajoutait qu’il y aurait une grande quantité de dynamite dans ses fondations. Cette prédiction s’est dramatiquement confirmée lors des attentats du 11 septembre 2001.
Les États-Unis se sont imposés comme la puissance mondiale dominante en 1945. L’expansion de la puissance américaine s’est accompagnée de l’effondrement des puissances impérialistes européennes. La Seconde Guerre mondiale a brisé le développement du Japon et de l’Europe occidentale. Les États-Unis exerçaient une domination économique, militaire et politique, même s’ils étaient confrontés à la puissance de l’Union soviétique.
Un équilibre instable fut établi, qui devait durer presque un demi-siècle. Le pouvoir n’était pas à Londres, Paris ou Varsovie. Il était à Moscou et à Washington. Il n’était pas question, alors, que les États-Unis interfèrent dans des pays comme l’Irak, la Syrie ou la Yougoslavie, qui étaient dans la sphère d’influence soviétique. Washington pouvait encore moins envisager de s’impliquer en Ukraine ou en Géorgie, qui faisaient toujours partie de l’Union soviétique.
Tout ceci fut remis en cause par la chute de l’URSS, il y a plus de vingt ans. Sombrant dans une crise interne, sous la pression d’un mouvement massif de protestation, Moscou fut contraint de se désengager de l’Europe de l’Est. C’était la fin du Pacte de Varsovie dirigé par Moscou. Cependant, l’OTAN demeurait une menace potentielle pour la Russie.
Dans les années 80, le président américain Ronald Reagan promit au leader soviétique Mikhail Gorbatchev que les Occidentaux n’avaient aucune velléité d’expansion de l’OTAN vers l’est, dans la sphère d’influence de l’Union soviétique. C’était un mensonge. Ces vingt dernières années, les États-Unis ont systématiquement élargi l’OTAN vers l’Est, incorporant de nombreux pays situés précédemment dans la sphère d’influence de l’URSS.
Les impérialismes allemand et américain étaient à l’œuvre dans le démembrement de la Yougoslavie, lequel eut des conséquences entièrement réactionnaires pour les peuples qui y vivaient. Ce fut aussi une grande humiliation pour la Russie. Alors qu’elle y avait des troupes, cela n’empêcha pas les Occidentaux d’intervenir ; l’armée russe était reléguée au rôle de spectatrice impuissante.
Par le passé, les contradictions que nous voyons aujourd’hui à l’échelle internationale auraient mené à une guerre mondiale. Mais ce n’est plus une issue possible aujourd’hui. Les rapports de force à l’échelle planétaire ne le permettent plus. Cela ne signifie pas que nous sommes dans une époque de paix. Au contraire, les contradictions trouvent leur expression dans une interminable série de conflits, menant à de terribles bains de sang et au chaos.
Bien que les États-Unis restent extrêmement puissants, ils sont loin d’être omnipotents. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont souligné les limites de l’impérialisme américain. Même l’État impérialiste le plus puissant ne peut se permettre d’être impliqué directement dans un trop grand nombre de conflits. Il se trouverait bien vite complètement épuisé économiquement et politiquement, alors que l’opinion publique se prononcerait rapidement contre les interventions étrangères. C’est ce que ne comprenait pas la clique dirigeante de George W. Bush, atteinte de myopie chronique ; son successeur a dû apprendre cette leçon, dans la douleur.
La Russie et les États-Unis
Poussée par l’impérialisme américain, l’OTAN avança jusqu’aux frontières de la Russie. D’abord, les États des Balkans furent intégrés à l’OTAN, puis la Pologne les rejoignit. Mais en essayant d’y faire entrer la Géorgie, les Américains firent le pas de trop. L’armée russe fut envoyée et la Géorgie rapidement écrasée. C’était à présent au tour des Américains d’être humiliés, pendant que la Russie se saisissait de grandes quantités d’armes et d’équipement fournis aux Géorgiens par la clique dirigeante de Washington (y compris des sièges de toilette).
L’avertissement était clair pour les Américains. Le Kremlin leur disait : « jusque-là et pas plus loin ! » Mais les cercles du pouvoir américain sont aveugles, sourds et idiots. Alors que les Allemands étaient prêts à se retirer du conflit ukrainien à la fin de l’année 2013, John Mc Cain et ses alliés Républicains intervinrent, forçant la main d’Obama sur cette question. Ils voulaient leur revanche sur la Russie après leur humiliation en Géorgie, et prévoyaient d’entraîner l’Ukraine dans le giron de l’Europe et de l’OTAN. L’idée que Poutine accepterait tranquillement la perte de l’Ukraine était extrêmement stupide. Il était encore plus stupide d’attendre de lui qu’il accepte la perte de la Crimée, alors que la marine russe y possède l’énorme base navale de Sébastopol.
Le coup d’État d’extrême-droite à Kiev, soutenu par les nationalistes extrémistes et des forces fascistes, réussit à renverser le gouvernement de Ianoukovitch. Mais ce faisant, il plongea l’Ukraine dans l’abîme, l’effondrement économique et la guerre civile. De façon prévisible, les Occidentaux ne tinrent aucune de leurs promesses au peuple ukrainien. Ils n’ont rien fait, non plus, pour résister à la Russie, malgré leurs poings brandis et leurs menaces.
Les sanctions imposées à la Russie n’ont pas fragilisé le régime de Poutine ; elles l’ont au contraire renforcé. Avant la crise ukrainienne et les sanctions américaines, Poutine n’était pas vraiment en position de force, sur le plan intérieur. Mais les mesures prises par les États-Unis pour « punir la Russie » ont eu le résultat inverse de celui escompté. Poutine a pu surfer sur une vague de patriotisme. À un certain point, il a même bénéficié de 90 % d’opinions favorables.
À première vue, il peut sembler paradoxal que Poutine soit sorti renforcé des crises ukrainienne et syrienne. Les efforts des Occidentaux pour l’isoler ont lamentablement échoué. En Syrie, Poutine est désormais celui qui mène la danse. Et même si les États-Unis persistent à maintenir les sanctions contre la Crimée et l’Ukraine, nous pouvons prédire de façon assez certaine que les alliés européens vont finir par abandonner les leurs. L’économie européenne, rongée par la crise, a besoin du marché russe et du gaz russe, tout comme les capitalistes européens ont besoin des Russes pour aider à faire le ménage en Syrie – et arrêter le flot incessant des réfugiés.
Mais si nous regardons plus en détail la situation de la Russie, il devient évident que tout n’y est pas aussi stable que cela. L’économie russe continue de s’effondrer, frappée par la chute des prix du pétrole et par les sanctions occidentales. Les salaires réels baissent. La classe moyenne ne peut plus passer de plaisants week-ends à Londres ou Paris. La grogne s’installe, mais rien ne se passe. Les travailleurs russes ont été influencés par la propagande sur l’Ukraine. Ils ont été scandalisés par les activités des fascistes ukrainiens et des ultranationalistes. Poutine a réussi à tourner à son avantage leur sympathie naturelle pour leurs frères et sœurs d’Ukraine orientale. Sur cette base, sa cote de popularité s’est envolée.
Poutine est peut-être capable de se maintenir au pouvoir pour un temps, mais tout a une limite. L’Histoire finit toujours par présenter la facture. La crise économique a conduit à un effondrement brutal du niveau de vie de nombreux travailleurs, essentiellement autour de Saint-Pétersbourg et Moscou. Les masses sont patientes, mais leur patience a des limites bien définies. On en a vu la preuve à la fin de l’année 2015, lorsque les routiers russes se sont mis en grève. C’était certes un petit symptôme, mais un symptôme néanmoins, du fait que tôt ou tard le mécontentement des travailleurs russes s’exprimera sous la forme d’importantes manifestations et grèves.
Poutine s’est cru assez sûr de lui pour lancer une offensive militaire en Syrie, qui a surpris les Occidentaux. Résultat, l’homme qui était censé être un paria international est devenu l’arbitre de facto du destin de la Syrie.
Il n’y a pas si longtemps, Obama et Kerry soufflaient le chaud et le froid contre l’homme fort du Kremlin. Et soudain, Poutine est reçu à l’ONU et devient le centre de toutes les attentions. Il apparaît même en public aux côtés du président américain, et leur poignée de main est fortement médiatisée, bien qu’elle ne soit pas très chaleureuse.
L’objectif principal de Poutine, en Syrie, était de maintenir Assad au pouvoir, comme allié fiable de la Russie, et d’arrêter l’avancée des rebelles islamistes qui s’approchaient de plus en plus des zones de l’ouest, soutenant Assad, et où se trouvent des bases russes. Au moins, on peut dire que les intentions de Poutine étaient claires, sans ambigüités. Aussi fait-il figure d’homme fort.
Obama, au contraire, fait face à un Congrès fortement divisé et à une opposition républicaine enragée. Il est bien conscient du danger qu’il y a à s’impliquer dans une guerre terrestre en Irak. Le peuple américain est las des aventures militaires. C’est aussi cela, et non des considérations pacifistes ou humanitaires, qui explique pourquoi Obama se donne beaucoup de mal pour éviter d’engager des troupes américaines en Syrie.
Il n’est pas difficile de comprendre la raison des contradictions de la politique américaine en Syrie. Les seules actions militaires sérieuses entreprises contre les djihadistes en Syrie sont celles qui ont été conduites par les Russes, en collaboration avec l’armée de Bachar Al-Assad. Et les seules actions militaires sérieuses menées contre l’EI en Irak (excepté celles des Kurdes, qui combattent dans leurs propres zones) sont menées, non pas par la pseudo armée irakienne et ses soutiens américains, mais par les milices chiites appuyées par l’Iran et des éléments de l’armée iranienne.
En pratique, les Américains ont été obligés de le reconnaître et d’accepter ce que demandent la Russie et de l’Iran, à savoir que Bachar Al-Assad conserve le pouvoir dans l’immédiat. C’est pourquoi Obama devait arriver à un accord avec l’Iran sur le nucléaire, que n’acceptent pas l’Arabie Saoudite ou Israël, ni leurs alliés Républicains au Congrès américain. En bref, Obama a dû faire face à tous les problèmes simultanément. Cela lui donne une apparence de faiblesse. Le leader russe s’en retourna à Moscou avec la conviction que sur la Syrie, les Américains feraient la même chose qu’en Ukraine, c’est-à-dire rien. Et sur ce point, il n’avait pas tort.
Les Russes doublèrent leurs livraisons d’armes et d’équipements à Damas. Ils ont lancé des séries de bombardements contre l’EI et d’autres cibles. Les raids russes ont effectivement changé la donne sur le champ de bataille. Ils ont obligé les Américains et leurs alliés occidentaux à intensifier leur campagne de bombardements, qui jusqu’alors avait été peu enthousiaste, et visait plus à contenir l’EI qu’à réellement le vaincre. Ainsi, à chaque pas, les Russes ont pris de vitesse la diplomatie américaine. À propos de la Syrie, Washington a dû ravaler sa fierté et accepter les termes de Moscou. Cela a profondément modifié le rapport de forces – non seulement en Syrie, mais dans tout le Moyen-Orient.
Le Moyen-Orient
« C’est pire qu’un crime, c’est une faute ». Ces mots célèbres attribués à Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, duc d’Enghien, pourraient servir d’épitaphe à la politique étrangère de l’impérialisme américain, ces dernières décennies.
Les flammes qui engloutissent l’ensemble du Moyen-Orient sont la conséquence directe de l’invasion criminelle de l’Irak et de l’interférence continuelle des États-Unis dans cette région éprouvée. Après avoir réduit l’Irak à l’état de ruine fumante et déchirée par la guerre, les Américains et leurs alliés ont assisté et soutenu les forces réactionnaires syriennes qui menacent désormais sérieusement leurs intérêts. Et la prétendue « guerre contre le terrorisme » engagée il y a quinze ans, en Irak, n’a précisément abouti à rien.
Les politiciens de Washington n’ont rien compris et rien prévu. Ironiquement, en détruisant l’appareil d’État de Saddam Hussein et l’armée irakienne, ils ont bouleversé l’équilibre des forces dans la région et créé un vide dans lequel s’est engouffré leur vieil ennemi : l’Iran. Quand l’armée américaine a attaqué l’Irak, Al-Qaïda n’était pas présente sur le territoire. À présent, toute la région est en proie à la folie djihadiste. C’est le résultat direct de l’ingérence de l’impérialisme américain.
Les Américains se sont tardivement rendu compte de la situation désastreuse qu’ils avaient créée et qui les menace. Désormais les États-Unis font face à une violence djihadiste croissante, qui se répand telle une épidémie incontrôlable à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, traversant le désert du Sahara pour éclater à travers tout le Nigéria et s’étendre au Niger, au Tchad et au Cameroun.
Quelle réponse la plus grande puissance militaire mondiale peut-elle apporter à cette menace ? Elle a été obligée de se contenter de bombardements aériens. Mais il est bien connu que des bombardements ne peuvent pas – à eux seuls – gagner les guerres, et encore moins des guerres comme celles d’Irak ou de Syrie. Les Américains et leurs alliés ont bombardé les positions de l’État islamique pendant plus d’un an. Mais les effets semblent en avoir été minimes.
Il est vrai que l’État islamique, avec ses châtiments cruels et inhumains, ses crucifixions, décapitations et lapidations, son oppression des femmes et ses attaques contre la culture et l’éducation, représente une aberration réactionnaire, un retour vers un passé sombre et primitif. Mais tout ceci n’est que le miroir des crimes de l’impérialisme, des bombardements aveugles, de la torture et des sévices des prisonniers d’Abu Ghraib ou de Guantanamo. Les interventions de l’impérialisme au Moyen-Orient, depuis 2001, ont fauché entre 1,3 et 2 millions de vies. Elles ont conduit au déplacement de plusieurs millions de personnes, qui à présent survivent dans des conditions inhumaines. Tout ceci est classé dans la rubrique « dommages collatéraux ».
Les impérialistes ont besoin d’une justification à leur agression criminelle du Moyen-Orient. Celle-ci leur est providentiellement livrée, sur un plateau, par les actions meurtrières des djihadistes. La machine de propagande impérialiste a assidument construit l’image d’une organisation islamiste toute-puissante. Mais les événements montreront que l’EI n’est pas toute-puissante. Depuis l’intervention des Russes, l’EI et les autres groupes djihadistes ont été rapidement jetés sur la défensive.
L’intervention russe a tout changé. Elle a forcé les Américains à intensifier leur activité. Mais pour vaincre l’EI, ils ont besoin de troupes au sol. Seulement, les troupes en question ne peuvent pas être américaines. Un petit nombre de Forces Spéciales Américaines ont été impliquées au sol – à une échelle qui reste encore floue.
Malheureusement pour Obama, la défaite de l’EI nécessite non des petites forces, mais des forces substantielles. Comment résoudre ce problème ? Certains optimistes incurables ont placé leurs espoirs dans l’armée irakienne. C’est la plus vaine des vaines illusions. Quand ils ont détruit l’armée irakienne, en 2003, les Américains ont éliminé la seule force militaire de la région capable d’agir comme un contre-pouvoir face à l’Iran. À présent, les restes pathétiques de l’armée irakienne sont démoralisés et ne sont aptes à la lutte ni contre l’EI, ni contre personne d’autre. Le manque total d’aptitude au combat de l’armée irakienne a été révélé l’été dernier, lorsque les soldats irakiens ont détalé comme des lapins, abandonnant Mossoul à la merci des hordes de djihadistes de l’EI.
En même temps, « l’opposition modérée » interne à la Syrie s’est révélée être une fiction totale. À quelques exceptions près, presque tous les groupes qui combattent Assad sont des fanatiques islamistes d’un genre ou d’un autre. Ils sont plus enclins à combattre le gouvernement d’Assad que l’EI. Le rôle principal de ces « modérés » est d’agir comme des têtes de pont dans l’acheminement d’armes envoyées par les Américains aux groupes djihadistes. Les Américains ont annoncé la création d’une force de combat de 5000 « modérés », mais admettent à présent qu’il n’en reste qu’une poignée sur le terrain (leur localisation et ce qu’ils font sont un mystère). Les autres ont été tués par des groupes appartenant à Al-Qaïda, qui reçoivent les informations sur leur localisation de la part de la Turquie – pourtant alliée des États-Unis – ou ont eux-mêmes rallié Al-Qaïda, avec leurs armes.
Finalement, les États-Unis ont été contraints d’abandonner tous leurs plans en Syrie. Leur soutien aux rebelles « modérés » a été significativement réduit. Dans le même temps, ils ont été obligés de soutenir les Kurdes de l’YPG, autour duquel ils ont mis en place les « Forces Démocratiques Syriennes » (FDS), et le « Congrès Démocratique Syrien ».
L’YPG s’est révélé extrêmement efficace en Syrie, principalement du fait que c’est une milice populaire, basée sur un programme démocratique et non sectaire. Avec 50 à 70 000 engagés, ses forces ne sont surpassées que par celles d’Assad, qui restent cependant inférieures en termes d’entrainement, de moral et de motivation. Avec la création du « Congrès Démocratique Syrien » s’est créé un mini-État kurde, de facto.
L’YPG est sans aucun doute le mouvement le plus progressiste du Moyen-Orient, à ce jour. Cependant, il est utilisé par les États-Unis à des fins largement réactionnaires. L’impérialisme américain vise la partition de la Syrie en plusieurs petits États dirigés par des milices ou des chefs de guerre locaux, qu’ils pourront manipuler les uns contre les autres pour maintenir leur propre contrôle. Pour les impérialistes, le mot d’ordre d’autodétermination des petites Nations est toujours une tromperie réactionnaire et un piège. Pour le moment, les Américains sont obligés de se servir des Kurdes pour combattre l’EI à leur place. Cependant, à un certain stade, les impérialistes vont inévitablement tenter d’utiliser cette tactique de division et de contrôle sur les Kurdes eux-mêmes. En même temps qu’ils soutiennent les aspects progressistes du mouvement kurde et qu’ils défendent le droit des Kurdes à l’autodétermination, les marxistes doivent alerter sur les risques de voir la cause kurde se mélanger aux intrigues de l’impérialisme américain. Il faut critiquer les incohérences et la courte vue du leadership kurde.
Le revirement politique des Américains à l’égard des Kurdes a aggravé les tensions entre Washington et son allié turc, dont les forces armées (liées à Al-Qaïda) en Syrie ne sont plus soutenues par les États-Unis. La Turquie considère comme une menace l’YPG et son organisation sœur, le PKK. Le gouvernement turc est en complet décalage avec la nouvelle ligne des États-Unis. Ceci a mené à la situation ironique d’une guerre de faible intensité entre, d’une part, les Forces Démocratiques Syriennes soutenues par les États-Unis, et d’autre part les forces djihadistes soutenues par l’Arabie Saoudite et la Turquie. Ceci pourrait exploser en une guerre à grande échelle à tout moment.
À côté du soutien aux Kurdes, les États-Unis ont réalisé qu’ils avaient besoin des forces iraniennes et du régime d’Assad pour stabiliser la Syrie et empêcher qu’elle ne soit dirigée par des groupes fondamentalistes. Tout le monde sait que le plus gros des combats en Irak – si l’on excepte les Kurdes – a été mené par les milices chiites et la Garde Révolutionnaire soutenues par l’Iran, et que l’armée irakienne est entraînée et commandée par des officiers iraniens. La tentative de construire une force combattante basée sur des « islamistes modérés » est également vouée à l’échec. Les différentes factions sont bien plus résolues à combattre le gouvernement Assad ou à se battre entre elles que contre l’État islamique. Les accrochages se multiplient entre les groupes affiliés à Al-Qaïda et les groupes appartenant aux nouvelles Forces Démocratiques Syriennes (un groupe soutenu par les États-Unis et composé de Kurdes du YPG et des éléments douteux, bien que non djihadistes, de l’Armée Syrienne Libre, ASL).
Par conséquent, toute exigence d’un changement de régime en Syrie a été bien commodément oubliée. Les Américains ont dû renoncer à leur attitude belliqueuse envers Téhéran et trouver un compromis fragile sur son programme nucléaire, tout en promettant de réduire les sanctions. Ce fut sans aucun doute une marche arrière humiliante pour Washington et un triomphe diplomatique majeur pour Téhéran. L’Iran détient à présent le contrôle effectif des zones sud, est et centrales de l’Irak (les Kurdes et l’État islamique contrôlant le nord et l’ouest) et a une influence majeure en Syrie, ainsi qu’au Liban, point d‘ancrage de la puissante organisation pro-iranienne, le Hezbollah.
En serrant les dents, Washington a été obligé de se tourner vers la seule option valable : un accord avec l’Iran – et la Russie. Mais n’est-ce pas le même Iran que celui diabolisé dans la presse, il y a peu, comme faisant partie de « l’Axe du Mal » ? Il n’y a pas si longtemps, les dénonciations de John Kerry contre Téhéran étaient apocalyptiques. Soudainement, tout n’est que clarté et tendresse dans les relations entre Washington et Téhéran. M. Kerry fait des discours conciliants ; un sourire lui fend le visage jusqu’aux oreilles pendant qu’il chante des hymnes aux dirigeants iraniens, qu’il loue leur grande sagesse et leur modération.
On peut observer la même situation dans les relations entre les États-Unis et la Russie, et même davantage. Il y a peu, Vladimir Poutine était considéré hors des limites de la civilisation ; c’était un homme à éviter et à boycotter. À présent, il est le héros du jour en Syrie. Ces évolutions soulèvent de nombreuses inquiétudes à Riyad et Ankara. Les impérialistes américains tentent de jouer sur deux tableaux à la fois ; ils font face à de nouvelles et insolubles contradictions. Ces contorsions diplomatiques sont une indication supplémentaire du chaos que les Américains s’infligent à eux-mêmes au Moyen-Orient. Le gouvernement de Bagdad est fortement dépendant de l’Iran. La peur de l’Arabie Saoudite et des autres pays de la région est que l’Irak ne devienne rien moins qu’une satrapie iranienne. Ce résultat est tout l’inverse de ce que souhaite Washington, mais il est la conséquence logique des actions de Washington.
Leur attitude envers la Syrie est encore plus contradictoire. Publiquement, ils continuent de dénoncer Assad et se plaignent de « l’interférence » de la Russie en Syrie, alors qu’en réalité il existe de facto une « détente » entre les États-Unis et la Russie. Les Américains se plaignent que les Russes ne leur donnent pas assez d’information sur leurs cibles en Syrie, qu’il leur est impossible de coordonner leurs raids, qu’il y a des risques d’accident, etc. Ils déplorent haut et fort que les Russes bombardent non seulement les positions de l’EI, mais également les forces de « l’opposition modérée » soutenues par l’Occident, qui attaquent l’armée syrienne dans l’ouest. Mais les Russes n’en ont cure et continuent de détruire leurs cibles impitoyablement.
L’Arabie Saoudite et le Yémen
Il existe une vieille maxime, en diplomatie, qui dit que les Nations n’ont pas d’amis, seulement des intérêts. Au Moyen-Orient, les États-Unis tentent de trouver un équilibre entre les quatre pouvoirs régionaux : l’Iran, l’Arabie Saoudite, Israël et la Turquie. Washington s’appuie sur l’un, puis sur l’autre, en une perpétuelle oscillation. En Irak, les soldats américains mènent des bombardements aériens en parallèle avec les forces iraniennes au sol, alors qu’au Yémen, ils soutiennent les attaques saoudiennes contre les Houthis, eux-mêmes soutenus par l’Iran. Les États-Unis disent qu’ils fournissent des armes à l’Arabie Saoudite. Mais dans le même temps, l’administration Obama signale sans cesse à Téhéran qu’elle ne souhaite pas de conflit avec l’Iran à propos du Yémen.
La clique dirigeante saoudienne est au centre de la contre-révolution dans toute la région. Pendant des décennies, les dirigeants occidentaux ont constamment soutenu la monarchie réactionnaire saoudienne, acceptant servilement ses plus viles actions et caressant dans le sens du poil les abjectes créatures qui font la loi à Riyad, comme on a pu le voir lors des funérailles du non regretté roi Abdullah.
Ces musulmans si pleins de ferveur, « protecteurs des Lieux Saints », et jusqu’alors parmi les plus fidèles alliés des États-Unis, ont décapité l’an dernier plus de 50 personnes, sans parler d’autres plaisantes pratiques telles la flagellation ou la crucifixion. Mais le pourrissant régime saoudien repose sur des fondations branlantes. La population chiite opprimée y est en proie à une agitation croissante, tout comme de larges pans de la jeunesse. Ceci pourrait mener à un soulèvement, à un certain stade. Il existe également une impatience grandissante parmi les fanatiques wahhabites, qui sympathisent davantage avec l’EI et Al-Qaïda qu’avec la famille royale, qu’ils considèrent comme illégitime. Ces contradictions internes minent le régime, qui s’accroche désespérément au pouvoir.
Tous ces facteurs sont déterminants dans la réaction saoudienne à la crise yéménite. La volte-face de la diplomatie américaine dans ses relations avec l’Iran a compliqué la donne pour Washington. Elle a enragé les Saoudiens et les Israéliens, qui considèrent l’Iran comme leur principal ennemi. L’Iran a de bonnes relations avec les milices chiites Houthies, qui ont avancé au Yémen sur un programme populiste. Ils ont pris le contrôle d’Aden, y renversant la marionnette de l’Arabie Saoudite. En réponse à ces événements, l’Arabie Saoudite a ordonné à son aviation de bombarder les rebelles.
Les Saoudiens ont hâtivement composé une coalition de dix États, dont la raison d’être est d’écraser l’insurrection yéménite dans le sang. Les États-Unis et le Royaume-Uni se sont joints à reculons à la coalition, évitant une participation directe dans les bombardements. Les forces de la coalition ont bombardé brutalement le pays, pulvérisant ses infrastructures, détruisant des écoles et des hôpitaux, et tuant un grand nombre de civils. Vingt millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. Malgré les bombardements meurtriers, les Houthis n’ont pas été vaincus, et la population a développé une haine contre les Saoudiens et leurs alliés. Le fait que l’armée pakistanaise ait refusé la demande de l’Arabie Saoudite de participer à la campagne militaire est la preuve qu’une offensive au sol au Yémen ne pourrait que finir en désastre.
La clique au pouvoir joue avec le feu. Le vieux roi Abdullah était un monarque très prudent, qui avait tendance à éviter tout engagement direct dans des aventures périlleuses qui pourraient remettre en cause la stabilité du pays. Mais ses successeurs sont des arrivistes dégénérés, ignorants, stupides et imbus d’eux-mêmes. Aveuglés par leur sentiment d’invulnérabilité, ils ont lancé une guerre ingagnable. En intervenant militairement au Yémen, l’Arabie Saoudite risque de déstabiliser son propre régime, voire d’y provoquer une insurrection.
L’Arabie Saoudite avive délibérément le sectarisme religieux contre les Houthis. Cette stratégie a causé le renforcement d’Al-Qaïda dans de grandes parties du pays. L’exécution de Nimr-al-Nimr [dissident politique saoudien chiite NDT] était un meurtre judiciaire ordonné par la clique royale saoudienne. C’était une provocation délibérée, destinée à provoquer un conflit sectaire entre les chiites et les sunnites, et à pousser le gouvernement de Téhéran à des mesures militaires contre l’Arabie Saoudite, qui aurait alors appelé les Américains à l’aide.
Cela a immédiatement mené au saccage de l’ambassade saoudienne à Téhéran et à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Tout ceci était minutieusement prémédité. Les événements se succédèrent, pas à pas, comme ceux d’un danseur de ballet. Mais ce ballet est une danse de la mort. C’était l’acte désespéré d’un gouvernement qui se trouve dans de graves difficultés et fait face à la perspective d’un renversement.
Les gangsters saoudiens ont fait un mauvais calcul au Yémen. Ils ont délibérément provoqué la colère des chiites, qui constituent au moins 20 % de la population saoudienne, et font partie des couches les plus pauvres et les plus opprimées. Des manifestations massives ont éclaté dans les villes saoudiennes, aux cris de « Mort à la maison Saud ». La clique saoudienne a surestimé ses forces. Elle a semé le vent et récoltera la tempête.
La Turquie
Avec l’Arabie Saoudite et Israël, la Turquie constitue l’une des principales forces contre-révolutionnaires de la région. Bien que la Turquie soit membre de l’OTAN, le régime réactionnaire d’Erdogan soutient l’EI et d’autres forces islamistes de Syrie.
Les ambitions régionales d’Erdogan sont bien connues : rétablir un ensemble similaire à l’ancien Empire ottoman, en ramenant dans le giron turc de vastes régions d’Asie centrale et du Moyen-Orient. Pour réaliser cette ambition, Erdogan tente d’instrumentaliser les populations de langue turque, comme les Turkmènes, pour servir ses propres intérêts, tout comme le tsarisme russe, par le passé, avait transformé les Slaves du Sud en simples pions de sa politique étrangère expansionniste.
De la même manière, il est de notoriété publique qu’Erdogan a soutenu l’EI et d’autres groupes islamistes pour tenter de renverser le président Al Assad et mettre la main sur des morceaux de territoire syrien. C’est la raison pour laquelle il a permis à un grand nombre de combattants islamistes de traverser la Turquie pour rejoindre la Syrie. Il a également bloqué l’acheminement d’armes et de volontaires à destination des forces syriennes anti-EI – et mené la guerre aux Kurdes qui combattent l’EI.
La destruction délibérée d’un avion russe par l’armée turque était une provocation destinée à faire éclater un conflit entre les États-Unis et la Russie. La Turquie est membre de l’OTAN et a appelé ses alliés à l’aide. Néanmoins, tout en affirmant publiquement son attachement au droit de la Turquie à « défendre sa souveraineté nationale », l’OTAN n’a rien fait, alors que Poutine a utilisé cet incident pour installer en Syrie un système de défense antimissile russe S-400, prenant ainsi le contrôle de l’espace aérien syrien.
La provocation d’Erdogan n’a servi à rien. Elle n’a pas empêché le président Hollande de se rendre à Moscou ni d’appeler à une coalition internationale élargie pour lutter contre l’EI. En réalité, le régime d’Erdogan n’est pas stable. Le soulèvement de masse qui s’est propagé à travers la Turquie, en 2013, est un avertissement préfigurant ce qui attend le pays.
Israël
La question palestinienne n’est toujours pas résolue et continue d’empoisonner la vie politique du Moyen-Orient. Les tentatives d’Abbas et de l’autorité palestinienne d’isoler Israël au sein des Nations Unies et d’autres sommets internationaux sont vaines.
L’administration du président Obama et le gouvernement d’Israël sont désormais publiquement hostiles l’un à l’autre, et ce depuis que Netanyahu a accepté une invitation des Républicains à s’adresser au Congrès américain, l’année dernière.
Suite à l’élection de Netanyahu, la Maison-Blanche s’est abstenue des traditionnels messages de félicitations. Pas de coup de fil de la part d’Obama ; juste un bref coup de fil du secrétaire d’État John Kerry. Ce petit incident, en lui-même sans importance, témoigne de la montée des contradictions entre les États-Unis et Israël.
Pour tenter de mettre Washington sous pression, Netanyahu a eu recours au plus grossier chantage : les services secrets israéliens ont obtenu des détails secrets sur les négociations en cours autour du programme nucléaire iranien, grâce à des briefings « confidentiels » de représentants américains, à un réseau d’informateurs, à des contacts diplomatiques en Europe et à des écoutes illicites. Ces informations sensibles ont ensuite été transmises aux membres du Congrès.
Par ces moyens, Netanyahu essayait de saboter l’accord avec l’Iran. Selon les propos d’un haut fonctionnaire américain, rapportés par le Wall Street Journal : « l’espionnage entre États-Unis et Israël est une chose ; mais c’en est une autre qu’Israël vole des secrets américains et les retransmette aux législateurs américains pour ruiner la diplomatie du pays ».
La froideur des relations s’est encore accrue lorsque Netanyahu a explicitement écarté la « solution des deux États » (Israël et Palestine), pierre angulaire des « efforts de paix » américains. La Maison-Blanche a alors officiellement menacé de « réviser » ses rapports avec Netanyahu.
Israël contrôle toujours d’une main de fer la Bande de Gaza, qui est lentement étranglée. Les colonies juives dans les territoires occupés ne cessent de s’étendre. La direction du mouvement palestinien est totalement impuissante, poussant les jeunes à des actions désespérées qui feront le jeu de Netanyahu. C’est un autre revers pour Obama et l’impérialisme américain, qui a échoué dans ses tentatives de trouver un compromis.
L’ascension de la Chine
À l’Est, les États-Unis font face à un autre défi : l’ascension de la Chine. Après la crise de 2008, la Chine a sauvé l’économie mondiale en absorbant une grande quantité de capital excédentaire (c’est-à-dire de surproduction). Mais la Chine joue maintenant un rôle opposé : comme puissance économique montante et avide de matières premières pour nourrir son industrie, elle a pénétré en Afrique et en Amérique du Sud, principalement pour en extraire des matières premières. Mais elle est maintenant confrontée à une crise de surproduction.
Comme l’Allemagne d’avant 1914, les forces productives amassées en Chine ne peuvent être contenues à l’intérieur de ses frontières. Ceci entraîne des conflits avec les États voisins et les grandes puissances impérialistes. Les grands programmes chinois de stimulation économiques n’ont eu aucun effet durable. La Chine est obligée de recourir au dumping pour vendre de grandes quantités de marchandises à bas prix sur le marché mondial. Son rôle dans l’économie mondiale s’est donc totalement inversé.
Tout comme l’Allemagne par le passé, la Chine aspire à un pouvoir et une influence sur les affaires mondiales qui soient à la hauteur de sa puissance économique. Elle veut une redistribution des sphères d’influence. Ces ambitions sont de plus en plus perçues comme une menace par les puissances en place, en particulier pour les États-Unis et le Japon. Publiquement, les États-Unis affirment accueillir positivement l’accession de la Chine au statut de grande puissance, tant que les Chinois respectent les normes internationales et jouent leur rôle dans le « système multilatéral ». Mais dans la pratique, les États-Unis cherchent à contenir chaque mouvement de la Chine sur la scène internationale.
Les États-Unis ont systématiquement bloqué les tentatives de la Chine d’accroitre son assise dans des institutions financières internationales comme le FMI. Même la modeste proposition d’augmenter les ressources du FMI (qui aurait donné plus de votes à la Chine) est restée lettre morte pendant des années, au Congrès américain. Les États-Unis ont également contrecarré les efforts de la Chine pour avoir un plus grand poids dans la Banque Mondiale. Pour contrer cette influence grandissante, les États-Unis ont manigancé, avec onze autres pays du Pacifique, la mise en place du partenariat transatlantique, qui exclue la Chine, alors qu’elle est l’économie la plus importante de la région. Mais au grand dam de l’Amérique, la Chine continue d’étendre son influence.
On le voit sur la question de la Banque asiatique d’investissement (AIIB). Comme à son habitude, l’Amérique a adopté une politique d’endiguement, qui a échoué dans la pratique. La Chine contrôle désormais la plus grande réserve de change au monde, avec laquelle elle souhaite lancer une nouvelle banque pour permettre la construction de ponts, de routes et d’autres infrastructures nécessaires au développement de l’Asie.
La classe dirigeante chinoise lutte pour aligner sa puissance militaire et son influence politique sur sa force économique. Ses tendances expansionnistes la font rentrer en conflit avec l’impérialisme américain dans le Pacifique, qui est destiné à devenir le théâtre décisif de l’histoire mondiale. Redoutant avec raison que cette nouvelle banque soit un vecteur de l’influence chinoise dans une région vitale pour ses propres intérêts, les États-Unis tentent de saboter le plan. Derrière le rideau, les Américains font pression sur leurs alliés pour qu’ils ne rejoignent pas l’initiative.
Lorsque la Grande-Bretagne est devenue le premier pays hors Asie à demander l’adhésion, un responsable américain s’est plaint des tendances du Royaume-Uni à « tout accorder » à la Chine. Mais ceci n’a pas empêché Cameron d’inviter le président Xi Jinping à une visite d’État à Londres, avec tapis rouge et dîner au Buckingham Palace en compagnie de la reine. Les puissances européennes se démènent pour courtiser Pékin. Suivant l’exemple britannique, l’Allemagne, la France et l’Italie ont annoncé leur volonté d’appartenir aux membres fondateurs de la banque.
Une ligne ferroviaire à grande vitesse sera terminée en 2016 entre Shanghai et Kunming, soutenant ainsi la croissance chinoise en Asie du Sud-Est. La banque asiatique d’investissement lancée en 2015 donne une chance à la Chine d’utiliser ses immenses réserves pour doper ses ambitions politiques.
Au cours des deux dernières années, la Chine s’est lancée dans un grand mouvement de construction d’îles artificielles au sud de la mer de Chine. En réponse, les États-Unis ont envoyé un destroyer à proximité de l’une de ces îles artificielles lors d’une opération « pour la liberté de navigation ». Le chef de la marine chinoise n’a certainement pas été le seul à considérer cette manœuvre comme une « menace voilée »… À ceci près qu’elle n’était pas vraiment voilée.
L’amiral Wu Shengli a déclaré que ses troupes avaient fait preuve d’une « retenue considérable » en réponse aux « provocations » américaines dans le sud de la mer de Chine. Par le passé, ces tensions auraient mené à une guerre, mais les rapports de force ont totalement changé. La Chine n’est plus la nation pauvre, opprimée, encore à moitié coloniale, qui pouvait être envahie par le Japon, l’Angleterre ou les États-Unis. Ces derniers ne sont même pas capables d’engager une action militaire contre la Corée du Nord qui les provoque constamment ; ils oseraient encore moins défier la puissance militaire de la Chine moderne. Bien que les États-Unis comptent sur la majorité des pays de la région comme « alliés » contre la Chine (notamment le Vietnam), l’essor chinois va remettre de plus en plus en question cet équilibre. Chaque absence d’intervention de la part des États-Unis, comme en Ukraine et en Syrie, est enregistrée non seulement à Pékin, mais à Hanoi, Taipeh et Séoul. La Chine est le plus grand partenaire commercial de ces pays et son rôle va croissant. Ces contradictions causeront une instabilité politique dans les pays du Pacifique occidental, objet des rivalités entre Chinois et Américains.
La nouvelle stratégie de la « Route de la Soie », dont le coût s’élève à un milliard de dollars et implique en particulier le Pakistan, l’Afghanistan et l’Asie centrale, résulte en partie de considérations stratégiques (éviter le détroit de Malacca), mais également d’un besoin d’exportation de la surproduction. 70 % des prêts aux pays participant à cette stratégie de la Route de la Soie sont accordés en échange de l’implication d’entreprises chinoises. Mais ceci provoque également des conflits avec et au sein de ces pays.
Le couloir économique Chine-Pakistan, un projet titanesque qui vise à connecter le port de Gwadar (au sud du Pakistan) à la région autonome chinoise du Xinjiang, est un prolongement de l’initiative chinoise de la Route de la Soie version XXIe siècle. Le Pakistan est censé en retirer des avantages en termes de transport, d’infrastructures, de télécommunications et d’énergie. En réalité, il s’agit de transformer le Pakistan en un satellite chinois.
La Chine profitera de l’ouverture de routes commerciales pour sa partie occidentale, ainsi que d’un nouvel accès direct aux régions du Moyen-Orient riches en ressources, via la mer d’Oman, ce qui lui permettra de contourner des routes plus longues qui passent actuellement par le détroit de Malacca. Ceci implique la construction d’autoroutes, de voies de chemin de fer, de gazoducs et d’oléoducs pour relier la Chine au Moyen-Orient. Une présence à Gwadar permettra également à la Chine d’étendre son influence à l’océan Indien, une route essentielle pour l’acheminement du pétrole entre l’Atlantique et le Pacifique.
L’État chinois conçoit ces plans au service des intérêts géopolitiques et stratégiques de l’élite chinoise ; l’impérialisme américain ainsi qu’une importante section des nationalistes baloutches s’y opposent. Ces projets n’apportent aucun bénéfice aux habitants de Gwadar qui vivent et travaillent dans des conditions infâmes. Ils se voient au contraire priver de leurs droits dans cette région. Un ressentiment existe également chez les Sindhis et d’autres nationalités qui n’ont pas été incluses dans les plans du « couloir ». La politique expansionniste chinoise sert donc à aggraver les contradictions entre le Pakistan et le reste de la région.
Le Pakistan, l’Afghanistan, l’Inde
Plus d’un cinquième de l’espèce humaine vit sur le sous-continent sud-asiatique, qui possède des ressources naturelles assez abondantes pour créer un paradis sur terre. Et pourtant, après sept décennies d’indépendance, ces terres historiques sont un océan de pauvreté, de misère, d’analphabétisme et d’oppression, ravagées par des guerres et une terrible violence ethnique et communautaire. Les capitalistes d’Inde et du Pakistan se sont montrés totalement incapables d’accomplir la moindre des tâches de la révolution démocratique bourgeoise. Ils sont aujourd’hui davantage soumis à l’impérialisme qu’ils ne l’étaient avant l’indépendance. Le Pakistan a échoué à éradiquer le féodalisme ; l’Inde n’a pas aboli son système de castes cruel et réactionnaire.
Au Pakistan, les masses ne sont pas mieux loties qu’en Inde. Dans ces pays, l’exploitation est terriblement aggravée par le cancer de la corruption et le pillage de l’État par des politiciens, des hommes d’affaires et des généraux vénaux. Dans ces deux pays, des sommes considérables sont gaspillées en dépenses militaires aux dépens de l’éducation et de la santé.
La stratégie contre-révolutionnaire de la clique dirigeante pakistanaise a conduit à un cauchemar en Afghanistan et au Pakistan même. La classe dirigeante et l’armée sont fortement impliquées dans les trafics de drogue et d’autres activités criminelles.
Ceci est la véritable base sur laquelle prospèrent les talibans et autres monstres fondamentalistes. Les conflits entre les groupes fondamentalistes rivaux et l’État sont au fond une bataille pour les énormes enveloppes de billets produites par le trafic de drogue. À l’origine, ceci avait été créé et soutenu par les services de renseignement pakistanais (ISI), avec l’entière approbation de l’impérialisme américain, pour financer la contre-révolution en Afghanistan. Le résultat est absolument catastrophique.
Les bigots enragés des talibans et d’autres groupes islamistes fondamentalistes sont maintenant hors de contrôle. Pour preuve : le massacre de l’école militaire de Peshawar en décembre 2014, au cours duquel les talibans pakistanais ont tué au moins 132 enfants et neuf membres du personnel. Les enfants étaient tous enfants d’officiers de l’armée pakistanaise. L’armée a donc été contrainte d’intensifier ses attaques sur les talibans, qui étaient auparavant leurs agents et marionnettes.
Les impérialistes et leurs agents régionaux sont responsables de la destruction d’une des cultures les plus riches d’Asie. Ils ont engendré des Frankenstein, des chiens enragés qui n’hésitent pas à mordre la main de leur maître. En Afghanistan, après quinze ans d’occupation impérialiste, les gens ordinaires n’ont pas vu la moindre amélioration de leur situation. L’oppression des femmes se poursuit sans relâche. Les indices des droits de l’homme, tant loués par les commentateurs occidentaux, n’ont fait qu’empirer.
Le gouvernement de Kaboul est désespérément divisé et en crise. Son impuissance a été mise en lumière par une série d’attaques sanglantes menées par les talibans dans des zones prétendument sûres. En conséquence, les impérialistes sont obligés de maintenir une présence militaire à laquelle ils prévoyaient de mettre un terme. Le gouvernement de Kaboul est assis sur les baïonnettes américaines : sans elles, il serait immédiatement renversé.
Jusqu’à récemment, il semblait y avoir une source de lumière au milieu de l’obscurité du sous-continent : la bourgeoisie indienne se gargarisait d’une croissance de l’économie et évoquait le « tigre asiatique ». Mais ceci était lié à une période d’expansion de l’économie mondiale et les bénéfices de cette croissance filaient droit dans les poches d’une minorité privilégiée. Les conditions de vie de l’écrasante majorité ne se sont pas améliorées. Aujourd’hui, l’économie indienne est en train de sentir le vent froid d’une crise mondiale. La roupie a chuté. L’Inde a noué son destin à celui du marché capitaliste mondial : elle ne peut pas éviter les effets d’une crise globale du capitalisme.
Malgré son triomphalisme démagogique, le gouvernement de Narendra Modi vit une période de troubles graves. Son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), a perdu une élection clé dans l’État du Bihar. Grâce à la chute du prix du pétrole, l’inflation globale a pu être contrôlée depuis que Modi est devenu Premier ministre. Mais la hausse des prix de certains produits alimentaires a entraîné une inflation des prix de détail au cours des derniers mois. Au beau milieu de la campagne, les prix du arhar dal – lentilles rouges qui sont une partie essentielle de l’alimentation – ont explosé, ce qui en a fait un sujet de premier plan.
La véritable nature de la situation a été mise en lumière lors de la grève générale lancée par les dix plus grandes centrales syndicales en septembre 2015, et qui a paralysé l’Inde. Les dirigeants syndicaux et communistes avaient prévu un maximum de 100 millions de grévistes, chiffre qui révèle à lui seul l’énorme puissance entre les mains du prolétariat indien. Mais en réalité, 150 millions de travailleurs ont participé à une journée complète de grève générale, la plus grande de l’histoire.
Seuls le prolétariat et son allié naturel, la paysannerie pauvre, peuvent trouver une issue au cauchemar dans lequel le capitalisme et l’impérialisme ont plongé ces terres anciennes et potentiellement prospères.
L’Afrique du Sud
L’Afrique du Sud est la clé de voute du continent africain. Elle en est l’économie la plus développée et possède la classe ouvrière la plus nombreuse, ainsi qu’une solide tradition révolutionnaire. Ce sont les masses révolutionnaires et non les talents de négociateur des dirigeants de l’ANC qui ont mené au renversement du régime d’apartheid en 1992. Malgré tout et après vingt-quatre ans de démocratie bourgeoise formelle, sous la direction de l’ANC, la situation n’a pas beaucoup changé pour la plupart des habitants du deuxième producteur minier au monde.
Cela a posé les bases d’une radicalisation croissante, particulièrement parmi la jeune génération qui ne se fait pas d’illusion sur les vieux dirigeants du mouvement de libération, dont beaucoup sont devenus des bourgeois. Le massacre de Marikana, lors duquel des travailleurs noirs ont été abattus de sang-froid par les forces du gouvernement de l’ANC pour défendre les propriétaires (blancs et noirs) de l’industrie minière, a eu un profond impact sur l’attitude de beaucoup de gens à l’égard du parti dirigeant. L’ANC est vu aujourd’hui par une grande partie de la population comme un vivier de corruption, de vols et de détournements.
Le syndical radical des métallurgistes, la NUMSA – qui compte près de 400 000 membres – a rompu l’alliance tripartite. Les dirigeants de la NUMSA parlent de créer un nouveau parti, qui pourrait devenir une sérieuse menace pour l’ANC, s’il était créé. Mais les dirigeants de la NUMSA traînent les pieds sur cette question, et passent leur temps en luttes bureaucratiques et en procès stériles contre l’aile droite de l’ANC.
L’ancien dirigeant de la Ligue des Jeunes de l’ANC, Julius Malema, et ses Economic Freedom Fighters (EFF) se sont engouffrés dans ce vide. Leur rhétorique radicale les a rendus très populaires, en particulier parmi la jeunesse. Tout ceci reflète l’énorme potentiel révolutionnaire qui se développe dans la société sud-africaine.
La révolution touche aussi le reste de l’Afrique subsaharienne, comme l’ont montré les événements de l’année dernière au Togo, au Burundi et surtout au Burkina Faso. Des mouvements révolutionnaires ont éclaté dans ces pays. Au Burkina Faso, nous avons assisté encore une fois à la mise en échec d’un coup d’État militaire par un mouvement de masse. Cela souligne les conditions extrêmement favorables pour l’éclatement d’une révolution dans ces pays relativement sous-développés.
Le Venezuela et les limites du réformisme
La situation en Amérique latine a été transformée. Une décennie de relative stabilité sur la base d’une croissance économique est arrivée à son terme, avec des conséquences sociales et politiques profondes.
La situation au Brésil a dramatiquement changé avec le début du déclin de son économie et une chute de 4,5 % de son PIB l’an dernier. Cela, combiné à de nombreuses mesures anti-ouvrières et impopulaires mises en place par le gouvernement, a démontré de façon claire que la direction du PT défend les intérêts du capitalisme, et non des travailleurs. Cela a énormément affaibli le PT. Les jours où le parti s’appuyait sur la loyauté des masses sont finis, remplacés par une vague de radicalisation, particulièrement parmi les jeunes, qui s’est exprimée par une série de grèves et de manifestations.
La victoire de Mauricio Macri aux élections présidentielles argentines sonne la fin de douze années de populisme kirchneriste, au terme desquelles l’économie est en crise, les réserves de change sont en baisse, l’inflation a atteint les 25 % et le déficit budgétaire pèse plus de 6 % du PIB. Cela a posé les bases d’une victoire de la droite. Mais même si le candidat Kirchneriste Daniel Scioli avait gagné, il aurait dû recourir aux mêmes politiques que Macri. La crise du capitalisme ne lui laissait que peu de choix.
Cela montre les limites du soi-disant « populisme », qui essaie de résoudre les contradictions du capitalisme sans recourir à l’expropriation de la bourgeoisie ou de l’impérialisme. C’est comme rechercher la quadrature du cercle. Dépouillé de son vocabulaire radical et « révolutionnaire », le populisme apparaît comme à peine plus qu’une variante du réformisme de gauche adapté aux traditions et à la psychologie latino-américaines. En dernière analyse, le populisme se résume, même dans son sens étymologique, à de la démagogie.
Au Venezuela, Chavez est celui qui s’est le plus approché d’un ralliement à la révolution socialiste. Mais il ne l’a jamais menée à son terme. Après sa mort, toutes les contradictions sont remontées à la surface, entraînant des conséquences désastreuses.
Nicolas Maduro ne possède ni le charisme ni l’audace de son illustre prédécesseur. Il fait penser à Robespierre, qui pouvait appeler les masses à sauver la révolution encore et encore – jusqu’au jour où elles n’ont pas répondu à l’appel. En s’orientant vers la droite, Robespierre sciait la branche sur laquelle il était assis. En décevant et démoralisant sa base de masse, la direction bolivarienne a préparé le terrain de sa propre destruction.
La défaite électorale au Venezuela, le 6 décembre 2015, a été la conséquence directe du refus de mener la révolution à son terme en expropriant la classe dirigeante et en détruisant l’État capitaliste. La tentative de réguler le capitalisme par le contrôle des prix et du commerce extérieur a mené à de grands déséquilibres économiques. La direction bolivarienne avait utilisé les revenus du pétrole pour financer les programmes sociaux et un programme massif de travaux publics. Mais la chute des prix du pétrole sur le marché mondial l’a privée de toute marge de manœuvre.
Les déformations générées par la tentative de régulation du capitalisme ont débouché sur une situation chaotique : un cercle vicieux d’hyperinflation, de trafics, de marché noir, de corruption et de criminalité. Le gouvernement Maduro, se maintenant fermement dans les limites du capitalisme, a été incapable de résoudre ces problèmes. Une partie importante des masses a perdu confiance dans le gouvernement et cela a mené à la défaite électorale. Entre l’élection présidentielle de 2013 et l’élection parlementaire de 2015, le PSUV et ses alliés sont passés de 7 587 532 voix à 5 599 025. En d’autres termes, les bolivariens ont perdu près de deux millions de voix. L’opposition contre-révolutionnaire, de son côté, est passée de 7 363 264 voix à 7 707 422, n’en gagnant que 344 000.
Ce qui a échoué n’est pas le socialisme ou la révolution, mais, au contraire, le réformisme et les demi-mesures, la corruption et la bureaucratie. L’opposition contre-révolutionnaire, s’appuyant sur une majorité des deux tiers au Parlement, va lancer une offensive pour revenir sur la plupart des lois progressistes de la révolution, pour reprendre le contrôle des leviers principaux de l’appareil d’État, pour privatiser les compagnies et les terres nationalisées, pour supprimer le contrôle des prix et du commerce extérieur, et pour convoquer un référendum révocatoire du président.
Ces événements ont montré toute la vacuité du « socialisme pétrolier », comme la capitulation de Tsipras en Grèce a montré les limites et les contradictions du réformisme de gauche. En pratique, ils se résument aux mêmes éléments : une tentative utopiste de mettre en place des politiques socialistes sans rompre avec le capitalisme. De telles politiques ne servent au final qu’à démoraliser les masses, détruire leur foi dans le socialisme et préparer la voie à une victoire de la réaction sous une forme ou une autre.
Marx expliquait que la révolution peut parfois avancer sous le fouet de la contre-révolution. Après une période inévitable de désorientation, les masses révolutionnaires tenteront de résister aux attaques de la contre-révolution. Elles se mobiliseront. La défaite électorale va aussi accélérer le processus de polarisation interne du camp bolivarien. La direction sera soumise à une intense pression pour aboutir à un compromis avec l’opposition. Les éléments les plus corrompus et dégénérés déserteront pour rallier la droite. Mais les militants révolutionnaires de la base arriveront à des conclusions plus avancées et seront plus ouverts aux idées marxistes. Cela créera de nouvelles conditions, favorables au renforcement de la tendance marxiste dans le mouvement bolivarien.
La tactique et les organisations de masse
Les perspectives sont une science, mais la tactique est un art. Pour élaborer une tactique correcte, on ne peut pas se baser sur des schémas et des perspectives généraux, à long terme. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les perspectives sont conditionnelles. Il s’agit d’une hypothèse de travail. Elles ne sont pas gravées dans le marbre telles les Tables de la loi, valables en tout temps et en toutes circonstances. Les perspectives doivent être constamment actualisées, comparées à la réalité. Sur la base des événements, nous devons modifier et adapter les perspectives – et même, si nécessaire, les jeter à la poubelle et en élaborer d’autres.
La tactique, quant à elle, doit se fonder sur les circonstances concrètes, qui sont en perpétuelle évolution. Quand on parle de tactique, il faut avoir à l’esprit qu’on ne cherche pas la formule unique qui s’appliquerait à n’importe quel scénario possible. Il est nécessaire d’avoir une approche souple, de garder un œil sur la situation et ses évolutions – et, en même temps, de développer nos forces pour être capables d’intervenir quand s’ouvrent de nouvelles opportunités.
Dans l’élaboration de notre tactique, nous devons être extrêmement attentifs aux processus en cours dans les organisations de masse. Elles sont transformées au cours du temps, à l’image des flux et reflux du mouvement ouvrier. Lors de longues périodes de paix relative entre les classes, le mouvement ouvrier subit la pression des classes moyennes et dirigeantes. Une importante couche bureaucratique se forme alors au sommet des partis et des syndicats de masse.
Sans la participation active des travailleurs, la vie interne des organisations stagne. Leurs couches supérieures deviennent de plus en plus sensibles à l’influence de la bourgeoisie. Au cours des décennies qui ont précédé la crise, les partis soi-disant socialistes et sociaux-démocrates ont mené des contre-réformes : dérégulation, privatisations, coupes budgétaires, etc. Lorsque la crise a éclaté, en 2008, la bourgeoisie a dans de nombreux cas confié le pouvoir à des réformistes chargés de faire à sa place le sale boulot pour sauver le capitalisme. Ils ont lancé des attaques violentes contre les droits des travailleurs (Espagne, Grèce, etc.). Dans ces conditions, de vieux partis bien établis peuvent perdre leur base de masse très rapidement. L’équilibre antérieur a été rompu. Nous sommes entrés dans une période caractérisée par des changements brusques et soudains, des crises, des scissions, la disparition de certains partis et l’émergence de nouvelles formations politiques.
La décomposition et la déliquescence du PASOK ont mené à l’ascension de Syriza en Grèce. De façon similaire, les trahisons du PSOE et la dégénérescence réformiste du Parti Communiste espagnol ont mené à l’essor rapide de Podemos en Espagne. Ce genre de phénomène avait déjà été anticipé au Venezuela par l’arrivée au pouvoir de Chavez et l’expansion du mouvement bolivarien.
Dans les pays où ce genre de mouvements émergent, il nous faut garder un œil sur leur évolution et y travailler, à l’intérieur comme dans la périphérie. Mais ces formations ont également leurs limites. Elles tendent à être idéologiquement confuses et fragiles sur le plan organisationnel. Si elles ne s’enracinent pas solidement dans la classe ouvrière et n’adoptent pas une ligne clairement anticapitaliste, elles peuvent se déliter aussi vite qu’elles ont surgi.
Dernièrement, la tendance dominante au sein du mouvement ouvrier était celle du réformisme de droite. Mais avec la crise du capitalisme, les organisations réformistes vont entrer en crise. Ceci peut mener à leur virage vers le « réformisme de gauche », comme nous le voyons en Grande-Bretagne, ou bien à leur effondrement lorsqu’aucune aile gauche ne se développe.
Là où les partis de masse traditionnels se sont soit effondrés, soit fortement affaiblis, de nouvelles formations sont apparues. L’idée essentielle que nous devons garder en tête, c’est que les masses ne se mobilisent pas à travers de petits groupes. Certains sectaires pensent qu’il suffit de proclamer le nouveau parti révolutionnaire pour le créer, ce qui est absurde et en complète contradiction avec les faits. Là où les anciennes organisations ont trahi, les travailleurs sont susceptibles de se regrouper dans de nouvelles formations, mais toujours de masse. Ces organisations vont tendre vers le réformisme de gauche, voire même – sous la pression des événements – vers le centrisme.
Nous ne devons jamais oublier que la différence entre réformisme de droite et réformisme de gauche est toute relative. L’essence du réformisme – qu’il soit de droite ou de gauche – est l’idée qu’il n’est pas nécessaire de renverser le système capitaliste, qu’il est possible d’améliorer progressivement la condition des travailleurs et des opprimés dans le cadre du capitalisme. Mais l’expérience de la Grèce, du Venezuela et d’autres pays où cela fut tenté montre bien que c’est impossible. Soit vous prenez les mesures qui s’imposent pour détruire la dictature du Capital, soit le Capital vous détruira.
C’est en substance ce que signifie notre formule : « la trahison est inhérente au réformisme ». Il ne s’agit pas ici de trahison délibérée. Simplement, si l’on accepte le système capitaliste, alors il faut en accepter les lois. Actuellement, accepter ce système, cela signifie accepter de mener des politiques d’austérité et de coupes budgétaires : l’expérience de Tsipras est à cet égard fort instructive.
Tout en apportant un soutien critique aux réformistes de gauche, nous ne devons entretenir aucune illusion ni prendre la moindre responsabilité dans leurs actions. Souvenons-nous que Tsipras bénéficiait d’une forte popularité jusqu’à ce que sa politique soit mise à l’épreuve. Il a fini par céder à la pression de la bourgeoisie. Désormais, ceux qui avaient des illusions sur Tsipras – et nous trouvaient trop critiques – sont plus ouverts à nos idées.
Nous devons nous différencier. Il nous faut évidemment éviter le ton dénonciateur des sectes. Il faut adopter un ton fraternel, entrer en dialogue, souligner ce qu’on soutient, tout en expliquant la nécessité d’aller plus loin, jusqu’au renversement du capitalisme. Nous posons la question : comment paieront-ils les réformes qu’ils proposent s’ils ne nationalisent pas les banques et l’industrie ?
La longue dérive droitière des organisations de masse a mené de nombreux groupes de gauche à tirer des conclusions ultragauchistes. Ils tirent un trait sur toutes les organisations de masse. Ils se sont convaincus qu’il est possible de construire une alternative à la gauche des organisations traditionnelles. Cependant, toutes les tentatives des gauchistes de créer de nouveaux partis révolutionnaires se sont soldées par un échec. Les groupes d’extrême gauche échouent, car ils ne comprennent pas le mouvement réel des masses et de leurs organisations. Mais l’ultra-gauchisme mène également à l’opportunisme : pour essayer de gagner l’oreille des masses et d’avoir une audience plus large, ils finissent par diluer leur programme.
Cet opportunisme, qui se cache en général derrière des appels à des « revendications transitoires », finit systématiquement dans une impasse. Si les masses veulent un programme réformiste, il existe déjà foule de dirigeants réformistes vers lesquels se tourner. Le programme de transition n’est pas une liste de réformes indépendantes les unes des autres, dans laquelle on pourrait piocher celles qui nous conviennent. C’est un programme complet et élaboré pour la révolution socialiste internationale, pour le pouvoir des travailleurs.
À ce stade, notre priorité est de nous orienter vers la couche de la société où nous pouvons construire nos forces aujourd’hui, pas à l’avenir. C’est généralement la jeunesse, qui est ouverte aux idées révolutionnaires. En gagnant la jeunesse à nos idées, en la formant au marxisme, nous jetons les bases d’un travail fructueux dans les organisations de masse, lorsque les conditions se présenteront.
Une nouvelle période
Le réformisme a pris naissance sur la base des deux décennies de croissance économique qui ont précédé la Première Guerre mondiale. S’est alors développée l’illusion que le capitalisme pourrait être réformé pacifiquement et progressivement, au moyen de l’activité parlementaire et syndicale. Ces illusions furent brisées en 1914. Une nouvelle époque s’ouvrait – une époque de guerre, de révolution et de contre-révolution.
La période qui va de 1914 à 1945 fut entièrement différente de tout ce qui l’avait précédée. Ce fut une période de turbulences au cours de laquelle tous les anciens équilibres furent rompus. À travers leur nouvelle expérience de luttes tumultueuses entre les classes, les travailleurs parvenaient à des conclusions révolutionnaires. La crise économique et sociale eut un impact énorme sur les vieilles organisations réformistes, qui furent secouées jusque dans leurs fondations. Les partis de la classe ouvrière étaient en crise. Sous l’influence de la Révolution russe, des « ailes gauches » massives se cristallisaient, aboutissant à la création de partis communistes de masse.
Ici, nous n’entrerons pas dans le détail de ces processus. Il suffit de signaler que la défaite des révolutions allemande, puis espagnole, conséquence des trahisons des directions sociales-démocrates et staliniennes, a mené directement à la Seconde Guerre mondiale. Et celle-ci s’est terminée d’une façon que Trotsky n’avait pas anticipée – pas plus d’ailleurs que Roosevelt, Staline, Churchill ou Hitler ne l’avaient anticipée.
Nous avons déjà discuté de ces questions, par le passé. Nous ne répéterons pas ici les raisons qui ont abouti à l’expansion du capitalisme dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale. L’économie mondiale entrait alors dans une phase de plusieurs décennies de croissance, qui laissèrent leur empreinte dans la conscience des masses des pays capitalistes avancés d’Europe, d’Amérique du Nord ou du Japon. Il y eut un renforcement des illusions réformistes, tout comme lors de la période précédant la Première Guerre mondiale. Pendant des décennies, les marxistes furent isolés des masses et durent lutter à contre-courant.
Nous nous référons ici à la situation qui prévalait dans le monde capitaliste industrialisé. Mais la situation était totalement différente pour les masses des pays qui étaient alors des colonies ou des semi-colonies – en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pendant toute cette période, une agitation constante secoua la Chine, l’Algérie, l’Indochine, la Bolivie, Cuba, le Chili, l’Argentine, l’Afrique subsaharienne, l’Indonésie et le sous-continent indien. Mais la révolution coloniale, qui a soulevé des millions de personnes, a été dévoyée par le stalinisme. Dans bien des cas, les staliniens ont conduit les masses à de terribles défaites. Et même là où elles réussirent à s’emparer du pouvoir, comme en Chine, cela déboucha sur des régimes calqués sur le modèle de la Russie stalinienne – régimes qui n’exerçaient aucun attrait sur la masse des travailleurs d’Europe ou des États-Unis.
Au cours de cette période, le rôle négatif du stalinisme a considérablement compliqué la situation. Concernant les États ouvriers dégénérés et bureaucratiques de Russie et d’Europe de l’Est, il suffit de souligner que les développements révolutionnaires en Allemagne de l’Est en 1953, en Hongrie en 1956, puis en Pologne et en Tchécoslovaquie, ont été soit détournés dans une voie nationaliste, soit brutalement écrasés par la bureaucratie soviétique. Désignant le stalinisme, les bourgeoisies d’Europe de l’ouest et d’Amérique dirent alors aux travailleurs : « Vous voulez le communisme ? En voilà ! » La plupart des travailleurs en conclurent : « Mieux vaut le diable connu qu’un diable inconnu ».
L’énorme potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière européenne fut révélé – à l’apogée de la croissance d’après-guerre – lors de la plus grande grève générale révolutionnaire de l’Histoire, en France, en mai 68. Dans les faits, le pouvoir était entre les mains des travailleurs français, mais ce mouvement formidable fut trahi par les directions staliniennes de la CGT et du PCF. Ces événements de mai 1968 étaient une préfiguration des développements encore plus formidables qui balayèrent l’Europe dans les années 1970, et qui coïncidèrent avec la première récession économique sérieuse depuis 1945. Des révolutions éclatèrent en Grèce, au Portugal et en Espagne. Des mouvements révolutionnaires agitèrent l’Italie et d’autres pays.
Comme dans les années 1930, des ailes gauches – voire des courants centristes – se formèrent alors dans les organisations de masse au Portugal, en Espagne, en Grèce, en Grande-Bretagne, en France et en Italie. Mais cette tendance fut brisée lorsque les directions firent avorter les mouvements révolutionnaires. Dès que les dirigeants réformistes s’approchent du pouvoir, ils abandonnent leur rhétorique de gauche et virent brusquement vers la droite. Ce fut la prémisse politique d’une reprise du capitalisme. Pendant trente ans, le pendule repartit vers la droite. Les travailleurs retombèrent dans un état d’apathie. Les éléments les plus avancés furent démoralisés et tombèrent dans le scepticisme. La période qui s’ouvrit fut caractérisée par une « réaction modérée ».
Dans ces conditions, les pressions de la bourgeoisie sur les sommets du mouvement ouvrier s’intensifièrent considérablement. Ce processus fut énormément exacerbé par l’effondrement du stalinisme. La bourgeoisie exultait, proclamait la fin du communisme, la fin du socialisme et même « la fin de l’Histoire ». Mais l’Histoire a fini par prendre sa revanche sur la bourgeoisie et ses apologues aux sommets du mouvement ouvrier. Dialectiquement, tout s’est transformé en son contraire.
Conclusion
La période nouvelle dans laquelle nous venons d’entrer ressemblera bien plus aux années tempétueuses de l’entre-deux-guerres qu’à ce dernier demi-siècle. Mais il y a aussi de profondes différences. Dans les années 1920 et 1930, une situation prérévolutionnaire ne durait pas longtemps, en général. La contradiction était rapidement résolue par un mouvement vers la révolution ou vers la contre-révolution. En Italie, deux années seulement ont séparé l’occupation des usines de 1919-20 de la Marche sur Rome de Mussolini.
À l’heure actuelle, cependant, ces processus durent bien plus longtemps. La principale raison en est le changement du rapport de force entre les classes. Dans la plupart des pays européens, la paysannerie constituait – même après 1945 – une partie importante de la population. En Grèce, elle en constituait la majorité. Il s’agissait d’un important réservoir de soutien potentiel à la réaction bonapartiste et fasciste. Il en allait de même pour les étudiants et les travailleurs en col blanc : enseignants, fonctionnaires, employés de banque, etc. Mais aujourd’hui, la paysannerie a largement disparu en Europe. Les travailleurs en col blanc ont été absorbés par la classe ouvrière et en sont devenus une section très militante. Les étudiants, qui avant 1945 fournissaient une solide base pour la réaction et le fascisme, sont massivement passés dans le camp de la révolution.
Pour ces raisons, les crises sociales peuvent durer bien plus longtemps que par le passé, avant que leur dénouement ne soit atteint. Cela ne signifie pas que les choses seront plus calmes, bien au contraire. Il y aura des flux et des reflux, aussi bien politiquement qu’économiquement (la phase descendante du capitalisme ne signifie pas la fin du cycle d’expansion et de récession du capitalisme, tout comme cela n’exclut pas la possibilité de phases de redressements temporaires, comme il y en eut même pendant la Grande Dépression des années trente).
Les inévitables hauts et bas du cycle économique ne résoudront rien du point de vue des capitalistes. Après une longue période de récession économique et de chômage élevé, même une timide reprise (le mieux qu’ils puissent espérer) mènera directement à une hausse des luttes sur le front industriel (syndical) – les travailleurs luttant alors pour reprendre ce qui leur a été pris pendant la récession. Cependant, pendant une récession, il peut y avoir une baisse des luttes syndicales, mais il y aura aussi une tendance à la radicalisation politique.
Il y a déjà un profond malaise à travers le monde entier. Avec un certain retard sur la réalité objective, les masses commencent à comprendre qu’il n’y aura pas de solution tant que le système actuel, injuste et oppressif, restera en place. Le processus révolutionnaire suit son cours, gagnant en étendue et en profondeur. Il y aura toute une série de vague de grèves et de manifestations. Elles seront comme un terrain d’entrainement pour les masses. De nouvelles couches de la population sont entrainées dans la lutte – comme les jeunes étudiants en médecine en Grande-Bretagne, les agriculteurs grecs ou le personnel navigant d’Air France. Mais la crise est si profonde que même les grèves et manifestations les plus puissantes ne pourront rien résoudre, en elles-mêmes.
Seul un changement fondamental de l’ordre social peut résoudre la crise. Cela nécessite une action politique radicale. La scène politique sera caractérisée par des oscillations violentes vers la gauche et la droite. Les partis existants connaitront des crises et des scissions. Toutes sortes de formations électorales de gauches et de droites peuvent se développer, dans ce contexte. La classe ouvrière se tournera du front politique au front industriel – et vice versa. Des attaques renouvelées et toujours plus sévères contre les travailleurs se préparent. La lutte des classes se développera dans les rues.
La crise actuelle peut durer des années – voire des décennies – en raison de l’absence du facteur subjectif : un parti révolutionnaire de masse doté d’une direction authentiquement marxiste. Mais les évènements ne suivront pas pour autant une route droite et tranquille. Des explosions succèderont les unes aux autres. Des changements profonds et soudains sont inévitables. Il y aura toute une série de mouvements et de luttes massives dans un pays après l’autre. Les vieilles organisations seront ébranlées jusque dans leurs fondations. Rappelons que Podemos est passé de rien à 376 000 membres en l’espace de 18 mois.
Dans un pays après l’autre, les masses diront : « trop, c’est trop ! » Mais sans un programme et une politique révolutionnaires, clairement marxistes, sans les idées du marxisme, nous n’aurions aucune raison d’exister en tant que tendance séparée, indépendante des réformistes de gauche. La condition prioritaire de notre succès est de maintenir notre identité révolutionnaire et de préserver le tranchant et la clarté de nos idées. Toute tentative de gagner en popularité, à court terme, en se coulant dans le courant réformiste de gauche aboutirait à un désastre.
La route d’une grande victoire est pavée d’innombrables petits succès. Notre tâche est toujours de gagner les militants un par un, de leur fournir une formation marxiste solide, de tisser des liens étroits avec les couches les plus avancées des travailleurs et de la jeunesse – et, à travers eux, de tisser des liens avec les masses. Sur la base des évènements, les masses apprendront. Des idées qui n’atteignent aujourd’hui qu’une poignée de personnes seront recherchées avidement par des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Cela préparera la voie à une importante organisation de cadres marxistes, qui elle-même constituera la base d’un courant marxiste de masse capable de lutter pour gagner la direction de la classe ouvrière.
Aujourd’hui, nous sommes une petite minorité. C’est principalement le résultat de facteurs historiques objectifs. Pendant toute une période historique, les forces du marxisme authentique ont été faibles et isolées. Nous nagions à contre-courant. Mais à présent, le courant de l’Histoire a changé de direction. Nous commençons à nager dans le sens du courant. Notre tâche est de rétablir les traditions du bolchévisme à l’échelle mondiale – et de construire une Internationale ouvrière puissante capable de transformer le monde. Tel est l’objectif que nous nous sommes fixé, le seul objectif qui mérite qu’on se batte et qu’on se sacrifie pour l’atteindre : l’objectif suprême de l’émancipation de la classe ouvrière.
Turin, le 26 février 2016