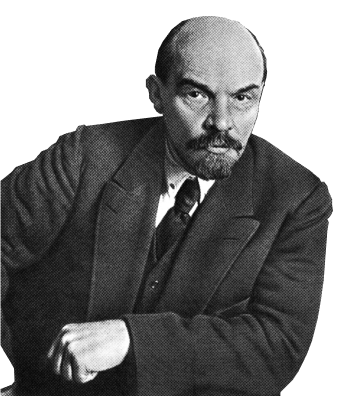Ce texte a été rédigé par les marxistes britanniques Rob Sewell et Alan Woods au début des années 1970. En le traduisant, nous avons conservé les références à l’économie anglaise, comme, par exemple, les noms des entreprises capitalistes britanniques. Seule exception : dans les exemples faisant intervenir des valeurs monétaires, nous avons remplacé la livre sterling par le dollar, de façon à ce que la démonstration soit la plus claire possible.
Introduction
En conséquence de la crise du capitalisme, de nombreux travailleurs s’intéressent à l’économie. Ils veulent comprendre les forces qui gouvernent leur existence. L’objectif de ce texte est de leur offrir, non pas un exposé complet de la théorie économique, mais une introduction aux lois élémentaires du fonctionnement du système capitaliste.
La superficialité des économistes pro-capitalistes est révélée par leur inaptitude à comprendre la crise qui afflige leur système. Leur rôle est de dissimuler l’exploitation de la classe ouvrière et de « prouver » la supériorité du système capitaliste. Mais leurs « théories » et « solutions » ne peuvent rien face au pourrissement du capitalisme. Seule la transformation socialiste de la société et l’introduction d’une économie planifiée permettront d’en finir avec l’enfer du chômage, des récessions et du chaos.
L’aile droite de la direction du mouvement ouvrier a remplacé Keynes, son vieil idole, par des solutions économiques « orthodoxes » : coupes budgétaires, restriction des salaires et déflation monétaire. De leur côté, les réformistes de gauche s’accrochent toujours aux politiques capitalistes du passé – relance par la consommation, restriction des importations[1], etc. – qui ont déjà montré leur complète inefficacité.
Seule une analyse marxiste du capitalisme permettra aux travailleurs conscients de réfuter les mensonges des économistes bourgeois et de combattre leur influence au sein du mouvement ouvrier.
Les conditions nécessaires à l’existence du capitalisme
La production moderne est concentrée entre les mains d’entreprises gigantesques. Unilever, ICI, Ford, British Petroleum : ces grandes firmes dominent nos vies. Il est vrai qu’il existe de petites entreprises, mais elles représentent le mode de production du passé, non celui du présent. La production moderne en général est massive, de grande échelle.
Aujourd’hui, en Grande-Bretagne, 200 entreprises et 35 banques (ou compagnies financières) contrôlent l’économie du pays, réalisant 85% de la production nationale. Ce développement s’est accompli au cours de ces derniers siècles au travers d’une compétition impitoyable, de crises et de guerres. À l’époque où les économistes classiques prédisaient l’essor du « libre commerce », Marx expliquait comment la concurrence déboucherait sur le monopole, les entreprises les plus faibles étant éliminées.
De prime abord, il pourrait sembler que la production de biens est avant tout destinée à satisfaire les besoins de la population. C’est évidemment une nécessité à laquelle doit répondre toute forme de société, quelle qu’elle soit. Mais sous le capitalisme, les biens ne sont pas simplement produits pour satisfaire des besoins : ils le sont avant tout pour être vendus. C’est là la fonction essentielle de l’industrie capitaliste. Comme le disait Lord Stokes, ancien président de British Leyland : « Je fais de l’argent, pas des voitures. » C’est là une expression parfaite des aspirations de l’ensemble de la classe capitaliste.
Le mode de production capitaliste suppose qu’un certain nombre de conditions soient rassemblées. Tout d’abord, il faut qu’existe une large classe de travailleurs sans propriété[2], qui par conséquent sont obligés de vendre leur force de travail pour vivre. Ceci signifie que, sous le capitalisme, la conception libérale d’une « démocratie de propriétaires » est une absurdité, car si la masse de la population possédait suffisamment de propriété pour subvenir à ses propres besoins, les capitalistes ne trouveraient pas de travailleurs pour générer leurs profits.
Deuxièmement, les moyens de production doivent être concentrés entre les mains des capitalistes. Au cours de plusieurs siècles, les petits paysans et tous ceux qui possédaient leurs propres moyens de subsistance ont été impitoyablement éliminés. Les capitalistes et les grands propriétaires terriens ont fait main basse sur leurs moyens de subsistance, et ont embauché des travailleurs pour y travailler et créer de la survaleur.
La valeur et les marchandises
Comment le capitalisme fonctionne-t-il?
De quelle façon les travailleurs sont-ils exploités?
D’où vient le profit? Pourquoi y a-t-il des crises?
Pour répondre à ces questions, il faut d’abord en poser une autre, dont la réponse est clé pour la compréhension des premières : « Qu’est-ce que la valeur? » Une fois ce mystère élucidé, tout le reste en découle. Comprendre ce qu’est la valeur est essentiel pour comprendre l’économie capitaliste.
Pour commencer, toutes les entreprises capitalistes produisent des biens ou des services – ou plus exactement des marchandises, c’est-à-dire des biens ou des services qui ne sont produits que pour être vendus. Bien sûr, on peut produire quelque chose pour son propre usage personnel. Avant l’avènement du capitalisme, c’est ce que faisaient beaucoup de gens. Mais ces produits n’étaient pas des marchandises. Le capitalisme se caractérise en premier lieu, selon l’expression de Marx, par une « immense accumulation de marchandises ». C’est pour cette raison que Marx a commencé ses recherches sur le capitalisme par une analyse des caractéristiques de la marchandise.
Toute marchandise a une valeur d’usage : elle est utile au moins à certaines personnes (sans quoi elle ne pourrait être vendue). La valeur d’usage d’une marchandise se limite à ses propriétés physiques.
Mais en plus de cette valeur d’usage, toute marchandise a également une valeur.
Qu’est-ce que cette valeur et comment la détermine-t-on?
Si, pour le moment, on fait abstraction de la question de l’argent, on constate que les marchandises s’échangent suivant certaines proportions. Par exemple :
1 paire de chaussures = 10 mètres de tissu
ou 1 une montre
ou 3 bouteilles de Whisky
ou 1 un pneu de voiture
Chacun des biens de la colonne de gauche peut être échangé contre 10 mètres de tissu. Suivant les mêmes proportions, ils peuvent également s’échanger les uns contre les autres.
Ce simple exemple montre que la valeur d’échange de ces différentes marchandises exprime une équivalence de quelque chose qui est contenu en elles. Mais qu’est-ce qui fait qu’une paire de chaussures = 10 mètres de tissu? Ou qu’une montre = 3 bouteilles de Whisky – et ainsi de suite?
Il est clair qu’il doit y avoir quelque chose de commun à ces différentes marchandises.
Ce n’est évidemment pas leur poids, leur couleur ou leur consistance. Et encore une fois, cela n’a rien à voir avec leur utilité. Après tout, une miche de pain (une nécessité) a beaucoup moins de valeur qu’une Rolls Royce (qui est un produit de luxe). Dès lors, quelle est la qualité qui leur est commune?
La seule chose qu’elles ont en commun, c’est le fait d’être des produits du travail humain .
La quantité de travail humain cristallisé en une marchandise s’exprime en temps : semaines, jours, heures, minutes. Autrement dit, toutes les marchandises citées dans notre exemple peuvent être exprimées en terme de ce qu’elles ont en commun : le temps de travail. Soit :
5 heures (de travail) de chaussures = 5 heures (de travail) de tissu
ou 5 heures (de travail) de montre
ou 5 heures (de travail) de Whisky
ou 5 heures (de travail) de voiture
Le travail
Si on considère les marchandises en tant que valeurs d’usage (en tant qu’elles sont utiles), on les voit comme les produits d’un type de travail particulier – le travail du cordonnier, de l’horloger, etc. Mais dans l’échange, les marchandises sont considérées différemment. Leur caractère spécifique est mis de côté et elles apparaissent comme autant d’unités de travail en général, ou encore de « travail moyen ».
Il est vrai que les marchandises produites par une quantité donnée de travail qualifié sont de plus grandes valeurs que celles produites par une même quantité de travail non qualifié. Par conséquent, dans l’échange, les unités de travail qualifié se réduisent à tant d’unités de travail non qualifié. Par exemple, on pourrait avoir le ratio : 1 unité de travail qualifié = 3 unités de travail non qualifié. Autrement dit, suivant cet exemple, le travail qualifié vaudrait trois fois plus que le travail non qualifié.
Ainsi, la valeur d’une marchandise est déterminée par la quantité de « travail moyen » nécessaire à sa production (soit le temps de travail qu’il faut pour la produire). Mais si on en reste là, il pourrait sembler que les travailleurs les plus lents produisent plus de valeur que les travailleurs les plus efficaces!
Prenons l’exemple d’un cordonnier qui, pour produire ses chaussures, utilise les méthodes obsolètes du Moyen Âge. Ce faisant, il lui faut toute une journée pour fabriquer une paire de chaussures. Et lorsqu’il essaye de les vendre sur le marché, il s’aperçoit qu’il ne peut pas en tirer plus, en termes de prix, que des chaussures semblables produites par des usines modernes et mieux équipées.
Si de telles usines modernes produisent une paire de chaussure en, disons, une demi-heure, elles contiendront moins de travail (donc moins de valeur) et seront vendues à moindre prix. Dès lors, celui qui fabrique des chaussures semblables avec des méthodes médiévales sera bientôt ruiné. Après une demi-heure, le travail qu’il réalise pour produire ses chaussures est du travail perdu, du travail non nécessaire dans le cadre des conditions de production modernes. S’il veut échapper à la faillite, il sera forcé d’adopter les techniques modernes et de produire des chaussures en un temps au moins égal à celui développé par la société.
À chaque époque donnée, à laquelle correspond un « travail moyen » déterminé par un certain niveau de la technique, des méthodes de production, etc., toutes les marchandises exigent pour leur production un temps donné. Ce temps est déterminé par le niveau de la technique productive de la société à ce moment précis. Comme le disait Marx, toutes les marchandises doivent être produites dans un temps de travail socialement nécessaire. Tout temps de travail qui s’étend au-delà de ce temps de travail socialement nécessaire sera du travail inutile, ce qui provoque la hausse des prix et rend le produit concerné non compétitif.
En somme, pour être précis, la valeur d’une marchandise est déterminée par la quantité de travail socialement nécessaire qui y est incorporée. Naturellement, ce temps de travail change continuellement, au fur et à mesure que de nouvelles méthodes et techniques de travail sont introduites. La concurrence ruine les producteurs dont la technique n’évolue pas suffisamment vite.
Ainsi, nous pouvons comprendre pourquoi les pierres précieuses ont davantage de valeur que les marchandises du quotidien. Il faut davantage de temps de travail socialement nécessaire pour trouver et extraire la pierre que pour la confection des marchandises ordinaires. Sa valeur en est d’autant plus grande.
Encore une fois, une chose peut être une valeur d’usage sans avoir la moindre valeur, c’est-à-dire une chose utile qui n’a demandé aucun temps de travail nécessaire à sa production : l’air, les rivières, les sols vierges, etc. Ainsi, le travail n’est pas la seule source de richesse (de valeurs d’usages) : la nature en est une autre.
D’après ce qui précède, on voit qu’une augmentation de la productivité, si elle augmente le nombre de choses produites (la richesse matérielle), peut réduire la valeur des choses en question – parce qu’elles contiendront moins de quantité de travail. Ainsi, d’une augmentation de la productivité résulte une augmentation de la richesse : avec deux manteaux, deux personnes peuvent se vêtir, et seulement une avec un manteau. Cependant, l’augmentation de la quantité de richesses matérielles peut s’accompagner d’une chute de sa valeur, parce qu’elle recèle moins de temps de travail socialement nécessaire.
L’argent
Historiquement, du fait des difficultés liées à l’échange par le troc, un type de marchandise donné était fréquemment utilisé comme « monnaie ». Au cours des siècles, l’une de ces marchandises – l’or – s’est imposée comme l’« équivalent universel ».
Au lieu de dire que telle marchandise vaut tant de beurre, de viande ou de tissu, elle est exprimée en termes d’or. Le prix est l’expression monétaire de la valeur. L’or fut adopté comme équivalent universel du fait de ses caractéristiques particulières. Il concentre une grande valeur dans peu de volume, peut être facilement divisé en quantités différentes, et est également très résistant.
Comme pour toute marchandise, la valeur de l’or est déterminée par la quantité de travail qui y est incorporée. Disons, par exemple, qu’il faille 40 heures de travail pour produire une once d’or. Dès lors, toutes les autres marchandises nécessitant le même temps de production vaudront une once d’or. Celles qui nécessiteront deux fois moins de temps vaudront deux fois moins, etc. Ainsi :
Une once d’or = 40 heures de travail
1/2 once d’or = 20 heures de travail
1/4 d’once d’or = 10 heures de travail
etc.
Et donc :
Une mobylette (40 heures de travail) = Une once d’or < Une table (10 heures de travail) = 1/4 d’once d’or
Du fait des modifications permanentes de la technique et de l’augmentation de la productivité du travail, les valeurs des marchandises ne cessent de fluctuer. En ce qui concerne l’échange entre marchandises, l’or joue le rôle de mesure. Ceci dit, bien qu’elle soit la plus stable, la valeur de l’or est elle aussi en mouvement permanent, étant donné qu’aucune marchandise n’a de valeur totalement fixe.
Le prix des marchandises
La loi de la valeur gouverne le prix des biens. Comme expliqué plus haut, la valeur d’une marchandise est égale à la quantité de travail qu’elle contient. Et en théorie, la valeur est égale au prix. Cependant, en réalité, le prix d’une marchandise tend à se situer au-dessus ou au-dessous de sa valeur réelle. Cette fluctuation est provoquée par différentes influences qui s’exercent sur les prix de vente, comme la concentration du capital et le développement des monopoles. Les fluctuations entre la demande et l’offre sont également un facteur important. S’il y a un surplus de telle marchandise sur le marché, son prix aura tendance à baisser en dessous de sa valeur réelle, alors qu’il s’élèvera au-dessus de cette valeur en cas de pénurie. Cela a mené les économistes bourgeois à considérer que le rapport entre l’offre et la demande était le seul facteur déterminant le prix d’une marchandise. Mais ils étaient incapables d’expliquer pourquoi le prix fluctuait toujours autour d’un certain point déterminé. Or, ce point n’est pas fixé par l’offre et la demande, mais par le temps de travail nécessaire à la production de la marchandise. Un camion vaudra toujours plus cher qu’un sac plastique.
Le profit
Certains « savants » défendent la théorie selon laquelle les profits viennent du fait de vendre plus cher qu’on n’achète. Dans Salaire, Prix et Profit, Marx explique le non-sens de cet argument :
« Ce qu’un homme gagnerait constamment comme vendeur, il lui faudrait le perdre constamment comme acheteur. Il ne servirait à rien de dire qu’il y a des gens qui sont acheteurs sans être vendeurs, ou consommateurs sans être producteurs. Ce que ces gens paient au producteur, il faudrait tout d’abord qu’ils l’aient reçu de lui pour rien. Si un homme commence par vous prendre votre argent et vous le rend ensuite en vous achetant vos marchandises, vous ne vous enrichirez jamais, même en les lui vendant trop cher. Cette sorte d’affaire peut bien limiter une perte, mais elle ne peut jamais contribuer à réaliser un profit. »
La force de travail
Lorsqu’il prend en considération les différents « facteurs de production » relatifs à la marche de son entreprise, le capitaliste considère le « marché du travail » comme une branche parmi d’autres du marché général. Les compétences et les capacités des travailleurs ne sont pour lui que des objets, des marchandises parmi d’autres. Ainsi, il embauche des « bras ».
Ici, il est nécessaire d’établir clairement ce que le capitaliste achète au travailleur. En fait, ce dernier ne vend pas son travail, mais sa capacité de travail – ce que Marx appelait sa force de travail .
La force de travail est une marchandise dont la valeur est soumise aux mêmes lois que celle des autres marchandises. Cette valeur est elle aussi déterminée par le temps de travail nécessaire à sa production. Or, la force de travail est la capacité à travailler du salarié. Elle est « consommée » par le capitaliste au cours de la journée de travail. Mais cela présuppose l’existence, la santé et la force du travailleur. Par conséquent, la production de la force de travail signifie « l’entretien » du travailleur – et sa reproduction, qui fournit ainsi au capitaliste une nouvelle génération de « bras ».
Ainsi, le temps de travail nécessaire à l’entretien du travailleur – de son aptitude à travailler – est égal au temps de travail nécessaire à la production de ses moyens de subsistance et ceux de sa famille : la nourriture, les vêtements, le logement, etc.
La quantité que cela représente varie selon les pays, les climats et les périodes historiques. Ce qui suffit à la subsistance d’un travailleur de Calcutta ne suffirait pas à celle d’un mineur gallois. Ce qui suffisait à la subsistance d’un mineur gallois il y a un demi-siècle ne suffirait pas à celle d’un métallurgiste de nos jours. À la différence des autres marchandises, il entre ici un élément historique et même moral. Ceci dit, dans un pays donné, à un stade donné de son développement historique, un « niveau de vie » général s’établit. Soit dit en passant, c’est précisément la création de nouveaux besoins qui est le moteur de toutes les formes de progrès humain.
Escroquerie?
À un certain stade du développement de la technique capitaliste, en plus de la reproduction quotidienne de la force de travail et de l’espèce des travailleurs, le capitaliste doit également fournir de quoi assurer aux salariés le niveau d’éducation requis par l’industrie moderne, ce qui permet de maintenir et d’augmenter leur productivité.
À la différence des autres marchandises, la force de travail n’est payée qu’après avoir été consommée. Ainsi, avant de toucher leur paie à la fin du mois, les travailleurs accordent pour ainsi dire un prêt gratuit aux employeurs!
Mais malgré cela, le travailleur n’est pas escroqué. Il a librement donné son assentiment à l’accord trouvé. Comme c’est le cas de toutes les marchandises, des valeurs équivalentes sont échangées : la marchandise du travailleur, sa force de travail, a été vendue au patron au « prix du marché ». Tout le monde est satisfait. Et si le travailleur ne l’est pas, il est libre de partir et de trouver ailleurs du travail – s’il le peut.
Ceci dit, la vente de la force de travail pose un problème. Si « personne n’est escroqué », si le travailleur reçoit, sous la forme du salaire, la pleine valeur de sa marchandise, en quoi consiste l’exploitation? D’où vient le profit que réalise le capitaliste?
L’explication réside dans le fait que le salarié a vendu non pas son travail (qui est réalisé dans le processus du travail), mais sa force de travail – sa capacité à travailler. Une fois que le capitaliste en a fait l’acquisition, il est libre d’en user comme il l’entend. Comme l’expliquait Marx :
« Le capitaliste paie, par exemple, la valeur journalière de la force de travail, dont, par conséquent, l’usage lui appartient durant la journée, tout comme celui d’un cheval qu’il a loué à la journée. L’usage de la marchandise appartient à l’acheteur et, en donnant son travail, le possesseur de la force de travail ne donne en réalité que la valeur d’usage qu’il a vendue. Dès son entrée dans l’atelier, l’utilité de [la] force [du travailleur], le travail, appartenait au capitaliste. […] À son point de vue, le processus de travail n’est que la consommation de la force de travail, de la marchandise qu’il a achetée. […] Le processus de cette opération lui appartient donc… » (Marx, Le Capital, éd. Gallimard, chap. VII, p. 284).
La survaleur
Comme nous allons le voir dans l’exemple suivant, la force de travail qu’achète le capitaliste est la seule marchandise qui, lors de sa consommation, produit un supplément de valeur au-delà de sa propre valeur.
Prenons, par exemple, un travailleur qui file du coton. Admettons qu’il soit payé 5 dollars de l’heure et qu’il travaille huit heures par jour. Au bout de quatre heures, il aura produit une quantité de fil d’une valeur de 100 dollars. Cette valeur de 100 dollars peut être divisée ainsi :
Matières premières :
50 dollars (coton, broche, électricité)
Détérioration :
10 dollars (usage et déchirures)
Nouvelle valeur : 40 dollars.
La nouvelle valeur qui aura été créée en quatre heures permettra de payer le salaire du travailleur pour les 8 heures de sa journée complète. À ce stade, le capitaliste aura donc couvert tous ses frais (y compris l’intégralité de la « charge salariale »). Mais après ces quatre premières heures, aucune survaleur (aucun profit) n’aura encore été créée.
Au cours des quatre heures suivantes, le salarié va à nouveau produire 50 kilos de fil, toujours d’une valeur de 100 dollars. Et à nouveau, 40 dollars de nouvelle valeur vont être créés. Mais cette fois-ci, les frais en salaire auront déjà été déjà couverts. Ainsi, cette nouvelle valeur (40 dollars) sera une « survaleur ». Comme le disait Marx, la survaleur (ou le profit) est le travail impayé de la classe ouvrière. De celle-ci proviennent la rente du propriétaire terrien, les intérêts du banquier et le profit de l’industriel.
La journée de travail
Le secret de la production de survaleur réside dans le fait que le travailleur continue de travailler longtemps après avoir produit la valeur nécessaire à la reproduction de sa force de travail (son salaire). « Si une demi-journée de travail suffit pour faire vivre l’ouvrier pendant 24 heures, il ne s’ensuit pas qu’il ne puisse travailler une journée tout entière. » (Marx, Le Capital, éd. Gallimard, chap. VII, pp. 292-293).
Le travailleur a vendu sa marchandise et ne peut se plaindre de la façon dont elle est utilisée, pas plus que le tailleur ne peut vendre une veste et demander à son client de ne pas la porter aussi souvent qu’il le souhaite. Par conséquent, la journée de travail est organisée par le capitaliste de façon à tirer le maximum de profit de la force de travail qu’il a achetée. C’est là que réside le secret de la transformation de l’argent en capital.
Le capital constant
Dans la production elle-même, les machines et les matières premières perdent leur valeur. Elles sont progressivement consommées et transfèrent leur valeur dans la nouvelle marchandise. C’est clair dans le cas des matières premières (bois, métal, pétrole, etc.), qui sont complètement consommées dans le processus de production, pour ne réapparaître que dans les propriétés de l’article produit.
Les machines, par contre, ne disparaissent pas de la même manière. Mais elles se détériorent au cours de la production. Elles meurent lentement. Il est aussi difficile de déterminer l’espérance de vie d’une machine que d’un individu. Mais de même que les compagnies d’assurance, grâce aux moyennes statistiques, font des calculs très précis (et profitables) sur l’espérance de vie des hommes et des femmes, de même les capitalistes peuvent déterminer, par l’expérience et le calcul, combien de temps une machine devrait être utilisable.
La détérioration des machines, la perte quotidienne de leur valeur, est calculée sur cette base et ajoutée au coût de l’article produit. Par conséquent, les moyens de production ajoutent à la marchandise leur propre valeur, au fur et à mesure qu’ils se détériorent au cours du processus productif. Ainsi, les moyens de production ne peuvent transférer à la marchandise davantage de valeur qu’ils n’en perdent eux-mêmes dans le processus de production. C’est pourquoi on les qualifie de « capital constant ».
Le capital variable
Alors que les moyens de production n’ajoutent aucune nouvelle valeur aux marchandises, mais ne font que se détériorer, la force de travail ajoute de la nouvelle valeur par l’acte du travail lui-même. Si le processus de travail s’arrêtait au moment où le salarié a produit des articles d’une valeur égale à celle de sa force de travail (au bout de quatre heures – 40 dollars – dans notre exemple), la valeur supplémentaire créée par son travail se réduirait à cela.
Mais le processus de travail ne s’arrête pas là. Sinon, le gain du capitaliste n’équivaudrait qu’au salaire qu’il doit verser au salarié. Or, les capitalistes n’embauchent pas des travailleurs par charité mais bien pour faire des profits. Après avoir « librement » accepté de travailler pour le capitaliste, le salarié doit travailler assez longtemps pour produire une valeur supérieure à celle qu’il percevra sous forme de salaire.
Les moyens de production (machines, équipements, bâtiments, etc.) et la force de travail – tous deux considérés comme des « facteurs de production » par les économistes bourgeois – représentent les différentes formes que prennent le capital original dans la deuxième étape du processus de production capitaliste : argent (achat) – marchandise (production) – argent (vente).
L’économie politique bourgeoise considère ces facteurs comme équivalents. Le marxisme, lui, fait la distinction entre la partie du capital qui n’est marquée par aucun changement de sa valeur lors du processus de production (les machines, les outils et les matières premières), à savoir le capital constant (C), et la partie, représentée par la force de travail, qui crée de la nouvelle valeur, appelée capital variable (V). La valeur totale d’une marchandise est composée du capital constant, du capital variable et de la survaleur, soit : C + V + Sv..
Travail nécessaire et surtravail
Le travail effectué par les salariés peut être divisé en deux parties :
1. Le travail nécessaire. C’est la partie du processus de production nécessaire à la couverture des frais en salaires.
2. Le surtravail (ou travail impayé). C’est le travail effectué en plus du travail nécessaire, et qui produit le profit.
Pour accroître ses profits, le capitaliste cherche toujours à réduire la part des frais salariaux. Pour cela, il s’efforce, premièrement, d’allonger la journée de travail ; deuxièmement, d’augmenter la productivité (ce qui permet de couvrir plus rapidement le coût des salaires). Troisièmement, il s’oppose à toute augmentation des salaires et, quand l’occasion se présente, n’hésite pas à les réduire.
Le taux de profit
Dans la mesure où tout le but de la production capitaliste est d’extraire de la survaleur du travail de la classe ouvrière, le rapport entre le capital variable (les salaires) et la survaleur (les profits) est d’une grande importance. L’accroissement de l’une ou de ces deux valeurs ne peut se faire qu’au détriment de l’autre. En dernière analyse, l’augmentation ou la réduction de la part de la survaleur constitue l’élément essentiel de la lutte des classes sous le capitalisme. C’est une lutte pour le partage, entre les salaires et le profit, des richesses créées.
Ce qui importe au capitaliste, ce n’est pas tant le montant de la survaleur que le taux de cette survaleur. Pour chaque dollar de capital qu’il investit, il attend le plus grand retour possible. Le taux de la survaleur est le taux d’exploitation du travail par le capital. On peut le définir comme S/V, où S est la survaleur et V le capital variable – c’est-à-dire par le rapport entre le surtravail et le travail nécessaire.
Par exemple, dans une petite entreprise, supposons qu’un capital global de 500 dollars se divise entre le capital constant (400 dollars) et le capital variable (100 dollars). Mettons qu’à travers le processus de production, la valeur des marchandises ait augmenté de 100 dollars.
Ainsi : (C+V) + S = (400 + 100) + 100 = 600 dollars.
C’est le capital variable qui est le travail vivant : c’est lui qui produit la nouvelle valeur (la survaleur). Ainsi, l’accroissement relatif de la valeur produite par le capital variable nous donne le taux de la survaleur : S/V = 100 dollars/100 dollars, soit un taux de survaleur de 100%.
La baisse tendancielle du taux de profit
Sous la pression de la concurrence nationale et internationale, les capitalistes sont constamment obligés de révolutionner les moyens de production et d’accroître la productivité. Le besoin d’élargir l’étendue de leurs opérations les oblige à consacrer une part toujours plus grande de leur capital dans les machines et les matières premières, et une part toujours plus petite dans la force de travail, ce qui diminue la proportion de capital variable par rapport au capital constant. Avec l’automatisation et la technologie industrielle viennent la concentration du capital, la liquidation des petites entreprises et la domination de l’économie par des groupes gigantesques. Cela représente une modification de la composition technique du capital.
Mais dans la mesure où c’est seulement le capital variable (la force de travail) qui est la source de la survaleur (du profit), l’augmentation de l’investissement dans du capital constant débouche sur une tendance à la baisse du taux de profit. Avec de nouveaux investissements, les profits peuvent croître énormément, mais cette croissance tend à être moins importante que celle des investissements.
Prenons par exemple un petit capitaliste disposant d’un capital global de 150 dollars qui se divise en 50 dollars de capital constant et 100 dollars de capital variable. Il emploie 10 hommes à fabriquer des chaises et des tables pour 10 dollars la journée. Après une journée de travail, ils ont produit une valeur totale de 250 dollars.
Ainsi :
Capital variable (salaires) ou V : 100 dollars
Capital constant (machines, équipement) ou C : 50 dollars
Survaleur (profit) ou S : 100 dollars
Le taux de survaleur peut ainsi être calculé : S/V = 100/100 = 100%. Le taux de profit, quant à lui, est le ratio entre la survaleur et le capital global. Dans notre exemple, le taux de profit est donc : survaleur (S)/capital global (C+V) = 100 dollars/150 dollars = 66,6%.
En augmentant la part du capital constant, le taux de profit baisse. Dans le même exemple, en gardant le même taux de survaleur, si on fait passer le capital constant de 50 à 100 dollars, on a un taux de profit de :
S/(C+V) = 100 dollars/200 dollars = 50%. Si on augmente jusqu’à 200 dollars le montant du capital constant, toutes choses égales par ailleurs, on a :
S/(C+V) = 100 dollars/300 dollars = 33,33% de taux de profit. Et ainsi de suite.
Au sujet de cette augmentation du capital constant, les marxistes parlent « d’augmentation de la composition organique du capital » et considèrent ce développement des forces productives comme un phénomène progressiste. Cette tendance est donc ancrée dans la nature même du mode de production capitaliste et elle a été l’un des problèmes majeurs auxquels les capitalistes ont eu à faire face pendant la période de l’après-guerre. La masse de la survaleur augmente, mais l’augmentation du capital constant est proportionnellement plus importante. Il en résulte une baisse du taux de profit. Les capitalistes n’ont cessé d’essayer de surmonter cette contradiction au moyen de l’aggravation de l’exploitation des travailleurs – ce qui augmente la masse de survaleur et par conséquent le taux de profit – par d’autres moyens que l’investissement. Pour ce faire, ils accroissent l’intensité de l’exploitation de diverses façons, par exemple en augmentant la vitesse des machines, en augmentant la charge de travail de chaque salarié ou encore en rallongeant la journée de travail. Une autre façon de restaurer le taux de profit consiste à ramener les salaires des travailleurs en dessous de leur valeur nominale (par la dévaluation de la monnaie, par exemple).
Les lois mêmes du système capitaliste génèrent d’énormes contradictions. La course au profit à laquelle se livrent continuellement les capitalistes donne une impulsion à l’investissement, mais l’introduction de nouvelles technologies augmente le chômage. Cependant, paradoxalement, la seule source de profit réside dans le travail des salariés.
L’exportation du capital
Le stade suprême du capitalisme – l’impérialisme – est marqué par une exportation massive de capital. La recherche de plus grands taux de profit pousse les capitalistes à investir d’énormes sommes d’argent à l’étranger, dans des pays où la composition du capital est plus faible. Finalement, comme le prévoyaient Marx et Engels dans le Manifeste du Parti Communiste, le mode de production capitaliste a fini par s’étendre au monde entier.
L’une des contradictions majeures du capitalisme réside dans le problème évident que la classe ouvrière, en tant que consommatrice, doit pouvoir racheter ce qu’elle a produit. Mais dans la mesure où elle ne reçoit pas, sous la forme du salaire, la pleine valeur de son travail, elle n’en a pas les moyens. Les capitalistes cherchent à résoudre cette contradiction en réinvestissant de la survaleur dans les forces productives. Ils s’efforcent également d’écouler leur excédent sur le marché mondial, en concurrence avec les capitalistes des autres pays. Mais il y a des limites à cela, puisque tous les capitalistes de la planète se livrent au même jeu. Enfin, les capitalistes encouragent le crédit, à travers le système bancaire, de façon à augmenter artificiellement le pouvoir d’achat de la population et stimuler ainsi la vente des marchandises qui, autrement, n’auraient pas trouvé preneur. Mais à cela aussi il y a des limites, les crédits devant finalement être remboursés – avec en prime les intérêts.
Cela explique pourquoi, périodiquement, les phases de croissance sont suivies par des périodes de récession. La lutte fiévreuse pour des parts de marché provoque une crise de surproduction. Le caractère destructeur de ces crises, qui s’accompagnent d’une destruction massive de capital accumulé (fermeture d’usines, abandon de secteurs d’activité, etc.), est une indication suffisante de l’impasse dans laquelle se trouve le système capitaliste.
Tous les facteurs qui ont mené à la croissance d’après guerre ont en même temps préparé la voie aux crises et aux récessions. Ce qui caractérise l’époque actuelle, c’est la crise organique qui se dresse face au système capitaliste. Si le capitalisme n’est pas éradiqué, à un certain stade, la classe ouvrière fera face à une crise du type de celle de 1929. L’humanité ne peut éviter le chaos, les gaspillages massifs et la barbarie inhérents au capitalisme qu’en renversant ce système anarchique. En éliminant la propriété privée des moyens de production, la société pourra échapper aux lois du capitalisme et se développer d’une façon rationnelle et planifiée. Les puissantes forces productives accumulées dans le carcan de la société de classes, du système capitaliste, permettront d’en finir une fois pour toutes avec ce scandale que sont les crises de surproduction dans un monde ravagé par la faim et les pénuries. L’élimination de la contradiction entre, d’une part, le développement des forces productives, et, d’autre part, l’État-nation et la propriété privée des moyens de production, posera les bases d’une planification internationale de la production.
Sur la base du socialisme, grâce à la science et la technologie modernes, le monde entier pourrait être transformé en l’espace d’une décennie. La transformation socialiste de la société est la tâche la plus urgente de la classe ouvrière mondiale. Le marxisme fournit l’arme et la compréhension nécessaires pour souder ensemble cette puissante armée en vue de l’établissement du socialisme en Europe et dans le monde entier.
[1] À l’époque, l’une des revendications principales des réformistes de gauche dans le Parti travailliste portait sur la restriction des importations afin de « protéger l’industrie britannique » et les « emplois britanniques ». La tendance marxiste dans le parti et les auteurs de ce document n’acceptaient pas cette revendication aux connotations nationalistes, et expliquaient qu’elle provoquerait inévitablement des mesures de rétorsion de la part des pays concernés.
[2] « Travailleurs sans propriété » : il s’agit bien évidemment de la propriété des moyens de production, et non pas celle des biens consommables, de maisons, de voitures etc.