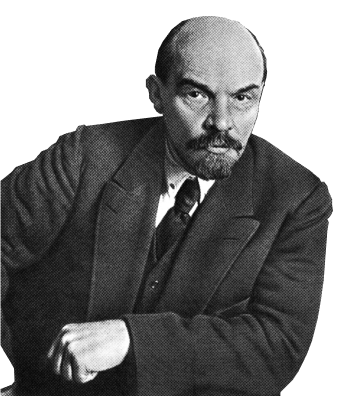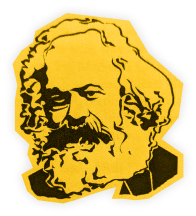La guerre commerciale menace des centaines de milliers d’emplois au Québec et au Canada.
Nous ne pouvons compter sur la classe dirigeante et leurs partis, les conservateurs comme les libéraux, qui ont montré encore et encore qu’ils prioriseront les profits devant tout le reste.
La seule chose qui puisse freiner les fermetures d’usine et protéger les emplois est l’action indépendante des travailleurs : les grèves et occupations.
Nous n’inventons rien ici. Au Québec et au Canada, les grèves et occupations d’usine font partie de la tradition de notre classe. Cet article se propose de revisiter un épisode inspirant de cette histoire : l’occupation de l’usine d’Alcan en 2004.
Fermeture
Le 22 janvier 2004, c’est lors d’un événement hautement symbolique, le Forum économique à Davos, que le premier ministre québécois lui-même, Jean Charest, annonce la fermeture des cuves Soderberg de l’usine d’Alcan à Arvida. C’est à ce forum des riches et puissants que le président d’Alcan l’en avait informé.
Cette annonce suivait une série d’autres fermetures d’usines dans la région. En 2003, la faillite de la chaîne Consomat et de la Coopérative forestière Laterrière entrainait la perte de 1000 emplois. En décembre, Abitibi Consol annonçait également la fermeture de son usine de papier à La Baie, éliminant 640 emplois.
Thème familier, Alcan avait reçu plus de 100 millions de dollars en aide financière du fédéral et affichait des profits de plus d’un demi-milliard dans les deux années précédant la fermeture. Hier comme aujourd’hui, les entreprises riches et traitées aux petits oignons n’ont aucun scrupule à éliminer de bons emplois.
Alcan était à l’époque le plus grand producteur d’aluminium au monde – et Rio Tinto Alcan l’est encore aujourd’hui. Elle était censée fermer les cuves Soderberg (une technologie considérée dépassée et polluante) en 2014, mais avait surpris tout le monde en fermant 10 ans plus tôt, invoquant la hausse de la valeur du dollar canadien, et donc une hausse du coût des exportations.
La réalité est qu’elle possédait ses propres installations hydroélectriques dans la région, et souhaitait exporter aux États-Unis l’électricité épargnée par la fermeture des cuves, ce qui était plus profitable pour la compagnie.
Mais les travailleurs n’ont pas accepté la logique patronale. Ils demandent qu’une nouvelle aluminerie soit ouverte pour remplacer les cuves devant fermer, et ainsi préserver les emplois.
Et pour y arriver, ils décident d’occuper leur lieu de travail.
L’occupation commence
Une assemblée générale des travailleurs de l’usine se tient le 26 janvier. Il est intéressant de voir comment l’idée de l’occupation de l’usine est venue. Un délégué syndical, Jeannot Boivin, l’explique : « Quelqu’un a suggéré l’occupation de l’usine, et ça a fait boule de neige. »
Aussi simple que ça! Dans les bonnes conditions, une seule personne avec les bonnes idées peut avoir un impact disproportionné sur la lutte de classe.
À l’assemblée, 2000 membres du Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida (SNEAA) votent à l’unanimité pour prendre le contrôle des cuves Soderberg. L’occupation, qui durera 19 jours, commence.
Les travailleurs cessent de répondre à leurs superviseurs, et s’occupent des opérations eux-mêmes. Quelque 2500 travailleurs de la région s’arrangent pour que les travailleurs aient le matériel nécessaire pour relancer la production sous leur propre contrôle.
Un syndiqué raconte : « Même si on ne fait pas partie de la même centrale, tous les syndicats de l’aluminium sont assis ensemble dans une intersyndicale. La solidarité a été instantanée pour fournir l’électricité, la bauxite, l’alumine, tous les éléments dont on avait besoin pour repartir la production. »
Le 30 janvier, sans surprise, Alcan obtient une ordonnance de la Commission des relations de travail qui désigne l’action des travailleurs comme étant illégale. Mais cela ne les arrête pas. Le lendemain, 5000 personnes manifestent à Arvida en appui aux travailleurs!
Les menaces d’énormes amendes – entre 100 et 200 dollars par jour pour les travailleurs et de 10 000 à 50 000 dollars pour le syndicat – ne suffisent pas à les arrêter. L’ordonnance n’est même pas mise en vigueur, les travailleurs forcent plutôt les patrons à négocier.
Contrôle ouvrier
Dans les faits, l’usine est maintenant sous contrôle ouvrier. Par leur action audacieuse, les travailleurs démontrent une chose : les patrons ont besoin des travailleurs, et non l’inverse.
En effet, malgré les tentatives de sabotage des patrons, la production sous contrôle des travailleurs non seulement fonctionne, mais fonctionne mieux qu’auparavant.
Boivin explique : « Nous sommes les travailleurs, et nous savons comment faire marcher l’usine. Les superviseurs n’ont jamais vu les opérations en si bon état. »
Début février, le syndicat rapporte que la production a même augmenté sous le contrôle des travailleurs.
Plutôt que de prendre leurs ordres des superviseurs, la relation inverse s’établit : « Ils nous demandaient nos rapports sur la production, mais s’ils demandaient quoique ce soit d’autre, notre réponse était « non, c’est nous qui décidons. On vous demande votre collaboration pour des demandes spécifiques et pour les matières premières. C’est essentiel pour la sécurité des travailleurs. » »
Les travailleurs interviewés à l’époque expliquent que les contremaîtres scrutaient à la loupe le travail – jamais ils ne s’étaient autant soucié de la sécurité! Le but était évidemment de montrer que les travailleurs ne pouvaient pas diriger les opérations, mais sans succès.
Boivin ajoute :
« Sous le contrôle des patrons, c’était le bien-être des cuves qui passait en premier. Maintenant, sous contrôle syndical, c’est le bien-être des travailleurs et leur sécurité qui prime. Il n’y a pas une échelle ou une passerelle qui manque, les colonnes et les planchers ont été réparés. Nous avons fait tout ça sans les superviseurs – on aurait probablement attendu six mois ou un an pour avoir les mêmes résultats. »
Cela pointe vers une leçon importante de cette lutte. Les occupations d’usine mettent immédiatement la question clé sur la table : qui est maître, le patron ou les travailleurs? Les travailleurs d’Arvida montraient le potentiel latent de la classe ouvrière à prendre le contrôle de la société. »
Conscience de classe
À travers cette lutte, les travailleurs forcent les patrons à négocier pour vrai, et tirent des conclusions radicales de leur expérience.
Le 8 février, la direction syndicale annonce une entente de principe avec les patrons. Les travailleurs seraient transférés et la compagnie investirait 20 millions de dollars dans le développement économique au Saguenay.
Cependant, les travailleurs apprennent au cours du meeting syndical que la vraie raison de la fermeture, c’est qu’Alcan souhaite utiliser les 200 mégawatts d’électricité économisés par la fermeture à l’extérieur de la région car cela est plus profitable.
Les travailleurs rejettent donc à l’unanimité l’entente de principe, et demandent que l’argent économisé soit utilisé pour bâtir une nouvelle usine, et que les 200 mégawatts servent pour la région.
Mais plus important encore, les travailleurs tirent la conclusion qu’il faut aller plus loin. Ils demandent la nationalisation des installations hydroélectriques d’Alcan!
Nous voyons comment dans la lutte pour le contrôle ouvrier et le maintien des emplois, les travailleurs sont amenés à tirer des conclusions politiques et économiques plus larges et à remettre en question la propriété privée elle-même.
La fin de l’occupation
Une occupation d’usine est le point de départ de la lutte contre les fermetures et les pertes d’emploi. Mais si une telle lutte reste isolée, il y a des limites à ce qu’il est possible d’accomplir.
Malheureusement, à part la manifestation de solidarité du 31 janvier, bien peu a été fait par la direction syndicale pour étendre la lutte.
Le gouvernement et les patrons ont pu reprendre le dessus et le 13 février, la Commission des relations de travail déclare qu’il s’agit d’une grève illégale et décrète une injonction permanente contre les travailleurs.
Sans perspective d’escalader la lutte, la direction du SNEAA recommande de se plier à l’injonction permanente et de cesser l’occupation. Les 16-17 février, les 2500 travailleurs réunis en assemblée acceptent cette proposition.
D’après ce que nous pouvons en dire, les négociations ont repris et le syndicat a éventuellement obtenu d’Alcan l’engagement qu’il n’y ait aucune mise à pied. Mais la construction d’une nouvelle usine n’est jamais venue, ce qui était la principale revendication des travailleurs.
Faire revivre nos traditions combatives
L’occupation d’Alcan à Arvida est un moment important de l’histoire de notre classe.
Par-dessus tout, elle a laissé derrière une lutte combative de laquelle s’inspirer aujourd’hui. Elle a aussi montré l’immense potentiel de la classe ouvrière. Les communistes se donnent pour devoir de faire connaître ces traditions et de les raviver dans le mouvement aujourd’hui.
À l’époque de l’occupation d’Arvida, il s’agissait d’un seul lieu de travail isolé. Et une seule usine sous contrôle ouvrier ne peut pas tenir le coup éternellement dans un océan capitaliste.
Aujourd’hui cependant, dans le contexte de la guerre commerciale, les travailleurs de nombreuses usines seront confrontés à des attaques similaires. Dans ce contexte, une occupation similaire dans n’importe quelle usine pourrait trouver un terrain fertile pour s’étendre à d’autres lieux de travail. Elle pourrait rapidement se transformer en un mouvement de masse où les travailleurs tirent des conclusions radicales et révolutionnaires.
Aujourd’hui, l’écrasante majorité des directions syndicales et de la gauche, même « radicale », rejette les méthodes de grève et occupation pour combattre les pertes d’emplois. Mais c’est la seule façon d’obtenir quoique ce soit de la part des patrons.
Seul un mouvement de masse des travailleurs peut empêcher les capitalistes d’éliminer nos emplois pour protéger leurs profits. Et seule une révolution de la classe ouvrière peut mettre fin une fois pour toutes à ce système pourri.