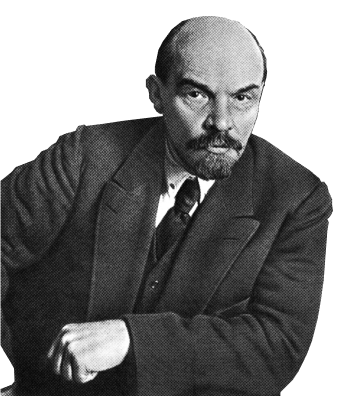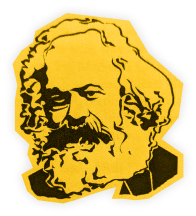David Lynch, sans doute l’un des réalisateurs contemporains dont l’influence se faisait la plus saillante sur le cinéma actuel, est mort la semaine dernière. Il lègue une œuvre aussi tortueuse qu’un point d’interrogation, où le mystère règne en maître. L’apparente abstraction de ses créations, souvent moquées pour leur aspect cryptique, répondait en vérité à l’absurdité du capitalisme. Du rêve américain, sa caméra captait le cauchemar.
À travers ces actrices étouffées sous le strass hollywoodien dans Mulholland Drive ou bien ces habitants paralysés par la quiétude de leur bourgade parfaite dans Twin Peaks, il rendait compte des existences brisées derrière toutes les fausses promesses de l’industrie du divertissement. Du début à la fin, cette dernière lui fut d’ailleurs résolument rétive. Même louangé par les cinéphiles du monde entier, David Lynch se battait encore à soixante-dix-huit ans pour toucher – en vain – son financement. Il n’avait en conséquence pas pu tourner le moindre long-métrage depuis Inland Empire, en 2006.
Aujourd’hui, parmi les intarissables égards posthumes à son endroit, il semble que l’hypocrisie de ses bailleurs de fonds se fasse plus manifeste que jamais. À l’annonce de son décès, le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a notamment publié sur son compte Instagram une drôle d’hommage aux accents de lettre d’excuse. On y lit que la société, avant que la santé de Lynch ne se complique, se serait montrée « all in » pour un nouveau projet de série. Quoi de plus grotesque?
Netflix tenta vers la fin des années 2010 de se distinguer de ses compétiteurs en se présentant comme un havre de créativité pour illustres cinéastes gênés par les majors. Cette brève ouverture permit certes à Lynch de produire un court-métrage expérimental sous ses auspices. Mais la compagnie, constatant le trop maigre succès de cette sortie, se contenta ensuite de laisser traîner ses autres projets d’envergure au seuil de la corbeille, ou bien de les refuser tout bonnement.
Investir dans un art tant soit peu exigeant, pour ces exécutants qui ne carburent qu’aux scénarios sans relief facilement commercialisables, cela ne constitue rien de plus qu’un gaspillage de recettes. Un tel phénomène n’est toutefois en rien dû à la simple avarice individuelle de Sarandos : il est au fond symptomatique de la crise générale du capitalisme, qui s’insinue jusque dans le petit et le grand écrans.
Avec l’augmentation du coût de la vie, les ménages disposent de moins en moins d’argent à allouer à la culture. Les entreprises privées auxquelles se voit confiée la gestion du patrimoine artistique vivant redoublent donc de conservatisme en vue de courtiser leurs audiences. Cantonné dans ce cimetière culturel, le style lynchien, qui opère en heurtant le spectateur plutôt qu’en le caressant dans le sens du poil, ne possédait pour toute avenue que celle du silence.
Mais Lynch lui-même demeurait optimiste. Il continua d’écrire, de peindre. Un temps, il s’initia même à l’univers des vidéos en ligne, lançant sa propre chaîne Youtube. C’était là une façon marginale de contourner les rejets des studios.
S’il s’éteignit avant les incendies de Californie, qui calcinèrent l’emphysème que des décennies de tabagisme avait déjà creusé dans ses poumons, David Lynch brûla néanmoins bien plus longtemps. Sa passion fut si brillante qu’elle éclaire toujours les nombreuses preuves de sensibilité humaine qui persistent sous la froideur capitaliste, vers laquelle il n’hésitait pas à tourner ses regards crus.
Quant à nous qui restons en vie, nous avons le devoir de renverser ce système qui signe la mort de l’art, et nous le ferons droit dans les yeux. À tous ceux qui nous tancent de naïveté, avançant que le communisme ne consisterait qu’à enfiler une paire de lunettes roses en fantasmant une utopie inapplicable, nous rétorquons, à la suite du grand artiste, qu’ils se trompent de teinte : « Aujourd’hui, je porte des lunettes noires car je suis en train de contempler l’avenir, et c’est très brillant. »
Cette lucidité nous est octroyée par la méthode marxiste, qui permet d’y voir clair dans le chaos des événements sans toutefois s’y éblouir – ce sont en quelque sorte nos propres verres fumés. David Lynch ne parvint jamais à des conclusions révolutionnaires, mais il devait jouir des services d’un excellent opticien.
Comme lui, nous avons confiance en la puissance des gens ordinaires. Eux seuls sauront embraser cet avenir qui scintille tout près de nous. En cela, plus encore qu’en soulignant sa mort, nous célébrons sa vie, qui accuse la ténacité de l’art là où tout concourait à le supprimer.