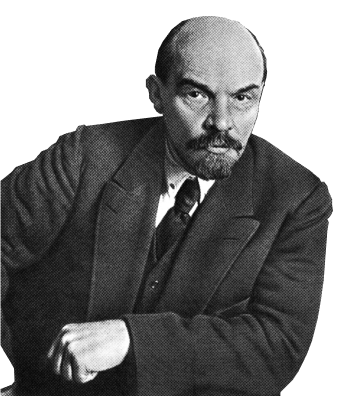Cinq années se sont écoulées depuis la lutte héroïque des étudiant-es lors du « Printemps érable ». Ce magnifique mouvement de la jeunesse avait secoué la province jusque dans ses fondements et s’est clôt avec la défaite du Parti libéral et l’annulation de la hausse des frais de scolarité. Cependant, cinq ans plus tard, l’austérité continue à un rythme soutenu, et les libéraux sont bien en selle au pouvoir. Le cinquième anniversaire du Printemps érable est l’occasion pour nous de revoir ces événements historiques et de souligner les leçons de ce mouvement extraordinaire.
2012, un tournant
La jeunesse est et a toujours été un baromètre de l’état d’une société donnée. Dans la plupart des mouvements de masse, la jeunesse joue un rôle d’avant-plan, entraînant à sa suite les couches plus hésitantes, ou se faisant l’étincelle d’une poussée révolutionnaire. En 2012, l’irruption des étudiant-es sur la scène de l’histoire était le symptôme le plus saillant de la crise qui s’était développée au Québec au cours des années précédentes. Les attaques répétées des libéraux de Jean Charest ont entraîné la réaction de la jeunesse québécoise, qui leur a répondu un « C’est assez! » haut et fort.
L’une des leçons principales de 2012 est celle du leadership. Les militant-es à la tête de la CLASSE (Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante) ont donné une direction audacieuse et ont défié non seulement le gouvernement, mais la classe capitaliste. En 2011, dans un discours de mobilisation en vue de la grève, Gabriel Nadeau-Dubois a terminé ainsi :
« Car ne l’oublions pas; les gens qui veulent augmenter les frais de scolarité, les gens qui veulent couper dans les services publics, les gens qui veulent privatiser la santé, les gens qui veulent réduire, voire abolir les réglementations gouvernementales en matière d’environnement, les gens qui méprisent les droits des femmes, les droits autochtones, les droits de toutes les minorités, les gens qui travaillent d’arrache-pied depuis des décennies à brimer le droit des travailleurs et travailleuses à s’associer, tous ces gens-là sont les mêmes.
Ces gens-là sont peu nombreux, ces gens-là contrôlent tout et veulent toujours contrôler plus, ces gens-là ont des intérêts communs, ces gens-là ont un projet politique commun. Il fut un temps au Québec au Canada, il n’y a pas si longtemps de ça, qu’une minorité comme ça qui contrôle les institutions politiques et économiques d’un pays, qui partage des intérêts communs, il n’y a pas si longtemps on appelait ça une classe, et il faut arrêter d’avoir peur des mots. Il faut nommer ces gens-là par leur nom; ces gens-là c’est la classe dominante, ces gens-là c’est la bourgeoisie. La lutte contre la hausse des frais de scolarité, la lutte des indigné-es à travers le monde doit être nommée par son nom. Il s’agit d’une lutte de classes. Une lutte de la […] minorité possédante contre la majorité qui ne possède rien. Une minorité gloutonne et vulgaire, une minorité qui ne voit la vie que comme une occasion d’affaires, un arbre que comme une matière première et un enfant que comme un futur employé. […] Lorsque nous contesterons contre la hausse des frais de scolarité, c’est aussi contre ça que nous contesterons. »
En août 2011, dans la publication de l’ASSÉ, Ultimatum, dans un éditorial intitulé « Nous y sommes enfin » écrit par Nadeau-Dubois, il y avait un appel qui équivalait à un appel à une révolution. Dans une section de l’article intitulée « Nous ne sommes pas seul-e-s », on peut lire : « Partout à travers le monde, en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, en Grande-Bretagne, en Syrie, en Égypte ou en Tunisie, les peuples se révoltent et réclament leur dû. […] Après le printemps arabe, assisterons-nous au printemps québécois? » Ce à quoi il répond : « La réponse de l’ASSÉ est catégorique : il le faut. […] Cette session, cela commencera par une mobilisation massive sur tous les campus du Québec. […] De plus en plus, dans les corridors des cégeps et des universités, on entend murmurer, comme une rumeur, trois lettres, toujours les trois mêmes : GGI. La rumeur, depuis le printemps dernier, se fait de plus en plus insistante. GGI : grève générale illimitée. […] Devant l’ampleur du défi, aucune hésitation n’est permise : mobilisons-nous dès aujourd’hui, en grand nombre et avec détermination. Il n’en tient qu’à nous. »
En réponse à ce leadership ferme et sans compromis, la réponse des étudiant-es a été remarquable. En mars, 75 % de tous les étudiant-es postsecondaires étaient en grève et le 22 mars, plus de 200 000 personnes prenaient d’assaut les rues de Montréal. La confiance et l’élan du mouvement étaient palpables.
Dans les semaines et les mois qui suivirent le début de la grève, non seulement le gouvernement n’avait pas bougé d’un pouce, mais avait même renforcé sa position de départ et refusait de capituler. Le gouvernement tentait de diaboliser la CLASSE et insistait qu’il ne négocierait pas avec elle. Cela était une insulte aux étudiant-es en grève qui étaient, dans leur majorité, représentés par cette coalition.
Les médias, possédés et contrôlés par les capitalistes, ont tenté d’ignorer le mouvement quand ils le pouvaient, et essayaient de le dépeindre comme un mouvement d’enfants gâtés, violent, et ennemi des travailleur-euses. À ce stade, le gouvernement avait déjà commencé à imposer des injonctions contre les grévistes et les arrestations de masse de centaines d’étudiant-es avaient commencé aussi. Le SPVM et la SQ devenaient particulièrement détestés à cause de leurs méthodes brutales. Un étudiant, Francis Grenier, a même perdu un œil au début mars à cause d’une grenade assourdissante lancée à son visage. Le gouvernement demandait aux étudiant-es de dénoncer la violence de quelques manifestant-es, et ce, au moment même où la police déchaînait une violence et une répression systématiques et menaçaient le droit de manifester. Une telle hypocrisie créait une rage non seulement au sein des étudiant-es, mais aussi au sein de la classe ouvrière.
Qu’était la grève de 2012?
Les étudiant-es du Québec ont une longue tradition de grèves très militantes datant d’aussi loin que les années 1960. C’est la principale raison pour laquelle l’éducation postsecondaire est la plus abordable du pays. Il est vrai que lors les mouvements précédents, le gouvernement avait reculé beaucoup plus rapidement devant la colère généralisée et le nombre impressionnant de grévistes. En 2005, une grève étudiante de seulement six semaines avait forcé le gouvernement libéral à reculer sur sa tentative de transformer une centaine de millions de dollars de bourses en prêts.
Mais la grève de 2012 n’était pas comme les autres. Seulement quatre ans après la crise économique de 2008, elle survint au cœur d’une nouvelle époque de crise du capitalisme et d’austérité. L’économie et la situation financière de la province étaient dans un piteux état. La classe capitaliste du Québec et ses laquais cherchaient à mettre sur le dos des travailleur-euses et des jeunes les coûts de la crise. La bourgeoisie devait absolument envoyer un message clair à la jeunesse et aux travailleur-euses : aucune résistance à son programme d’austérité ne serait tolérée.
La bourgeoisie québécoise, en 2012, comprenait très bien ce qui était en jeu. La Montreal Gazette expliquait que « toute ‘‘paix sociale’’ que [le gouvernement] pourrait acheter avec les étudiants ne pourrait pas être permanente, car d’autres groupes d’intérêts opposés à de futures mesures d’austérité verraient que non seulement le gouvernement, mais la société qu’il représente peut être intimidée ». En clair, l’on craignait que les étudiant-es ne soient un exemple positif pour la classe ouvrière plus large. Cette peur était justifiée et le gouvernement libéral a agi en conséquence en tentant d’écraser le mouvement. Ce contexte a fondamentalement changé le caractère de la lutte, la transformant d’une simple grève étudiante en un mouvement remettant en question qui dirige la société.
La jeunesse et les travailleurs et travailleuses
Dans le contexte de crise du capitalisme, les étudiant-es se devaient d’étendre la lutte à la classe ouvrière en général afin de gagner. Les étudiant-es, malgré leur enthousiasme débordant et leur capacité de mobilisation impressionnante, sont loin de posséder l’impact économique des travailleur-euses. Une grève étudiante, malgré son importance, ne peut pas arrêter la production dans les secteurs décisifs de l’économie. Ce sont les travailleur-euses qui ont ce pouvoir. Ainsi, il n’est pas surprenant que les libéraux n’aient fait aucune concession digne de ce nom aux étudiant-es, malgré l’ampleur inégalée du mouvement. Tant que les travailleur-euses n’étaient pas entraînés de façon décisive dans le mouvement, les libéraux n’allaient pas broncher, ce qui est encore plus vrai dans un contexte de crise du capitalisme, où les patrons sont décidés à refiler la facture à la classe ouvrière et à la jeunesse sous forme de mesures d’austérité.
Devant cette situation, la direction de la CLASSE a appelé à ce que l’on aille « plus loin que la grève générale illimitée » et a appelé à une « grève sociale », c’est-à-dire une grève générale de toute la société, et c’est tout à son honneur. Elle affirmait à juste titre que le gouvernement ne parlait que le langage de l’argent, et qu’en conséquence il fallait « organiser des occupations et déranger l’économie ». Cependant, ce mouvement n’a pas été organisé de façon systématique et collective, et aucunes directives claires n’ont été données sur la façon de mettre cette idée en pratique. À plusieurs reprises, cela s’est manifesté par des actes isolés, avec des étudiant-es bloquant ou occupant des lieux publics, sans que des liens ne soient tissés avec les travailleur-euses qui s’y trouvaient ou qu’une communication ne soit établie. Cela contribuait à renforcer le discours de Jean Charest voulant que les étudiant-es soient les ennemis des travailleur-euses.
Malgré le fait que les sondages montraient qu’il y avait un appui massif à la grève au sein de la population en général et qu’il y avait un désir clair chez les étudiant-es d’amener les travailleur-euses dans la lutte, cela ne s’est jamais matérialisé de manière organisée. Ce dont nous avions besoin, c’était non seulement de déclarations en faveur d’une grève sociale, mais d’une action organisée sur le terrain. Les dirigeants des principaux syndicats avaient clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas d’une grève générale, et donc un mouvement de la base en faveur d’une grève générale de 24 heures devait être organisé afin de les mettre sous pression. Afin d’y arriver, les étudiant-es auraient dû aller voir les travailleur-euses et entrer en dialogue avec eux. Dans tous les cégeps et universités, des comités de solidarité étudiant-es-travailleur-euses auraient dû être établis avec comme objectif d’identifier les principaux lieux de travail d’un secteur particulier. Ces comités auraient pu mobiliser les étudiant-es pour des visites de ces lieux de travail et demander à pouvoir expliquer leur lutte aux travailleur-euses. Ils auraient pu expliquer le contexte général, expliquer qu’une défaite des étudiant-es, au bout du compte, serait une défaite pour les travailleur-euses et qu’une fois que le gouvernement en aurait fini avec les étudiant-es, c’est à eux qu’il s’attaquerait ensuite. Des syndicats et des représentants syndicaux sympathiques à la cause étudiante auraient pu être contactés et inclus dans les discussions. Malheureusement, cela n’est pas arrivé, les travailleur-euses n’ont pas été entraînés dans la lutte, et le mouvement s’est enfoncé dans une impasse.
Les masses demandent des comptes à leurs leaders
En mai, alors que le mouvement commençait à traîner en longueur, les représentant-es de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), deux organisations traditionnellement plus conservatrices, affirmaient qu’ils seraient prêts à négocier avec le gouvernement sans que les porte-parole de la CLASSE soient présents. Afin d’être invitée aux négociations, la CLASSE avait dénoncé la violence des manifestant-es, et le gouvernement fut forcé de l’inclure. Les représentant-es de la FECQ et de la FEUQ ont rapidement démontré qu’ils étaient prêts à accepter une entente équivalant à une capitulation. Les porte-parole de la CLASSE, représentant le cœur des étudiant-es en grève et ayant pour mandat de ne faire aucune concession, furent placés sous une pression immense de la part de toutes les institutions politiques, économiques et médiatiques de la société. Le gouvernement se servit même des dirigeants des principaux syndicats pour convaincre ces porte-parole d’être « raisonnables » et de rendre « un service pour le bien du Québec ». Le résultat de ce blitz de négociations des 4 et 5 mai fut une entente bidon entre le gouvernement et les représentant-es des étudiant-es. Ces derniers parlaient d’une « victoire partielle », mais cela fut rapidement contredit par les ministres libéraux qui insistaient sur le fait qu’ils allaient de l’avant comme prévu avec une hausse des frais de scolarité. Pire encore, l’entente indiquait que les leaders étudiants auraient à faire partie d’un comité devant superviser les coupes au sein des universités. Ce comité devait être dominé par des représentants de l’État et des grandes entreprises et se serait servi de l’autorité des leaders étudiants afin de vendre l’austérité à leur base.
Au grand désarroi des élites, mais aussi des leaders étudiants et ouvriers, la base des étudiant-es se réunit alors dans les différentes assemblées sur les différents campus de la province et rejeta cette entente pourrie. Le mercredi 9 mai, 14 cégeps avaient rejeté l’entente et seulement deux l’avaient acceptée. Les votes au sein des universités révélaient aussi un rejet massif de cette entente. Cela entraîna une nouvelle rupture des négociations. La ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, démissionna en réaction. Le mouvement récoltait une première victoire concrète!
Le fouet de la contre-révolution
En mai, des questionnements se développaient au sein de la population étudiante. Qu’allons-nous faire? Nous ne pouvons pas simplement faire la grève éternellement! Que va-t-il arriver? Les libéraux de Charest, ayant échoué à tuer le mouvement à coups de subterfuges, de mensonges et de salissage, tentèrent de l’écraser une bonne fois pour toutes. Le 18 mai, le Parti libéral, avec l’appui de la CAQ, fit adopter le projet de loi 78, une loi antidémocratique brutale destinée à restreindre le droit de manifester dans la province, promettant des amendes salées pour les syndicats ou les individus qui continueraient à bloquer l’accès aux écoles avec des piquets de grève.
Cela mena à une situation cocasse où la Haut-Commissionnaire des Nations unies aux droits de l’homme, Navi Pilla, mettait en garde contre la tendance inquiétante des gouvernements à violer les droits humains fondamentaux, comme le droit de manifester, à des endroits comme la Syrie, le Mali, le Népal, le Mexique, la Russie, la Corée du Nord, le Zimbabwe, le Soudan du Sud et… le Québec! Elle affirmait « dans le contexte des manifestations étudiantes, [être] déçue par la loi adoptée au Québec qui restreint leur droit à la liberté d’association et de rassemblement pacifique. »
Marx a déjà dit que « la révolution a parfois besoin du fouet de la contre-révolution ». Les libéraux, enragés et arrogants, ont commis une erreur majeure avec cette loi et ont provoqué l’effet contraire à celui recherché. La colère et la rage se sont répandues au Québec comme une traînée de poudre. Le 21 mai, la CLASSE tint une conférence de presse annonçant qu’elle considérait la loi injuste et qu’elle ne la respecterait pas. Elle mit sur pied un site Web où quiconque pouvait publier une photo de soi-même tenant une affiche affirmant « Je défie la loi 78 ». Ce site Web a connu un succès monstre, avec des milliers de personnes tout autour de la province ayant publié des photos proclamant leur refus d’obéir à la loi.
Jusqu’alors, les dirigeants syndicaux avaient joué un rôle ignoble. Tout en dénonçant de temps à autre le gouvernement, ils en appelaient à la CLASSE à être raisonnable et à accepter un compromis. Ils refusaient catégoriquement l’idée d’organiser une grève de solidarité des travailleur-euses et ont généralement tenté de freiner leurs membres afin de ne pas perdre le contrôle de la situation. L’adoption du projet de loi 78 renversa la vapeur. La pression des membres de la base des syndicats était devenue trop forte et les syndicats furent forcés de mobiliser leurs membres en vue de la grande manifestation du 22 mai. Le résultat fut extraordinaire. La loi 78 avait donné une deuxième vie au mouvement et avait permis d’étendre celui-ci à la classe ouvrière. Plus de 400 000 personnes manifestèrent ce jour-là. La police ne pouvait rien faire devant le pouvoir irrésistible des masses. Les masses pouvaient sentir leur pouvoir dans ce qui fut le plus grand acte de désobéissance civile de l’histoire de la province et même du pays.
En plus, le soir du 24 mai, sans leadership officiel, des dizaines de manifestations ont spontanément fait irruption dans différents quartiers de Montréal au mépris de la loi anti-manifestation. Vers 20 h, peu importe le quartier dans lequel on se trouvait, l’on pouvait entendre le bruit des casseroles raisonner. Des centaines voire des milliers de travailleur-euses, dans une dizaine de quartiers, prirent spontanément d’assaut la rue munis de leurs casseroles. Ces manifestations continuèrent pendant des semaines et rendirent la loi 78 inapplicable dans la pratique.
Il s’agissait aussi d’une formidable occasion d’étendre la lutte à la classe ouvrière. Les « casseroles » étaient constituée en grande proportion de travailleur-euses inquiets de voir leurs fils et leurs filles subir la répression d’un gouvernement de plus en plus autoritaire. L’un des faits marquants de cette période est l’absence quasi totale de leadership. Les leaders de la CLASSE, qui avaient héroïquement appelé les masses à se soulever contre le gouvernement et la classe capitaliste comme partie intégrante d’un mouvement qui s’étendait à l’échelle mondiale, n’avaient clairement pas de plan lorsque ces masses répondirent à l’appel. Le gouvernement refusait de reculer et les leaders étudiants continuaient leurs appels à « poursuivre la lutte ». Ils étaient officiellement en faveur de la « grève sociale » et faisaient des appels répétés à ce qu’on se dirige dans cette voie, mais très peu d’actions concrètes furent posées pour aider les travailleur-euses de la base à surmonter leur bureaucratie syndicale conservatrice. La situation n’aurait pas pu être plus mûre pour que les étudiant-es aillent vers les travailleur-euses, entrent en dialogue, établissent des liens de solidarité et ainsi défendent auprès d’eux l’idée d’une grève générale unie contre le gouvernement. Ce n’est pas l’enthousiasme ou la détermination qui manquaient à la jeunesse québécoise, mais plutôt le leadership.
Le mouvement se poursuivit en juin et juillet avec des manifestations presque quotidiennes le jour et la nuit dans presque tous les quartiers de Montréal. La répression et le profilage politique déclenchés par l’État ont atteint, lors de cette période, des proportions inégalées. Entre février et septembre 2012, plus de 3 500 personnes furent arrêtées et la police de Montréal dépensa plus de 7,3 millions de dollars en heures supplémentaires seulement. Les étudiant-es portant le carré rouge étaient souvent appréhendés, fouillés ou détenus sans raison par la police, même hors des manifestations.
Les élections
Pour des milliers d’étudiant-es encore en grève, la session d’hiver avait été suspendue par la loi 78 et devait recommencer à la mi-août. Alors que ce moment approchait, le gouvernement Charest a encore une fois changé de tactique afin de mettre fin au mouvement. Le 1er août, le Lieutenant-gouverneur du Québec Pierre Duchesne, à la demande de Jean Charest, proclamait la dissolution de l’Assemblée nationale et des élections étaient annoncées pour le 4 septembre. Charest décrivait ces élections comme un choix entre « la loi et l’ordre » et « le règne de la rue » – une référence explicite aux manifestations ayant secoué la province. « La rue a fait beaucoup de bruit » disait-il. « Maintenant, c’est au tour de la majorité silencieuse de parler. »
Une fois que Charest eût appelé les électeurs aux urnes, il fallait que le mouvement étudiant prenne position. La FEUQ et la FECQ invitèrent simplement à ne pas voter pour les libéraux. Cela représentait dans les faits un appel à un vote pour le Parti québécois qui portait le carré rouge, tapait sur des casseroles et tentait de se faire du capital politique sur le dos du mouvement. Le leader de la FECQ, Léo Bureau-Blouin, alla même jusqu’à se présenter sous la bannière de ce parti dans Laval-des-Rapides. Les anarchistes, quant à eux, appelaient à un boycott des élections et à la poursuite de la grève. Des gens comme Gabriel Nadeau-Dubois voulaient appuyer Québec solidaire, mais ont perdu face aux anarchistes. En effet, la CLASSE adopta malheureusement une position abstraite, disant que « les élections ne sont pas une solution ». Bien sûr, il est vrai au sens abstrait que sous le capitalisme, les élections ne changent en rien les fondements du système. Cependant, nous ne pouvons changer le terrain sur lequel on engage la lutte et nous devons être capables d’exploiter toutes les occasions d’infliger une défaite aux capitalistes et d’augmenter la confiance et la capacité de combat des masses.
C’est pourquoi les marxistes défendirent l’idée qu’il ne fallait pas créer de fausse dichotomie entre grève et élection, mais plutôt continuer la grève et l’utiliser comme un outil de mobilisation lors des élections. Et cela non seulement pour défaire les libéraux, mais aussi tous les autres partis bourgeois qui poussaient pour une augmentation des frais de scolarité, incluant le PQ. Cela voulait dire appuyer et s’impliquer au sein de Québec solidaire, le « parti des urnes et de la rue » autoproclamé, et le seul parti important appuyant la gratuité scolaire.
Malheureusement, à cause de la tactique du boycott, ces élections aidèrent à répandre la confusion et à démobiliser le mouvement. La population étudiante n’a pas suivi cette position de la CLASSE, qui avait une immense autorité au sein de la population à l’époque, mais s’est plutôt servi des élections comme d’une opportunité pour défaire Charest. Vers la fin août, seuls quelques milliers d’étudiant-es à l’UQAM et à l’UdeM étaient encore en grève. Était-ce inévitable que la grève perde son élan lors des élections? Nous ne le croyons pas. En fait, nous sommes tout à fait d’accord avec Jean Charest qu’il s’agissait d’une élection décidant de qui dirige le Québec. Le fait est que tout le monde savait qu’une victoire des libéraux et de Charest serait vue comme un camouflet pour les étudiant-es et tous ceux et celles qui manifestaient depuis huit mois. Dans la même logique, une victoire ou une augmentation significative des appuis à Québec solidaire aurait envoyé le message contraire.
En réalité, la position prise par la CLASSE a ouvert la porte aux leaders modérés de la FECQ et de la FEUQ, soit Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin. Plutôt que d’expliquer comment les étudiant-es pouvaient se servir des élections pour poursuivre la grève et défaire Charest aux urnes, la CLASSE a permis au Parti québécois et à ses supporters, qui avaient été largement marginalisés lors du mouvement, de défendre l’idée que si nous voulions défaire Charest, il fallait voter PQ.
Charest est battu!
Le résultat des élections fut un rejet massif de Jean Charest et du Parti libéral. Celui-ci perdit les élections et Charest fut défait dans sa propre circonscription, pour la première fois en plus de dix ans. Humilié, il fut forcé de démissionner de son poste de chef du parti après 28 ans de carrière politique. Les libéraux ont vu leur part des suffrages atteindre son plus bas niveau en 40 ans. Il faut aussi remarquer que la proportion du vote accordée au PQ a également baissé de trois points de pourcentage, et le parti fut seulement en mesure de former un très faible gouvernement minoritaire. Et cela, malgré le fait que le taux de participation était passé de 57 à 75 %. Afin d’asseoir cette maigre victoire, le PQ a dû pencher significativement à gauche, utilisant de manière opportuniste le mouvement étudiant pour augmenter son capital politique, annulant la hausse des frais de scolarité, le projet de loi 78 et d’autres mesures impopulaires des libéraux.
Cependant, cette victoire fut de courte durée. À peine quelques mois après avoir aboli la hausse des frais de scolarité, le PQ allait de l’avant avec une nouvelle hausse déguisée sous forme « d’indexation ». Le PQ, ayant appuyé de manière opportuniste le mouvement étudiant, était maintenant au gouvernail et se faisait le champion de l’austérité.
Après 18 mois d’un gouvernement d’austérité, le PQ fut à nouveau relégué à l’opposition sans cérémonie en avril 2014, et le Parti libéral revint au pouvoir, fort d’une confortable majorité à l’Assemblée nationale. Depuis son élection il y a trois ans, le PLQ, tout en évitant consciemment d’attaquer de front les étudiant-es comme en 2011-2012, a été le gouvernement le plus austère de l’histoire du Québec.
Pour plusieurs, il semble que le mouvement soit donc revenu à la case départ. Certains doivent se demander : « Pourquoi toute cette mobilisation, si c’était pour finir par remettre les libéraux au pouvoir deux ans plus tard? » La lutte de 2012 a-t-elle été vaine?
Préparons la lutte à venir!
Un article récent publié dans le journal métro posait la question de l’héritage de 2012. « [Q]ui, au Québec, est encore inspiré par le mouvement? Très peu de gens, avouons-le. Un peu comme si les épisodes du printemps 2012 avaient siphonné l’ensemble des énergies pouvant être consacrées à la contestation sociale. »
Expliquant qu’aucune manifestation n’a suivie les mesures d’austérité de Pauline Marois, l’article affirme que les libéraux de Couillard ont pu couper massivement partout « dans une apathie quasi totale ». Et il conclut tristement, « disons que le Québec ne regorge pas de jeunes progressistes aux idées sincères et désintéressées. »
En fait, la réalité est que les masses ne peuvent pas être constamment dans une situation de lutte intense contre le gouvernement et le système qu’il protège. La lutte des classes contient des hauts et des bas. Il est normal qu’après avoir lutté pendant 8 mois, les étudiant-es n’aient pu repartir un mouvement de contestation en claquant des doigts.
L’article se trompe également lorsqu’il affirme que les mesures d’austérité ont été acceptées dans une « apathie quasi totale ». C’est à se demander si son auteur était au Québec entre 2014 et 2016. Durant cette période, les travailleur-euses du secteur public en particulier se sont mobilisés comme jamais au cours des 40 années précédentes afin de lutter contre l’austérité.
Seulement, le mouvement a été trahi par sa direction qui a accepté des ententes bien en deçà des demandes des travailleur-euses, tout en mettant délibérément le frein sur la mobilisation à chaque pas. Les syndiqués visaient des augmentations salariales de 13,5% sur trois ans; les dirigeants syndicaux ont accepté 5,25% sur cinq ans! Les travailleur-euses, en l’absence d’une solution de rechange, ont accepté à reculons cette « entente », certains syndicats tentant d’étirer la lutte malgré la capitulation, mais en vain. Ce n’est donc pas « l’apathie quasi totale » des masses qui a causé la défaite contre l’austérité, mais avant tout la direction conciliatrice du mouvement.
Finalement, la conclusion cynique de l’article est une appréciation superficielle et erronée des processus qui se développent au sein de la jeunesse. Si, en surface, la jeunesse semble apathique, c’est simplement parce que la radicalisation de celle-ci ne trouve pas actuellement une forme d’expression politique. La jeunesse et les travailleur-euses du Québec ne sont pas immunisés contre la radicalisation croissante que l’on observe tout autour du monde. Le Québec, comme ailleurs, regorge de jeunes qui souhaitent sincèrement lutter contre l’austérité et même contre le capitalisme, et ce désir de se battre trouvera un jour ou l’autre une forme d’expression. La classe ouvrière et la jeunesse québécoises possèdent une riche tradition de lutte. Tandis que la crise du capitalisme se poursuit, tôt ou tard, la lutte des classes reprendra ses droits.
Mais que nous apprend l’expérience de 2012? Les leaders de la CLASSE étaient loin devant la plupart des leaders des mouvements que nous avons vus tout autour du monde. Particulièrement au début, ils ont expliqué les enjeux dans leur contexte général et ont inspiré les masses. Mais malgré tout leur héroïsme, leur leadership a défailli à plusieurs égards dans le feu de la lutte. Ce n’était pas la volonté, la passion ou l’enthousiasme qui manquaient, mais plutôt la justesse des idées.
En tant que participants actifs au mouvement de 2012, nous avons toujours cru que le marxisme est ce corps d’idées dont les étudiant-es et les travailleur-euses ont besoin pour mener les luttes à la victoire décisive. Ainsi, nous croyons qu’il est primordial de construire une tendance marxiste au Québec qui peut aider les travailleur-euses, les jeunes et les différentes couches opprimées à adopter les idées et les méthodes qui leur permettront de lutter et de vaincre. En ce cinquième anniversaire de la première manifestation de masse de cette lutte héroïque, nous croyons que la tâche de tous les militant-es, étudiant-es comme travailleur-euses, doit être d’étudier les leçons de 2012 afin de s’assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs, et de construire une organisation révolutionnaire qui peut jouer un rôle décisif dans les luttes à venir.