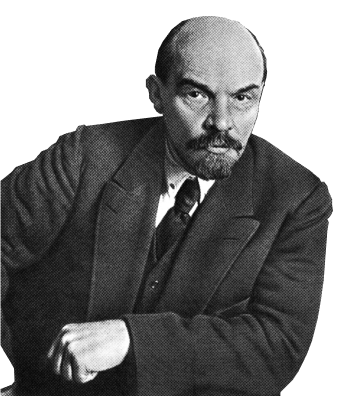Le dépôt du nouveau budget provincial s’est fait voler la vedette le 17 mars dernier. À l’issue d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), sept personnes ont été arrêtées sous des chefs d’accusation de corruption, de fraude envers le gouvernement et d’abus de confiance, dont deux ex-ministres et un ancien directeur de cabinet libéraux ainsi qu’un ancien attaché politique de Pauline Marois. Ce coup d’éclat, quelques mois après le torpillage du rapport de la Commission Charbonneau, vient vivement rappeler aux travailleur-euses québécois la profonde corruption de l’ensemble de la classe politique. Pour l’UPAC, la corruption serait même un problème « systémique ». Or, loin d’être un problème pour l’État capitaliste, la corruption est son mode de fonctionnement.
La commission Charbonneau et la corruption au Québec
Cela fait longtemps que la corruption des partis politiques au Québec et au Canada est un secret de polichinelle. Déjà en 2004, le scandale des commandites avait éclaboussé le Parti libéral du Canada, qui ne s’en est relevé que parce que les conservateurs de Stephen Harper ont réussi à se faire haïr encore plus des Canadien-nes. Puis, suite aux révélations de l’émission Enquêtes à partir de 2009, le gouvernement libéral de Jean Charest n’eût finalement plus le choix en 2011 de mettre sur pieds d’abord l’UPAC et enfin la commission Charbonneau, menée par la juge France Charbonneau assistée par l’ancien vérificateur général du Québec Renaud Lachance, pour enquêter sur les allégations de corruption et de collusion dans l’octroi de contrats publics.
Les enquêtes de l’UPAC avaient déjà mené à l’arrestation de plusieurs gros noms du monde municipal, ainsi que d’une foule d’avocats, ingénieurs et entrepreneurs divers. La politique municipale a été particulièrement affectée, avec la démission du maire de Montréal Gérald Tremblay sur fond d’allégations de corruption, suivie de l’arrestation de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt et du maire de Montréal Michael Applebaum. Déjà, l’ex-ministre libéral de la Famille Tony Tomassi avait été reconnu coupable de fraude en 2014. Toutefois, cette fois-ci, la classe politique provinciale est touchée au plus haut niveau, avec l’arrestation de l’ex-vice première ministre Nathalie Normandeau et de son ancien chef de cabinet Bruno Lortie, ayant servis sous le gouvernement de Jean Charest, ainsi que de l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté et du péquiste Ernest Murray, ancien attaché politique de Pauline Marois.
En réaction à ces arrestations, le premier ministre Philippe Couillard a affirmé diriger un parti avec une « pratique exemplaire en financement politique », soutenant qu’un tel financement illégal relève d’une « autre époque de la politique au Québec ». Il est probable que les dirigeants du PLQ aient pris peur suite à la mise sur pieds de l’UPAC et de la commission Charbonneau et aient resserré leurs pratiques de financement en attendant que les projecteurs se détournent. Il oublie toutefois de mentionner que près de la moitié de son cabinet faisait aussi parti du cabinet de Jean Charest. Aussi, Nathalie Normandeau agissait encore comme conseillère du PLQ lors de la campagne électorale qui l’a porté au pouvoir. Sans compter que Sam Hamad, le nouveau président du Conseil du trésor, a déjà été vice-président au « développement des affaires » (autrement dit solliciteur de contrats) chez Roche, firme de génie-conseil reliant les sept accusés et impliquée de long en large dans les enquêtes de l’UPAC et de la commission Charbonneau. Le PLQ s’est probablement débarrassé des éléments les plus compromis par ses campagnes de financement passées, mais la caste politicienne et ses amis dans les grands bureaux d’avocats, les firmes de génie-conseil, les banques et les industries restent largement les mêmes.
Après quatre ans d’enquêtes, la commission Charbonneau avait été une déception. Ses conclusions n’avaient que confirmé timidement ce que tout le monde savait déjà, c’est-à-dire qu’« un lien […] unissait le versement de contributions à des partis politiques provinciaux et le processus d’octroi de contrats publics ». Mais le rapport parlait plutôt de liens « indirects », et ne blâmait personne en particulier. Or, une première version du rapport adressait des reproches précis à près de 200 personnes et entités, notamment le PQ et le PLQ, l’ex-première ministre Pauline Marois et l’ex-ministre libérale Line Beauchamp. Il est probable que le sort subi par le rapport Gomery sur le scandale des commandites, qui s’était retrouvé embourbé dans des procédures judiciaires jusqu’à son rejet définitif par la Cour d’appel fédérale en 2010, ait poussé la commissaire Charbonneau à préférer être prudente.
Comme si ce n’était pas assez, le commissaire Renaud Lachance avait réussi à saboter le rapport en présentant une dissidence qui épargnait miraculeusement le PLQ. Celle-ci réfutait l’existence d’un lien même indirect entre le financement politique et l’octroi de contrats publics. Cela n’a rien de surprenant, venant de quelqu’un qui n’a rien vu de ce qui se passait sous son nez pendant ses sept ans au poste de vérificateur général. Le troisième commissaire étant décédé avant la fin de l’enquête, sa dissidence a fortement affaibli les conclusions du rapport. Les libéraux ont sauté sur l’occasion pour rejeté le rapport du revers de la main. L’émission Enquête a ensuite révélé les notes préliminaires du commissaire Lachance, où on constate qu’il a tenté de se porter à la défense de Nathalie Normandeau. Particulièrement intéressante est une note où il affirme qu’« il ne faut avoir rien vécu dans sa vie pour écrire » que le copinage entre dirigeants de firmes privées et haut-placés du gouvernement est inapproprié. Là-dessus, nous devons lui donner raison : il faut être bien naïf pour penser que les rapports incestueux entre politiciens et hommes d’affaires ne font pas partis du quotidien des États capitalistes.
La corruption est la logique même de l’État capitaliste
La juge Charbonneau, lors de la présentation de son rapport final en novembre 2015, a soutenu qu’il était important de lutter contre la corruption pour plusieurs raisons. Notamment, pour la commissaire, la pratique du financement politique occulte rend les « élus vulnérables, de différentes façons, aux influences extérieures ». Pour elle, il faut lutter contre la corruption « afin de se doter d’un Québec plus éthique et intègre ». Toutefois, la juge Charbonneau avait bien raison de le souligner : « aucune loi, aucun règlement ni aucune mesure ne réussiront, à eux seuls, à enrayer ces phénomènes ».
L’échange de privilèges entre la classe bourgeoise et ses représentants au sein de l’État est une dynamique constante au sein des États capitalistes, qui va au-delà des critères juridiques restreints de ce qui constitue de la corruption à proprement parler aux yeux de la loi. Pourtant, ce copinage n’en est pas moins une forme de corruption. D’ailleurs, la légalité ne nous apprend pas grand-chose sur la légitimité d’une pratique, étant donné la variété des pratiques acceptées entre les diverses juridictions. Il suffit de se rappeler que la décision Citizens United v. Federal Election Commission (2010) de la Cour suprême des États-Unis a aboli la limite de dépenses électorales des individus et personnes morales, affirmant ainsi carrément la légitimité de l’achat des élections par les banquiers et industriels. En comparaison, au Québec la contribution électorale maximale est depuis peu fixée à 100$ par personne par parti, et les contributions des personnes morales sont carrément interdites, ce qui n’a pourtant toujours pas empêché le méga-cabinet d’avocats Fasken Martineau d’obtenir pour 220 500$ de contrats sans appel d’offre de la Ville de Montréal après que 21 de ses employés aient contribué au parti du maire Coderre, ce qui n’a en soi rien d’illégal. En fait, le problème de la collusion entre élites politiques et élites économiques n’en est pas un de respect de la loi ou même d’éthique, mais de rôle joué par l’État.
L’État, de tout temps, loin d’être un arbitre neutre placé au-dessus de la société, est l’outil de domination d’une classe sur une autre. Les travailleurs-euses ayant des intérêts fondamentalement opposés à ceux de leurs employeurs, le conflit de classes constant doit être étouffé. Les patrons ont donc besoin de la machine d’État pour appliquer leurs règles et leurs décisions à coups de matraques grâce à la police, aux prisons et aux tribunaux. Le printemps 2012, où le gouvernement libéral de Jean Charest a dû recourir à la violence policière et à de graves répressions des libertés démocratiques pour forcer les étudiant-es à avaler une partie du coût de la crise de 2008, n’en est qu’un exemple parmi tant d’autres. L’État constitue donc simplement en son essence « des détachements spéciaux d’hommes armés », d’après les mots d’Engels, qui n’a d’autre fonction que d’asseoir les intérêts des riches et des puissants.
Toutefois, à ces hommes armés s’est greffée, au fil du développement du capitalisme, une bureaucratie servant à gérer la collecte des taxes et impôts, et éventuellement à administrer les infrastructures nécessaires à la circulation efficace des marchandises ainsi que les programmes sociaux arrachés par les travailleur-euses. Considérant que l’appareil d’État appartient à la classe capitaliste, il ne reste plus pour ces commanditaires réels de l’État qu’à s’approprier l’énorme manne constituée des fonds grugés des travailleur-euses via le système fiscal et des contrats publics nécessaires au maintien des infrastructures et programmes sociaux. La corruption directe des élus et haut-fonctionnaires n’est qu’une manière pour les capitalistes moins scrupuleux de s’arroger une plus grande part de cette manne que leurs compétiteurs.
Afin de garder une apparence de neutralité, l’État démocratique nous donne le privilège de choisir une fois aux quatre ans lequel des représentants des patrons et des banquiers administrera leurs affaires et nous crachera au visage. Les mesures proposées par la commission Charbonneau pour lutter contre la corruption pourraient peut-être aider à réduire l’arbitraire dans l’octroi des contrats publics, ce qui serait évidemment souhaitable, mais ne pourraient modifier l’allégeance des partis et des haut-fonctionnaires envers la classe qui les commandite. En effet, le système politique et l’État dans leur ensemble sont basés sur une forme de corruption : pour gagner la loyauté de ce gigantesque appareil bureaucratique et de ses représentants au sein de la législature, la classe capitaliste doit assurer le maintien d’un système d’échange de privilèges.
Sinécures et portes-tournantes
La mécanique de fond de la corruption au sein du capitalisme se présente d’une manière plus subtile que le simple échange d’enveloppes brunes. Essentiellement, elle se décline sous la forme d’un échange constant de faveurs et d’une logique de portes-tournantes entre le privé et le public. D’abord, il arrive souvent que des capitalistes fassent le saut en politique le temps d’avancer l’agenda de leur classe sociale; qu’il suffise de penser aux banquiers comme Carlos Leitão et hommes d’affaires comme Bill Morneau à la tête des ministères des Finances, ou même à la présence du magnat de la presse Pierre Karl Péladeau à la direction du PQ ou du multimillionaire François Legault à la tête de la CAQ. Aussi, le parti au pouvoir obtient le privilège de répartir les bons postes de haut-fonctionnaires, d’administrateurs, et autres bureaucrates surpayés entre ses amis, collaborateurs et loyaux serviteurs. Le Sénat est peut-être l’exemple le plus évident de ces postes-cadeaux. Ironiquement, le même jour que l’arrestation des sept soupçonnés de corruption, le premier ministre Justin Trudeau nommait sept nouveaux sénateurs, dont le journaliste André Pratte, meneur de claque du capitalisme canadien de longue date. Finalement, pour s’assurer la loyauté des politiciens et haut-fonctionnaires, les banques, grands cabinets d’avocats, firmes d’ingénieurs, grosses industries, etc. font miroiter la possibilité pour ceux ayant bien servis leurs intérêts d’obtenir des sinécures au privé en tant que lobbyistes, conseillers, administrateurs, consultants, etc.
Les rapports incestueux entre les grandes firmes privées et les politiciens sont une constante dans la vie politique québécoise et canadienne. Un rapport de Québec Solidaire de 2013 fait état des liens entre une dizaine d’anciens ministres et premiers ministres québécois et différentes industries. Notamment, André Boisclair, ancien ministre de l’Environnement, devenu consultant pour une entreprise de gaz de schiste albertaine; Lucien Bouchard, ancien ministre de l’environnement au fédéral et premier ministre du Québec ayant opéré le saccage des services publics québécois sous le mot d’ordre du « déficit zéro », devenu représentant de l’industrie du gaz de schiste et entretenu par l’empire Power Corporation; Philippe Couillard, devenu partenaire d’un fond d’investissement en services de santé privés un mois après sa démission du poste de ministre de la Santé en 2008. L’actuel premier ministre du Québec, supervisant présentement le sabotage du système de santé public québécois, a aussi été conseiller et administrateur pour des entreprises de biotechnologies et de pharmaceutique.
Il ne s’agit là que de la pointe de l’iceberg. Les exemples abondent. Parmi les cas les plus frappants, notons celui de Bombardier. Un an avant que le gouvernement de Philippe Couillard ne donne un milliard de dollars en « BS corporatif » à ce géant de l’aéronautique à même les impôts des travailleur-euses, nous apprenions que Raymond Bachand, ancien ministre des Finances du Québec sous Jean Charest, était devenu lobbyiste pour Bombardier. En temps d’austérité, il était bien charitable de la part des libéraux de trouver l’argent pour aider la pauvre multinationale. Bien sûr, aucun ancien ministre libéral n’ayant recours à l’aide sociale, les assisté-es sociaux, eux, n’auront droit qu’à de nouvelles coupes dans leurs chèques de misère.
On peut aussi mentionner le scandaleux renouvellement du contrat de la centrale au gaz inutilisée de Bécancour par Hydro-Québec. Cette centrale possédée par le géant de l’énergie TransCanada, censée à l’origine dépanner Hydro-Québec en période de pointe en hiver, est inutilisée depuis 2008, parce qu’Hydro-Québec avait surestimé ses besoins au moment de la première signature du contrat. Un milliards de dollars de fonds publics ont ainsi été versés à la pétrolière entre 2006 et 2016 pour un service inutilisé depuis 2008. Le contrat arrivé à échéance en 2016 a toutefois été renouvelé pour 20 ans par la direction d’Hydro-Québec, soucieuse de ne pas encore avoir jeté assez d’argent par les fenêtres. Or, il apparaît qu’une des lobbyistes et conseillère juridique principale de TransCanada au Québec était avocate pour Hydro-Québec jusqu’en août 2015.
Et que dire de l’embauche de Me Pierre Renaud, ex-président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), chez McCarthy Tétrault quelques mois après son son renvoi? L’ancien décideur de cet organisme chargé d’évaluer les impacts environnementaux des projets de construction occupe maintenant le poste « d’avocat-conseil » au « groupe du droit de l’environnement » dans le méga-cabinet d’avocats. Autrement dit, il est chargé d’aider des minières, pétrolières et autres développeurs ayant besoin d’une autorisation d’exploitation ou d’exploration à réussir le processus d’évaluation environnementale, de consultation et d’audiences publiques réalisée par l’organisme qu’il a anciennement dirigé. A-t-il été embauché à cause de ses loyaux services rendus aux grosses minières et pétrolières, ou est-ce plutôt ses entrées auprès des décideurs qui ont déterminé ce choix? Sa présence confère-t-elle un avantage « dû » ou indu aux clients du cabinet?
On le voit bien, l’échange de faveurs et de postes entre l’appareil d’État et l’entreprise privée va bien au-delà de la corruption au sens de la loi. En effet, tous ces exemples sont connus et n’ont rien d’illégal. Mais si les politiciens savent qu’après leur carrière consacrée à attaquer les conditions de vie des travailleurs et à mettre plus d’argent dans les poches des plus nantis, ils n’auront plus jamais à craindre la pauvreté et le chômage et trouveront facilement un poste confortable et bien payé, s’agit-il de corruption directe ou indirecte? Pour citer le Manifeste du parti communiste : « Le gouvernement moderne n’est qu’un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. » Celle-ci doit son contrôle de l’appareil d’État et les privilèges qu’elle en tire à sa position dominante dans l’économie. Aucune loi, règlement, ni code d’éthique, aussi sophistiqués soient-ils, ne pourront changer la nature de sa relation avec l’État. Pour les marxistes, la condition première de la lutte contre la corruption est donc l’expropriation de la bourgeoisie et le contrôle démocratique par les travailleur-euses sur les grands piliers de l’économie, ainsi que la destruction de la machine d’État au service de la classe dominante et son remplacement par un gouvernement ouvrier réellement démocratique et redevable à la majorité de travailleur-euses. Seule sur cette base pourra-t-on mettre fin au copinage et bâtir une société au service de tous et toutes plutôt que d’une poignée de privilégiés.