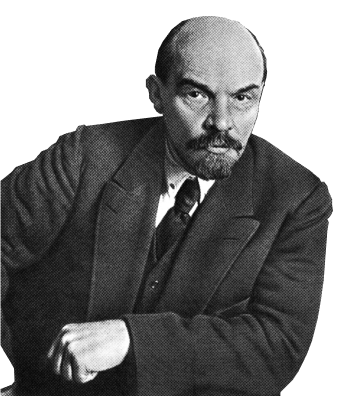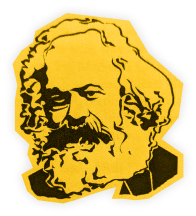Cet article a été publié dans l’édition no 22 du journal de nos camarades britanniques, The Communist (communist.red), le 26 février dernier.
La victoire électorale de Donald Trump a agi comme un coup de tonnerre, illuminant la nouvelle situation dont les contours se profilaient déjà depuis un certain temps.
Le retour de Trump à la Maison-Blanche confirme indéniablement que ce que l’on appelle le « wokisme » est méprisé par la majorité des gens, qu’il a été rejeté et qu’il n’a que peu d’influence.
Le mot « woke » n’est pas un terme précis et scientifique. Mais il fait généralement référence aux politiques identitaires qui prétendent combattre les différentes formes d’oppression, comme le racisme et le sexisme, par des moyens tels qu’adopter des quotas, changer notre façon de parler et faire de la sensibilisation.
Autrement dit, les partisans des politiques « woke » cherchent à « combattre » l’oppression sur une base individualiste, tout en rejetant complètement toute idée de lutte des classes et toute analyse de l’oppression comme étant enracinée dans la société capitaliste.
Les marxistes et les communistes, en revanche, luttent contre toutes les formes d’oppression, mais avec des méthodes fondées sur la lutte des classes.
Comment le « wokisme » est-il devenu un courant dominant?
Étant donné l’individualisme petit-bourgeois qu’il reflète, le « wokisme » a toujours été impopulaire. Mais ces dernières années, les politiques identitaires « woke » sont devenues tout à fait courantes dans le monde occidental. Par conséquent, dans l’esprit de millions de personnes, le « wokisme » est fortement associé à l’establishment.
Comme nous l’avons expliqué ailleurs, les politiques identitaires se sont développées parallèlement à l’essor de la philosophie « postmoderne » à partir des années 1960. Au cours des décennies suivantes, elles ont été fortement promues et adoptées par une partie de la classe dirigeante. En conséquence, dans les années 1990 et 2000, le postmodernisme et les « politiques identitaires » sont devenus des idéologies dominantes.
Deux facteurs interreliés ont rendu cela possible : d’une part, la défaite d’une série de révolutions et de luttes ouvrières au cours de cette période, en raison des trahisons des dirigeants réformistes et staliniens; d’autre part, la montée à la même époque des mouvements de « libération » basés sur les politiques identitaires, en particulier aux États-Unis.
Le stalinisme a diffusé une caricature très mécanique du marxisme et a épousé un réductionnisme de classe grossier, omettant d’aborder les questions d’oppression.
Ces échecs et la fausseté évidente des idées staliniennes ont poussé une couche d’intellectuels radicaux à s’éloigner du marxisme et de la classe ouvrière pour se tourner vers le postmodernisme petit-bourgeois.
Le postmodernisme et ses dérivés – y compris les politiques identitaires, l’intersectionnalité et la théorie queer – ont toujours représenté une philosophie complètement petite-bourgeoise, reflétant l’individualisme et l’impuissance de cette classe.
Une couche d’intellectuels petits-bourgeois, ne regardant plus vers le marxisme, a vu dans les mouvements dits de « libération » – basés sur l’identité et l’oppression (pour les Noirs, les femmes, les LGBT, etc.), et non sur l’exploitation économique de classe – la réponse aux problèmes du capitalisme.
En tant que petits-bourgeois, ils n’étaient pas intéressés à comprendre le fait que la société capitaliste dans son ensemble forme le socle sur lequel reposent les oppressions comme le racisme, ni à comprendre que le moyen de mettre fin à l’oppression est d’unir la classe ouvrière pour renverser le capitalisme.
Au contraire, ils étaient désireux de promouvoir une vision subjective du monde à partir de différents « récits » et « expériences vécues ». Selon ce point de vue, chaque identité – comme celle des Noirs ou des femmes – est fondamentalement différente de toutes les autres. Par ailleurs, seules les personnes partageant une telle identité peuvent comprendre leur oppression et la combattre réellement.
Surtout, de telles identités ne sont pas perçues comme comportant des contradictions de classe. Cela a permis à des « leaders communautaires » petits-bourgeois et autoproclamés de parler au nom de leur groupe identitaire dans son ensemble. Cette couche a joué un rôle essentiel dans la promotion active des politiques « woke », parce qu’elles servent leurs intérêts, même si elles ne s’attaquent pas du tout au racisme et au sexisme en général.
Ainsi, en prônant la « diversité » au sommet, ces personnes ont obtenu une « représentation » pour elles-mêmes – en obtenant des positions privilégiées sur la base de leur identité, sans rien faire pour remédier à l’oppression et à l’inégalité plus générales dans la société. La montée du féminisme « girlboss », qui vise à faire entrer davantage de femmes dans les conseils d’administration des entreprises, reflète l’apogée de cette tendance.
Les politiques identitaires sont donc une idéologie profondément individualiste, qui nie l’existence d’une réalité objective commune à laquelle tous les individus appartiennent et qu’ils peuvent comprendre.
Au lieu de cela, chaque individu est défini abstraitement comme appartenant à divers groupes basés sur l’identité, partageant une conception du monde et un ensemble d’intérêts communs uniquement avec d’autres personnes de leur identité.
Au mieux, dans ce cadre, la classe économique d’une personne est simplement considérée comme une autre forme d’identité, plutôt que comme le clivage fondamental au sein de la société. Quant à eux, les antagonismes de classe entre les patronnes et les travailleuses, ou entre un employeur noir et ses employés, par exemple, sont passés sous silence.
Au fil du temps, cette idéologie a été promue par une partie importante de la classe dirigeante des pays occidentaux, en particulier aux États-Unis. Cela s’explique par le fait que cette aile de l’establishment a compris, à juste titre, que les politiques identitaires étaient un rempart contre les idées révolutionnaires et un outil précieux diviser la classe ouvrière et détruire la conscience de classe.
Ces dernières années, ce phénomène est devenu un courant dominant, au point d’apparaître comme l’idéologie officielle de la société capitaliste occidentale.
Lorsque de véritables mouvements contre le racisme et le sexisme ont pris leur essor, comme Black Lives Matter ou #MeToo, ils ont rapidement été récupérés par l’establishment libéral et les grandes entreprises et cyniquement détournés vers des canaux sûrs à l’aide des politiques identitaires.
Les grandes entreprises, par exemple, ont fait grand cas de leur « diversité » et de leur « inclusivité », tout en ne faisant rien pour améliorer plus généralement les salaires et les conditions de travail des travailleurs.
Ces mesures sont de plus en plus vues pour ce qu’elles sont : de simples gestes symboliques. Entre-temps, la classe dirigeante a continué à s’attaquer aux conditions de vie de la classe ouvrière.
Cela a permis à des personnalités politiques comme Trump, bien que milliardaires, de se présenter de façon plausible comme des ennemis de l’establishment en s’attaquant au « wokisme ».
D’autre part, lors des dernières élections américaines, Trump a été la seule personnalité politique à aborder, à sa manière, les questions qui sont à l’origine de tant de colère de classe aux États-Unis.
Il a promis de réduire l’inflation et les taux d’intérêt, de ramener des emplois bien rémunérés aux États-Unis et de mettre fin aux guerres en Ukraine et à Gaza.
Même le soutien à ses politiques anti-immigration, d’une manière très déformée, reflète cette colère de classe : contre le manque d’emplois décents, de places dans les écoles, de logements, etc., – des problèmes que Trump, bien sûr, impute aux immigrants.
Ce qui a été remarquable lors de l’élection présidentielle, c’est qu’il y a eu un basculement en faveur de Trump parmi les électeurs noirs et latinos et chez les femmes. En général, cela s’explique par les promesses qu’il a faites en matière d’économie et par le dégoût que ces couches éprouvent à l’égard des démocrates.
Les capitalistes sentent le vent tourner
La victoire de Trump a été largement vue comme le coup de grâce contre ce « wokisme » déjà profondément impopulaire. Tout le monde a remarqué que l’empereur est nu, que ce ne sont pas seulement eux et leurs amis qui détestent les absurdités du « wokisme », ou une frange de l’extrême droite, mais la majeure partie de la société.
C’est en tout cas certainement ainsi que les capitalistes ont compris la dernière victoire électorale de Trump.
L’exemple le plus marquant est la prosternation de Mark Zuckerberg devant Donald Trump. Ce grand patron de la tech a récemment publié une déclaration exprimant ouvertement les calculs cyniques de toute sa classe concernant la « guerre culturelle ».
« Le paysage juridique et politique entourant les efforts de diversité, d’équité et d’inclusion aux États-Unis est en train de changer », a affirmé le fondateur de Facebook. Autrement dit : nous, hommes d’affaires, n’avons d’autres principes que de gagner le plus d’argent possible, et nous devons donc nous adapter à la direction dans laquelle le vent souffle.
C’est pourquoi Meta mettra fin à son programme de « vérification des faits », laissant libre cours à la diffusion de contenus racistes sur ses plateformes. Meta met également fin au programme « diversité, équité et inclusion » (DEI) de l’entreprise.
La DEI est l’ensemble des politiques que les entreprises et les gouvernements sont censés mettre en place pour garantir bureaucratiquement le « bon » degré de diversité en leur sein. Il s’agit peut-être de la politique la plus concrète des politiques identitaires, qui est devenue la norme dans de nombreuses entreprises américaines. Y mettre fin est donc une attaque directe contre le « wokisme ».
Suite à cela, Zuckerberg est apparu sur le podcast de Joe Rogan pour se plaindre de la nature trop « féminine » des lieux de travail de nos jours, plaidant pour plus d’« énergie masculine ».
Ce qui est significatif, c’est que le dirigeant de Meta s’est non seulement senti à l’aise de faire de tels commentaires, mais qu’il a en fait estimé qu’il était dans son intérêt de briser un tabou et de parler ouvertement du bien-fondé de la domination masculine (c’est-à-dire de l’« énergie masculine »). Cela aurait été impensable pour un PDG aussi célèbre que lui il y a seulement un an.
Cette même « libération » des normes du « wokisme » se répand dans l’ensemble de la classe capitaliste. Le Financial Times a même publié un article intitulé « Is Corporate America going Maga? » (« Les grandes entreprises américaines sont-elles en train de virer MAGA? »), dans lequel il est écrit :
« Même la façon dont les gens de Wall Street parlent et interagissent est en train de changer. Les banquiers et les financiers affirment que la victoire de Trump a enhardi ceux qui s’irritaient de la “doctrine woke” et qui estimaient devoir s’autocensurer ou modifier leur langage pour éviter d’offenser leurs jeunes collègues, les femmes, les minorités ou les personnes handicapées. »
« Je me sens libéré », a déclaré un banquier de haut rang au journal. « Nous pouvons dire “attardé” et “chatte” sans craindre d’être cancellé… c’est une nouvelle aube. » Des paroles édifiantes, quoi.
Le même article souligne que ce changement chez les capitalistes n’est pas simplement une tentative de plaire à Trump, mais reflète la prise de conscience d’un rejet général du « wokisme » dans la société :
« Les entreprises, les hauts cadres et les analystes affirment que les motivations à l’origine de ces changements sont complexes et vont bien au-delà d’un simple désir de plaire au nouveau président. L’humeur de leurs clients a changé, affirment les cadres. »
Un autre signe de cette nouvelle confiance des capitalistes envers le rejet du « wokisme » est le documentaire qu’Amazon prévoit de produire sur Melania Trump. Ce documentaire sera produit par Melania elle-même, il s’agira donc d’une hagiographie.
Jusqu’à très récemment, c’était impensable : tous les films biographiques réalisés par de grandes sociétés médiatiques et présentant leurs sujets sous un jour positif portaient sur des célébrités ostensiblement progressistes – souvent des personnes issues de minorités présentées comme des précurseurs et des modèles positifs.
Pour bien montrer qu’Amazon est désormais « anti-woke », le documentaire sera réalisé par Brett Ratner, qui a été accusé d’inconduite sexuelle par de nombreuses femmes.
L’abandon du programme DEI par Meta a été suivi par Walmart, qui a cessé de prendre en compte la race et le sexe dans l’attribution des contrats avec ses fournisseurs, a mis fin à la formation du personnel en matière d’équité raciale et ne renouvellera pas son financement du Center for Racial Equity, qui avait été mis en place grâce à un don de 100 millions de dollars après les manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd.
McDonald’s a également abandonné ses objectifs d’embauche d’une certaine proportion de femmes et de personnes non blanches à des postes de direction. Amazon fait de même, tout comme JPMorgan Chase et BlackRock.
Le recul de la « diversité » et de la propagande politique et publicitaire superficiellement progressiste se transforme en une véritable ruée. Elon Musk, l’acolyte milliardaire de Trump et directeur du DOGE (Department of Government Efficiency; Département de l’Efficacité gouvernementale), mène la charge. Il utilise la « guerre contre le wokisme » comme couverture pour purger l’État américain des opposants au mouvement MAGA et pour réduire les dépenses fédérales.
Par ailleurs, les grands patrons sont tellement désireux de rentrer dans le rang et de se débarrasser de la « souillure woke » qu’on rapporte que des sociétés de relations publiques sont payées pour supprimer des déclarations ouvertement « woke » des sites internet des entreprises.
Bien entendu, ces capitalistes ont également un intérêt matériel à supprimer les programmes DEI et d’autres politiques connexes. Pour eux, ces mesures représentent une paperasserie supplémentaire et coûteuse : une réglementation contraignante qui rogne leurs profits.
Trump contre l’establishment
Les capitalistes se débarrassent des politiques DEI aussi facilement qu’on change de chaussettes.
Ce revirement risque d’enhardir les réactionnaires extrémistes et les policiers racistes, ce qui rendra plus probables les provocations contre les Noirs et les minorités à l’avenir. Mais la première réaction de la plupart des travailleurs à l’abandon des mesures symboliques « woke » sera de hausser les épaules avec indifférence.
En même temps, l’élection de Trump a déclenché une lutte entre une poignée de francs-tireurs MAGA et l’establishment libéral.
Les premiers utilisent une rhétorique « anti-woke » pour mener cette bataille, tout en s’appuyant sur la colère des masses dans la société. L’establishment quant à lui se cache derrière une phraséologie libérale hypocrite, tout en défendant la vieille politique de l’impérialisme américain et la bureaucratie de l’État capitaliste.
Cela représente un tournant historique. Mais il est superficiellement déguisé en une simple question opposant les « woke » aux « anti-woke ».
Trump attaque des institutions comme l’USAID (l’agence américaine pour les programmes d’aide internationale) en les qualifiant de « woke », et licencie des bureaucrates de l’État pour leur « mollesse sur la question trans ». Les libéraux défendent alors le prétendu « humanitarisme » de l’USAID, et disent qu’ils défendent les personnes trans dans l’armée, etc., tout en défendant en réalité la position dominante de la classe dirigeante.
Nous devons trancher ce nœud gordien et discerner ce qui se passe réellement derrière l’apparence des choses.
Ces deux camps sont réactionnaires. Cependant, au milieu de tout cela, il est clair que le rejet public du wokisme reflète un rejet de l’establishment libéral; un rejet des politiques identitaires petites-bourgeoises qu’une aile de la classe dirigeante a adoptées et poussées afin de couper court à la conscience de classe et à la lutte des classes. Et cela est une bonne chose.
La « gauche » n’a rien à offrir
Les politiques identitaires ont pris de l’ampleur au cours des dernières décennies en raison des échecs et de la démoralisation de la gauche. Les vagues révolutionnaires de l’après-guerre telles que mai 1968 et les luttes de classe des années 1970 n’ont pas réussi à renverser le capitalisme. Le stalinisme s’est effondré.
En conséquence, au cours de la dernière période, la classe ouvrière a souffert d’un profond manque de direction. Les inégalités se sont considérablement accrues, mais il n’y a pas eu de véritable point de référence offrant une solution de rechange.
En guise de substitut à un programme de classe anticapitaliste, les dirigeants de la « gauche » – si l’on peut les appeler ainsi – se sont tournés vers les politiques identitaires au cours de cette période. Les quotas de discrimination positive sont bon marché, après tout, alors que le financement de programmes d’aide sociale à grande échelle ne l’est pas.
À la base, cela reflète le manque de confiance des réformistes de gauche dans la classe ouvrière et sa capacité à transformer la société. Au lieu de prôner les méthodes de la lutte des classes et des mesures socialistes audacieuses, la soi-disant « gauche » s’est limitée à des politiques « progressistes » qui sont – ou ont été, jusqu’à présent – plutôt acceptables pour la classe dirigeante.
Les politiques « woke » ont ainsi acquis une « connotation » de gauche. Parce que cet état de fait dure depuis des décennies, aux yeux de nombreux travailleurs, la « gauche » en est venue à être associée au « wokisme », c’est-à-dire au snobisme de militants issus de la classe moyenne qui s’autoproclament plus « éclairés » que les autres et qui réprimandent avec condescendance les gens ordinaires parce qu’ils n’utilisent pas les bons mots.
La gauche est perçue comme étant en faveur d’un traitement préférentiel et d’emplois réservés, de logements sociaux, etc., pour les minorités, tout en ne faisant rien pour remédier au fait que les conditions des travailleurs ne cessent de se dégrader, en raison du capitalisme et de ses crises interminables.
Ainsi, Trump peut non seulement présenter le « wokisme » comme venant de l’establishment, mais aussi comme étant de gauche. C’est pourquoi on entend parfois des accusations saugrenues prétendant que des institutions impérialistes comme l’USAID, voire les grandes banques, regorgeraient de « marxistes et de radicaux ».
Après la victoire de Trump, bien des gens à gauche semblent avoir compris qu’embrasser le « wokisme » au lieu des politiques de classe est fatal.
Cette prise de conscience a été résumée dans le titre d’un article récent du Guardian écrit par l’éditorialiste John Harris : « La victoire de Trump envoie un message simple et impérieux : beaucoup de gens méprisent la gauche ».
La plupart des personnalités de « gauche » qui s’en rendent compte sont toutefois incapables de faire quoi que ce soit avec cette prise de conscience. En fin de compte, ils restent attachés à l’idée qu’il n’y a pas de solution de rechange au capitalisme.
Tel est le problème sous-jacent : le capitalisme est dans une crise profonde; il ne peut rien offrir de plus à la classe ouvrière que l’austérité, et les réformistes n’ont donc tout simplement rien à offrir. La crise du capitalisme est donc une crise du réformisme.
Dans le meilleur des cas, le rejet du « wokisme » par l’une ou l’autre de ces « gauches » les verra mettre en avant un vague langage socialiste, tout en restant aussi enclins à la capitulation qu’auparavant. Au pire, ils glisseront de l’autre côté de la guerre culturelle et penseront que le moyen de gagner les travailleurs est simplement d’être « anti-woke », c’est-à-dire d’être ouvertement réactionnaire et raciste.
L’absence persistante d’une véritable gauche signifie en retour que le rejet massif du « wokisme » ne fera qu’apporter de l’eau au moulin des escrocs réactionnaires tels qu’Elon Musk et Donald Trump.
Aux États-Unis, Trump met en place des politiques extrêmement réactionnaires, et il ne fait aucun doute que d’autres suivront. Des individus et des organisations racistes et sexistes lanceront des attaques contre les groupes opprimés, estimant qu’ils peuvent s’en tirer impunément.
C’est ce que signifiera la fin du « wokisme », en l’absence d’une solution de rechange de classe claire.
Retour de flamme et lutte des classes
Trump et consorts se sentent invincibles. Ils sont en fait trop sûrs d’eux et commettront par conséquent de nombreuses erreurs. Ils ne comprennent pas que le rejet massif des politiques identitaires ne signifie pas que leurs politiques racistes suscitent un engouement populaire.
Oui, de nombreux travailleurs méprisent le « wokisme ». Certains pensent qu’il y a trop d’immigration. Mais cela reste superficiel. La plupart des travailleurs ne sont pas racistes. Ils cherchent plutôt un moyen de sortir de la crise sans fin du capitalisme : la pénurie aiguë d’emplois bien rémunérés et de logements abordables et, en Amérique, l’épidémie de toxicomanie, qui frappe durement.
Pendant longtemps, il n’y a pas eu de gauche avec un programme sérieux sur des questions telles que l’emploi, le logement et les services sociaux. Par conséquent, de nombreux travailleurs voteront pour un homme politique qui affirme vouloir réduire l’immigration afin d’offrir davantage de logements aux travailleurs d’ici.
Trump, Musk et d’autres découvriront avec horreur que leur popularité ne tient qu’à un fil et ne durera pas. Au pouvoir, les populistes de droite devront gérer une crise croissante du capitalisme. Dans le cas de la nouvelle administration Trump, ses propres politiques chaotiques risquent fort de déclencher une grave crise économique.
Sous la bannière de la lutte contre le « wokisme », nous pouvons nous attendre à ce que Trump adopte d’autres politiques qui attaquent directement la classe ouvrière : des attaques contre les travailleurs du secteur public, contre les migrants, et ainsi de suite, tandis que les retombées économiques de ses autres politiques en faveur des grandes entreprises alimenteront un climat de colère.
Il est tout à fait possible que leurs attaques hubristiques et irréfléchies déclenchent des manifestations de masse, y compris des mouvements contre le racisme et le sexisme.
Nous devons nous opposer aux politiques de Trump sur une base de classe. En même temps, nous devons démasquer les libéraux et les démocrates, qui ont eux-mêmes établi de nouveaux records de déportations sous Biden, et qui mènent des attaques similaires contre les travailleurs – bien que derrière un masque souriant et hypocrite.
Au fur et à mesure que la crise du capitalisme s’aggrave, les luttes de classes s’intensifieront et occuperont de plus en plus le devant de la scène, coupant court à la guerre culturelle et à tout le fiel empoisonné que la classe dirigeante fomente autour de l’immigration, et rassemblant les travailleurs sur une base de classe.
Sous les coups de boutoir des événements, les travailleurs qui ont aujourd’hui des préjugés superficiels canaliseront demain leur colère contre les patrons, la classe dirigeante et ses représentants.
En outre, parce qu’une couche se radicalise vers la gauche, réalisant que les politiques « woke » sont devenues profondément impopulaires et ne sont pas progressistes, il existe également un potentiel de durcissement de la conscience à l’encontre de Trump.
Autrement dit, beaucoup de ceux qui s’opposent à Trump et à son programme capitaliste réactionnaire concluront à juste titre qu’ils doivent le faire non pas en adoptant une politique « woke », mais une politique de classe.
D’autre part, les démocrates et autres libéraux tenteront d’utiliser la présidence de Trump et ses erreurs pour réparer leur image, en se présentant comme les meneurs d’une riposte.
Les travailleurs et les jeunes doivent totalement refuser de les suivre. C’est le libéralisme de l’establishment et la promotion cynique des politiques identitaires qui sont responsables de la seconde victoire de Trump.
Il n’est même pas vrai que ces libéraux représentent un « moindre mal ». Ce sont les démocrates qui ont armé et soutenu le génocide à Gaza, qui ont provoqué la guerre en Ukraine et qui défendent l’austérité. Les libéraux et les réactionnaires déclarés sont les deux faces de la même médaille capitaliste.
Guerre des classes contre guerre culturelle
Le « wokisme » doit être rejeté catégoriquement. Non seulement il s’est aliéné la classe ouvrière et n’a offert aucune solution à ses problèmes, mais il a également échoué selon ses propres termes. Par exemple, le Center for American Progress rapporte que :
« Le rapport entre la richesse moyenne des Noirs et la richesse moyenne des Blancs n’a jamais dépassé les 21,6% de 1992. D’une manière générale, le scénario le plus favorable des 30 dernières années s’est produit lorsque les Noirs avaient environ un sixième de la richesse médiane des Blancs en 1998.
Mais à la suite de la Grande Récession, qui a duré de 2007 à 2009, les États-Unis ont vu l’écart de richesse entre les Noirs et les Blancs augmenter fortement et s’éloigner encore plus de ce meilleur scénario. »
Autrement dit, au cours de la période où les politiques « woke » sont devenues courantes et où les programmes DEI inspirés par les politiques identitaires ont proliféré, il n’y a eu aucune réduction de l’inégalité raciale.
Au Royaume-Uni, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes n’a pratiquement pas bougé après des décennies de législation imposant un salaire égal pour un travail égal. En janvier, le National Audit Office a signalé une « épidémie de violence à l’encontre des femmes et des jeunes filles au Royaume-Uni », et la situation ne fait qu’empirer.
Ces sombres statistiques reflètent le fait que le capitalisme engendre les inégalités et l’oppression et qu’elles ne peuvent être combattues par une législation impuissante inspirée par le « wokisme », comme les politiques de discrimination positive et les quotas.
Il n’est donc pas étonnant que les politiques « woke » soient profondément impopulaires, même parmi les minorités qu’elles sont censées servir. C’est en grande partie la raison pour laquelle Kamala Harris a obtenu de moins bons résultats auprès des électeurs noirs et latinos et des femmes que même Joe Biden.
Il faut donc non seulement rejeter le « wokisme », mais y renoncer sur une base de classe indépendante. La voie à suivre pour les exploités et les opprimés ne passe pas par une « guerre contre le wokisme » réactionnaire, telle que la mènent Trump, Nigel Farage et consorts, mais par une guerre de classe contre tous les milliardaires et les banquiers, et leur système pourri.
Les marxistes s’opposent à toute discrimination et à toute oppression, qui sont inhérentes au capitalisme et qui ne servent qu’à diviser la classe ouvrière.
La seule façon de mettre véritablement fin à l’oppression est d’unir la classe ouvrière de tous horizons contre le système capitaliste dans son ensemble, de le renverser et de le remplacer par un plan de production socialiste qui réponde aux besoins de tous les membres de la société. Ce n’est qu’à cette condition que l’on éliminera la base matérielle des préjugés et de l’oppression.
La période à venir sera marquée par des turbulences politiques et économiques extrêmes. Il s’agit d’une époque de guerres et de révolutions. Le mécontentement atteint déjà des niveaux record, et c’est précisément ce qui a propulsé Trump au pouvoir. Or, non seulement le règne de Trump ne pourra pas satisfaire ce mécontentement, mais la crise économique qui le sous-tend s’aggravera.
Armés de cette perspective, nous devons construire une puissante organisation révolutionnaire qui rejette les politiques de division petites-bourgeoises que le « wokisme » représente, qui leur déclare ouvertement la guerre du point de vue de l’unité de classe révolutionnaire et qui offre aux travailleurs et aux jeunes une véritable solution de rechange aux injustices, à la pauvreté et à l’insécurité qui sont la marque du capitalisme.
Avec une telle organisation, nous pouvons vaincre les deux camps de la soi-disant guerre culturelle.