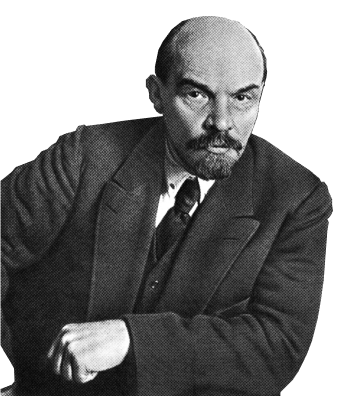L’arrivée de l’application pour téléphones intelligents Uber a chamboulé l’industrie du taxi. Lancée en juin 2009 d’abord à San-Francisco, l’application s’est répandue rapidement, et déssert aujourd’hui 300 villes répandues à travers 58 pays. Alors qu’elle offre de nombreux avantages sur les taxis traditionnels, notamment des tarifs plus bas, elle entraine de graves effets sur les conditions de travail des chauffeurs de taxi. Leur opposition à l’arrivée de l’application s’est exprimée d’une façon particulièrement marquée en France en juin dernier. Alors qu’à Paris ils bloquaient l’accès à l’aéroport, à Marseilles, Nice et Nantes, ils brûlaient des pneus çà et là dans la ville pour manifester contre la présence de Uberpop. Ces événements ne sont que les plus spectaculaires d’une série de réactions à l’arrivée du phénomène Uber partout autour du globe.
Par ses bas prix et sa technologie efficace et innovative, Uber a su prendre sa place dans l’industrie du transport et «vole» aux taxis une grande part de leur clientèle. Le meilleur exemple est San Francisco, où la moyenne mensuelle des courses par taxis a chuté de 65% depuis 2012. Toutefois, un si grand renversement sur le marché ne peut s’expliquer simplement par une application bien conçue.
Uber a su faire germer la compétition dans un domaine particulièrement archaïque. Poussées par le motif de profit aveugle du système capitaliste, et régnant sur un marché quasi-monopolistique, les grandes compagnies de taxi avaient peu de raisons d’investir pour améliorer le service pour les usagers. Plutôt que de moderniser leur système pour s’adapter à une clientèle qui évolue dans une ère technologique de téléphones intelligents et de médias sociaux, elles ont choisi de continuer à utiliser un système inefficace et obsolète.
L’attrait de la nouveauté
Uber est une système de transport qui s’inscrit dans «l’économie du partage» qui est en vogue depuis quelques années. Comme airBnB, Uber permet à son utilisateur d’éviter les canaux commerciaux habituels en se servant du net comme toile de fond pour réaliser des ententes marchandes avec d’autres usagers.
Effectivement, si vous cherchez à vous rendre quelque part avec Uber, vous n’avez qu’à vous connecter à l’application sur votre téléphone intelligent. En quelques secondes, Uber vous offrira un choix de conducteurs à proximité. Ces conducteurs sont d’autres usagers comme vous et moi, qui n’ont pas à payer de licence particulière, seulement à effectuer quelques vérifications légales et avoir un permis de conduire valide. Vous pouvez choisir votre conducteur en fonction des critiques qui lui ont été attribuées par d’autres utilisateurs, et vous-même laisser une critique après avoir fait affaire avec lui. Le prix de la course sera fixé par Uber à qui vous pourrez payer directement par carte sur votre téléphone intelligent. Après quoi, la compagnie gardera 20% de votre paiement et en transférera le reste au conducteur.
Les utilisateurs de Uber disent avoir une voiture plus rapidement, avec un meilleur service, et à un prix jusqu’à deux fois moins cher que lors d’une course de taxi traditionnelle. Pas de surprise, donc, que la compagnie née à San Francisco grandisse à une vitesse monstre et que ses services se répandent comme une trainée de poudre à travers la planète. Uber vaut aujourd’hui plus de 40 milliards de dollars.
Pas surprenant, non plus, que l’industrie du taxi s’en arrache les cheveux. À Montréal, les compagnies de taxi disent avoir perdu 30% de leur clientèle au profit de UberX.
Les chauffeurs de taxi se retrouvent donc dans le pétrin. En France, dans plusieurs villes comme Paris ou Marseilles, les chauffeurs sont syndiqués. Travailler pour Uber revient donc à contourner la représentation collective et à faire une compétition déloyale aux chauffeurs syndiqués. C’est porter atteinte à la solidarité des travailleurs qui luttent pour un meilleur salaire et de meilleures conditions. Toutefois, dans la majorité des pays, les chauffeurs de taxi ne sont pas syndiqués, loin de là. Au Canada, par exemple, leurs conditions de travail sont loin d’être reluisantes.
Un petit salaire et de longues heures
D’abord et avant tout, le système du taxi au Canada exige que les chauffeurs s’approprient une licence. Ces permis sont d’une quantité limitée selon les villes. À Montréal, il y a présentement 4437 permis de taxi en fonction.
Les chauffeurs de taxi ont donc deux choix : acheter un permis et travailler à leur compte ou louer périodiquement une voiture accompagnée d’un permis au détenteur de celle-ci.
Les limitations du nombre de licences vont de pair avec la loi de l’offre et de la demande. Beaucoup de permis disponibles signifie baisse des tarifs, compétition féroce, augmentation des contraintes pour les chauffeurs. Peu de permis disponibles signifie rareté des voitures pour les usagers, hausse des tarifs. Mais surtout, prix faramineux de la licence de taxi elle-même.
À Montréal, alors qu’en 1992 le prix d’un permis pour Montréal-centre se fixait à 25 000$, il a atteint en 2007 le sommet de 230 000$. Bien que l’organisme Fintaxi permette aux chauffeurs de se procurer des prêts facilement, ils doivent tout de même rembourser cette somme et en payer les intérêts de 10.95%. Ce sont des taux d’intérêts moins cher que ceux des banques, il est vrai, mais des taux d’intérêts tout de même.
Et comment réussissent-ils à rembourser cela? Selon Industrie Canada, au Québec, 69% des chauffeurs gagnent moins que 20 000$ par année. Certains font plus, soit entre 30 000 et 40 000, mais c’est généralement au coût d’une semaine de travail de 70h. Entre les intérêts, l’essence et les impôts, les recettes se font minces et le remboursement s’étend sur de longues années.
Un monopole dissimulé
Le Star Phoenix faisait récemment la lumière sur le système de taxis à Ottawa, et montrait la concentration de l’industrie dans cette ville. La compagnie Coventry Connections y possède, entre autres, Blue Line, DJ’s et West-way, ou encore le 9/10 des compagnies de taxi à Ottawa. De plus, le vice-président de Coventry Connections, Marc-André Way, possède à lui seul 87 permis de taxi.
À Vancouver, selon le Dependant Magazine, les quatre principales compagnies de taxi que sont Yellow Cab, Blacktop/Checker Cab, Maclure’s Cabs et Vancouver Taxi se partagent entre-elles la totalité des permis de taxi de Vancouver, soit 588 permis attribués par le Passenger Transportation Board.
Les compagnies revendent par la suite ces permis au prix de 800 000$ pour un taxi complet. Habituellement, elles divisent le permis en 2 quarts de travail de 12 h : celui de nuit et celui de jour. S’approprier un demi-permis coûte donc 400 000$. L’acheteur peut être n’importe qui détenant un permis de conduire et l’argent nécessaire. L’acheteur en question, par la suite, pour effectuer un maximum de profit, loue le permis aux chauffeurs de taxi qui n’ont pas les moyens de posséder une telle voiture au prix moyen de 2500$ par mois pour un «demi-taxi».
Ces acheteurs intermédiaires gonflent donc le prix à payer pour les chauffeurs de taxi qui doivent s’assurer une entrée d’argent importante à chaque mois pour couvrir la location, l’essence, les assurances et, à la toute fin de la liste, un salaire décent.
À Toronto, les enquêtes de certains quotidiens à grand tirage dont le Globe and Mail se sont penchés sur le monopole des compagnies de taxi et des permis. En effet, le journaliste Peter Cheney dévoilait il y a quelques années qu’un certain Mitch Grossman et sa famille possèdent à eux-seuls plus de 100 des permis distribués par la ville. Lorsqu’un chauffeur veut utiliser un de ces permis, Grossman lui fait acheter une voiture de taxi hors de prix et la finance avec sa firme familiale, Symposium Finance, à des taux d’intérêts pouvant monter jusqu’à 28%. Aucun de ces permis ne sont au nom de Grossman lui-même, mais au nom de différentes compagnies de taxi qui lui appartiennent toutes, afin de contourner les règlements sur la location de plaques.
Parmi les autres gros détenteurs de permis de taxi à Toronto se trouvent des investisseurs qui habitent en Floride et en Israël. Au bout du compte, il y a 5 ans, plus de 30% des revenus de l’industrie du taxi de Toronto se retrouvait dans les poches d’investisseurs qui touchaient leurs immenses profits à partir de l’étranger.
Metronews et le Edmonton Sun ont aussi soulevé l’existence de monopoles du taxi à Edmonton et à Calgary.
Ainsi, Uber arrive comme un cheveu sur la soupe avec ses avancées technologiques à des années lumières de l’archaïsme de l’organisation traditionnelle des taxis. L’industrie du taxi à travers le Canada s’était assise sur ses lauriers depuis des décennies. Les innovations de Uber (plateforme mobile, pouvoir attribuer une note aux chauffeurs, paiement en ligne) sont des idées que les compagnies de taxi auraient pu instaurer d’elles-mêmes, mais, faute de compétition, et avec les politiciens dans leur poche, elles n’avaient pas de raison de le faire. En effet, pourquoi chercher à se renouveler lorsqu’on contrôle déjà le marché?
Sous le capitalisme, les compagnies n’agissent pas dans un but de fournir le meilleur service au client, mais plutôt dans celui de dégager le plus grand profit possible et donc d’avoir la plus grande part du marché possible. Un tel système signifie qu’une fois qu’une entreprise détient le monopole du marché, elle n’a pas besoin de se renouveler – ce qui lui engendrerait inévitablement des coûts inutiles – puisqu’elle n’a pas à craindre que ses clients la délaissent pour sa compétitrice. C’est pourquoi le quasi-monopole des compagnies de taxi a contribué à l’obsolescence de leur système. Voyant le déclin de l’industrie et son incapacité à sortir de son apathie, le maire Coderre a même récemment dû modifier la réglementation sur les taxis pour les obliger à accepter cette technologie avant-gardiste qu’est le… paiement par carte!
Maintenant que Uber menace leurs parts de marché, ils commencent à réagir. En réponse, Taxi Diamond à Montréal lançait récemment une application qui permet de payer sa course de taxi avec son téléphone intelligent. C’est s’y mettre bien tard!
Uber, la solution?
Les usagers ont accueilli Uber à bras ouverts. Dans des pays comme l’Espagne, la France ou l’Italie où le marché de l’emploi peine à remonter la pente depuis la crise de 2008, travailler à son compte pour Uber semble une solution idéale. La majorité des gens qui conduisent pour Uber sont des étudiants qui peinent à payer leurs études ou des travailleurs qui cherchent à arrondir leur fin de mois. De plus en plus de chauffeurs de taxi travaillent pour Uber lors de leurs temps libres eux aussi.
L’entreprise Uber se défend des multiples accusations lancées par les gouvernements en disant vouloir aider l’économie et diminuer le chômage : «Nous désirons nous asseoir avec les maires pour les aider à croître, à créer de l’emploi. Ce n’est pas tant demander : nous voulons seulement qu’ils laissent les voisins s’entraider, qu’ils abandonnent leurs lois archaïques», affirmait Travis Kalanick, le fondateur de l’application. À l’entendre, on croirait qu’Uber s’est approprié le marché par pur altruisme. La réalité est toute autre.
Même si Uber ne prend que 20% du prix de la course, il faut souligner que l’entreprise considère ses chauffeurs comme des contractants et non des employés, ce qui lui permet de sauver des sommes astronomiques en bénéfices et assurances. Ce modèle a été contesté devant la Commission du travail de la Californie, qui a jugé que les chauffeurs au service d’Uber sont bel et bien des employés et non des contractants.
En étant contractants, les chauffeurs de Uber n’ont pas de primes de nuit, de dimanche ou de jours fériés. De plus, leur contrat peut être révoqué à tout moment. Le seul véritable avantage de Uber, c’est le peu de prérequis que demande l’emploi, en comparaison avec les chauffeurs de taxi qui doivent se procurer une licence.
Pourquoi s’y opposer?
Les chauffeurs de taxi s’opposent à Uber parce qu’ils y perdent toute leur clientèle. Pour ceux qui ne possèdent pas de permis de taxi, la baisse d’achalandage vient gruger leurs revenus déjà limités. Ceux qui en possède un subissent un double effet, la baisse de revenus s’additionnant à la chute libre de la valeur de leur licence achetée au prix fort.
De plus en plus de chauffeurs de taxi qui ne possèdent pas leur propre licence abandonnent leur profession et rejoignent Uber. Selon Slate, aux États-Unis, un conducteur de Uber qui travaille entre 16 et 34h par semaine a un salaire horaire moyen de 17.24$. À New York, le salaire moyen monte à 28.47$ par heure. Le maigre 13$ de l’heure en moyenne pour un chauffeur de taxi au Québec, d’après Statistiques Canada, paraît bien pâle en comparaison. Joindre l’application semble donc être la solution.
Mais le problème est plus vaste. L’arrivée d’Uber permet à n’importe qui d’être chauffeur et contourne la régulation du marché créé par le système de permis. Autrement dit, Uber vient créer un débalancement de l’offre et de la demande. Les chauffeurs de taxis ont maintenant à faire concurrence à toutes les personnes qui peuvent conduire et pas seulement aux autres chauffeurs de taxi. En ce moment, joindre Uber est plus payant que de travailler pour une compagnie de taxi. Cependant, si des chauffeurs continuent à joindre les rangs Uber, l’offre va dépasser la demande, et il deviendra difficile de dégager un revenu satisfaisant.
Les vrais perdants seront toujours les travailleur-euses
On assiste donc actuellement à une guerre des chauffeurs de taxis contre les conducteurs d’Uber. Intimidation, vandalisme, tout y passe. Pourtant, au bout du compte, les uns comme les autres ont les mêmes demandes : pouvoir subvenir à leurs besoins, nourrir leur famille et payer leurs dettes. Pendant ce temps, les barons de l’industrie du taxi tout comme les propriétaires de la compagnie de San-Francisco s’en mettent plein les poches. Ces géants se mènent un combat féroce où les réels perdants sont les travailleurs, de quelque camp soient-ils.
Les partisans du capitalisme affirment qu’il encourage l’entreprenariat et la diversité des entreprises. En réalité, il en est tout autrement. Sous le capitalisme, la compétition force chaque entreprise à chercher à écraser les autres pour s’accaparer la plus grande part du marché possible, généralement en maintenant des prix plus bas que ses compétitrices. Particulièrement dans une situation de crise économique, celles qui ne peuvent suivre font faillite ou sont rachetées par les plus grosses, qui s’accaparent leurs parts du marché. Le mouvement naturel du capitalisme est la concentration. Plutôt qu’à la diversité, le système capitaliste tend naturellement à la monopolisation.
Cette monopolisation pose un frein aux progrès technologiques. Comme mentionné précédemment, les innovations au service des clients et des employés ne sont que des dépenses superflues pour une entreprise qui domine déjà sans conteste le marché. Ainsi, l’industrie obsolète du taxi se trouve-t-elle impuissante face à l’arrivée du nouveau joueur Uber. Toutefois, à l’inverse, l’arrivée de celui-ci n’est pas exactement non plus une bénédiction venant nous sauver de la domination des dinosaures du taxis. Par la logique pernicieuse de la recherche du profit, le développement technologique sous le capitalisme n’a pas pour but l’amélioration des conditions de vie des consommateurs et des conditions de travail des travailleur-euses, et va même souvent à leur encontre.
Sous le capitalisme, le développement technologique des moyens de production, malgré son aspect progressif évident, entraine souvent aussi des conséquences néfastes pour les travailleur-euses. Marx, dans Le Capital, avait décrit comment, à l’aube du capitalisme, l’arrivée de métiers à tisser plus performants entraina des émeutes d’ouvriers tisserands en Allemagne et en Hollande. En rendant la production plus efficace, le nombre de travailleur-euses nécessaires pour produire la même quantité de marchandise ou fournir le même service diminue. Ce remplacement technologique permet donc d’augmenter le profit du patron qui a moins de salaires à payer alors qu’il jette l’employé-e à la rue. Le développement technologique se fait donc toujours pour les travailleur-euses au coût de leurs emplois. Le même phénomène observé par Marx se produit toujours de nos jours; il n’y a qu’à penser aux licenciements entrainés par l’arrivée des caisses en libre-service dans les supermarchés.
Cela dit, pourquoi devrions-nous avoir à choisir entre progrès technologique et emplois? Pourquoi les technologies ne pourraient-elles pas être au service des travailleur-euses? Les caisses en libre-service devraient permettre aux caissier-ères de travailler moins longtemps et d’avoir un meilleur salaire plutôt que de leur couper leurs emplois.
Tout ce conflit illustre finalement le ridicule du système de transport sous le capitalisme. Le marché capitaliste ne voit les transports que comme une opportunité de profits, alors qu’il s’agit d’un besoin vital. Les transports constituent une part importante des dépenses des travailleur-euses, de plus en plus écrasés par la baisse de leurs salaires, la hausse constante du coût des transports en commun et la montée générale du prix de l’essence – malgré la faiblesse du coût du pétrole. Par conséquent, la possibilité de se déplacer facilement et à coût raisonnable avec Uber offre un répit pour beaucoup de travailleur-euses, aux dépens des autres travailleurs que sont les chauffeurs de taxis.
Nous ne devrions pas avoir à choisir entre les deux. Nous défendons plutôt un programme d’investissements massifs dans le système de transport public afin d’offrir un vaste réseau de transports verts, efficaces, gratuits, et accessibles à tous-tes et en tout temps, tout en garantissant des emplois de qualité aux employé-es qui le font fonctionner. Toutefois, un tel système nécessite de revisiter en profondeur notre mode d’organisation de la production. Seul le socialisme peut nous le permettre.